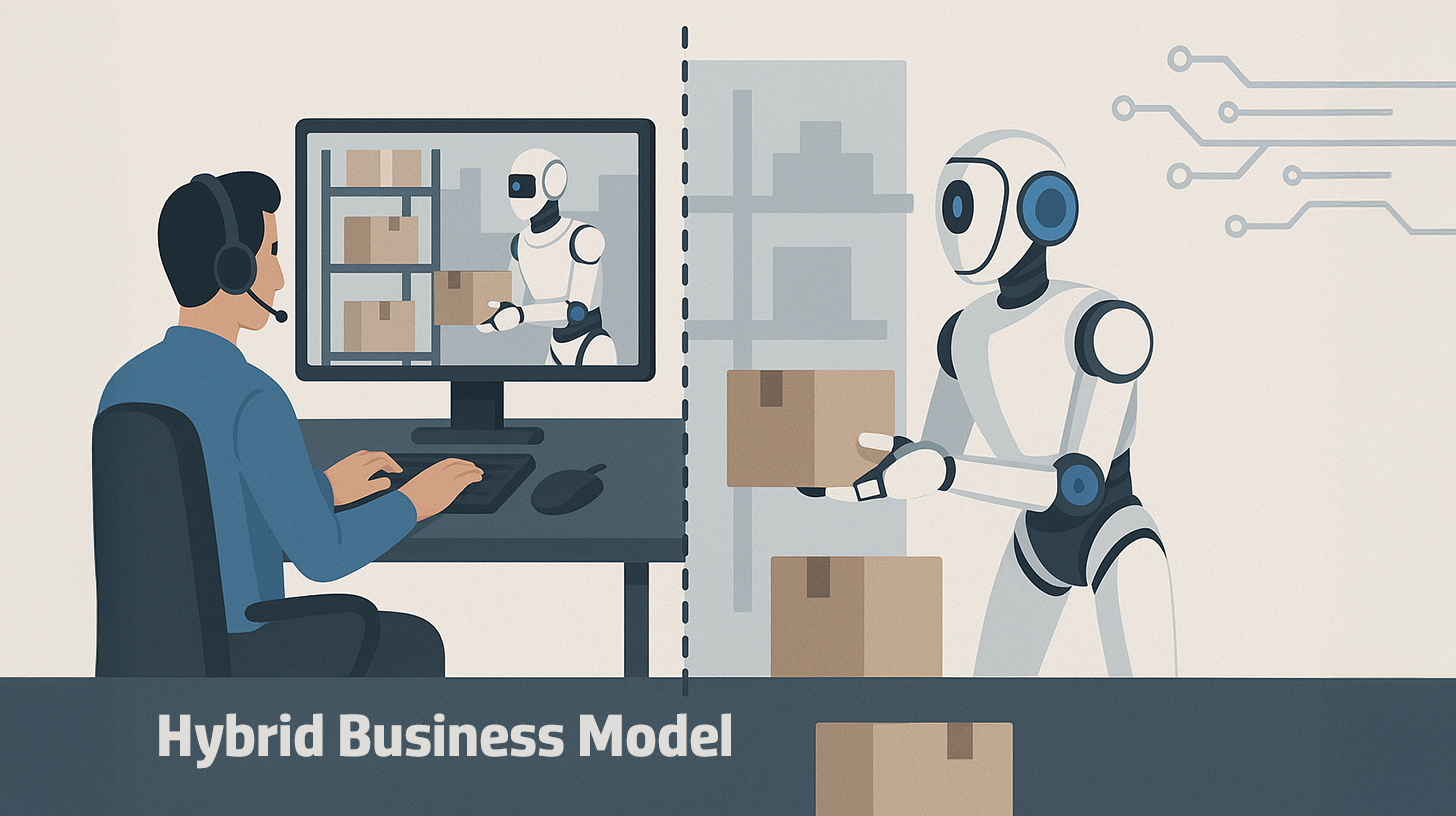
Le modèle économique hybride des robots téléopérés comme phase de transition vers l'automatisation complète – Image : Xpert.Digital
La révolution invisible de la télérobotique : quand les gens deviennent des avatars et les robots des ponts entre les mondes
La naissance d’une industrie dystopique de mille milliards de dollars ou le début d’un nouveau monde du travail ?
L'annonce récente d'une commande massive de composants par Tesla pour 180 000 robots Optimus a soulevé une question économique fascinante, restée jusqu'ici largement ignorée. Alors que la plupart des observateurs se concentrent sur les défis technologiques de l'intelligence artificielle entièrement autonome, une analyse économique objective suggère une solution provisoire à la fois brillante et profondément inquiétante. Tesla aurait passé une commande de 685 millions de dollars auprès du fournisseur chinois Sanhua Intelligent Controls, une commande qui, selon les experts du secteur, permettrait de produire environ 180 000 robots humanoïdes. La livraison de ces actionneurs linéaires est prévue pour le premier trimestre 2026, ce qui laisse présager une accélération de la production de masse.
Mais cela révèle un paradoxe fondamental du développement robotique actuel. Le logiciel agentique nécessaire pour permettre à ces robots d'effectuer de manière autonome la plupart des tâches utiles pour lesquelles les consommateurs seraient prêts à payer n'existe tout simplement pas encore. Même les robots humanoïdes les plus avancés présentent aujourd'hui un niveau d'autonomie compris entre deux et trois sur une échelle de cinq niveaux, le niveau cinq représentant une autonomie totale. Tesla a elle-même dû réduire son objectif de production initial d'au moins 5 000 unités pour 2025 à environ 2 000, et ce nombre semble également menacé. Les défis techniques se concentrent particulièrement sur les mains du robot, l'élément le plus complexe de sa conception, et sur l'intégration matérielle et logicielle. Des rapports indiquent que Tesla a accumulé un stock de robots incomplets, auxquels il manque des mains et des avant-bras, sans calendrier précis pour leur achèvement.
Cet écart entre les volumes de production annoncés et la maturité technique réelle soulève une question essentielle : quelle logique économique pourrait sous-tendre la production en série de robots qui ne sont pas encore capables de fonctionner de manière totalement autonome ? La réponse pourrait résider dans un modèle économique hybride comblant le fossé entre l’intelligence humaine et l’exécution par les machines, ce qui pourrait avoir de profondes répercussions sur les marchés du travail mondiaux.
Convient à:
- Intelligence artificielle avec Exaone Deep: LG AI Research présente un nouveau raisonnement AI Modèle-Ai-Ai de la Corée du Sud
La logique économique du contrôle à distance
Le concept de téléopération – le contrôle à distance de robots par des opérateurs humains – n'est pas nouveau. Il est déjà utilisé dans des situations extrêmes comme la décontamination nucléaire, l'exploration sous-marine et la robotique chirurgicale. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est le potentiel de transposition à grande échelle de cette approche à des applications grand public pour les tâches quotidiennes des particuliers et des entreprises. Le marché mondial de la téléopération et de la robotique à distance était évalué à environ 502,7 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 25,3 %. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas encore le potentiel disruptif d'un modèle grandeur nature de robots humanoïdes télécommandés pour des applications grand public.
L'attrait économique de ce modèle découle de l'arbitrage des écarts salariaux mondiaux. Alors qu'un ingénieur logiciel à Los Angeles gagne en moyenne 9 000 dollars par mois, le salaire pour la même qualification en Inde est d'environ 900 dollars. Cet écart n'est pas isolé, mais reflète des différences structurelles dans le coût de la vie et les structures salariales locales. Des études sur les marchés mondiaux du travail à distance montrent que, malgré la mondialisation des plateformes numériques, les salaires du télétravail sont fortement corrélés au revenu par habitant des lieux concernés. Une augmentation de 1 % du revenu par habitant est associée à une augmentation moyenne de 0,2 % des salaires du télétravail.
Si l'on applique ce principe au travail physique effectué par des robots télécommandés, un potentiel économique considérable s'ouvre. Un robot acheté une fois pour environ 20 000 à 30 000 dollars pourrait théoriquement être contrôlé 24 heures sur 24 par différents opérateurs travaillant dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Même avec un salaire horaire de 5 à 10 dollars, nettement supérieur au salaire moyen local dans de nombreux pays en développement, cela serait considérablement moins cher pour les ménages des pays industrialisés que pour les prestataires locaux. Un service de nettoyage professionnel en Allemagne coûte généralement entre 20 et 40 euros de l'heure. Le même service fourni par un robot télécommandé pourrait théoriquement être proposé pour une fraction de ce coût, tandis que l'opérateur dans un pays en développement perçoit un revenu nettement supérieur à la moyenne locale.
Le fonctionnement d'un tel système serait relativement simple. À l'instar des plateformes existantes comme Uber, un algorithme pourrait associer les demandes à des opérateurs disponibles possédant les compétences appropriées. Un système de notation garantirait la qualité et la fiabilité. Le client réserverait un service via une application, comme un ménage de deux heures ou la réparation d'un appareil électroménager. Un opérateur qualifié situé à l'autre bout du monde se connecterait au robot, effectuerait la tâche, puis se déconnecterait. L'ensemble du processus serait géré par une plateforme centrale, responsable du traitement des paiements, du contrôle qualité et des assurances.
La dimension des données de formation
Mais la logique économique de ce modèle va bien au-delà de la fourniture immédiate de services. L'un des principaux défis pour le développement de robots entièrement autonomes réside dans le manque de données d'entraînement de haute qualité issues du monde réel. Les estimations actuelles suggèrent un écart de cinq à six ordres de grandeur entre les données robotiques réelles disponibles et les volumes de données nécessaires au développement de modèles de base. Si les simulations et les données vidéo peuvent être utilisées comme outils complémentaires, elles ne sauraient se substituer à des données réelles abondantes.
La téléopération à grande échelle fournirait précisément ces données. Chaque mouvement, chaque décision, chaque adaptation aux situations imprévues des opérateurs humains serait enregistré et pourrait servir à améliorer les systèmes autonomes. Des projets comme Humanoid Everyday ont démontré l'intérêt de tels ensembles de données. Ce projet de recherche a collecté plus de 10 300 trajectoires, avec plus de trois millions d'images individuelles, pour 260 tâches différentes réparties en sept catégories, grâce à une téléopération hautement efficace et supervisée par l'homme. Ces données comprenaient des images RVB, des données de perception de la profondeur, des scans LIDAR et des données de capteurs tactiles et inertiels.
La valeur économique de cette dimension des données est complexe, mais potentiellement énorme. Les entreprises disposant d'ensembles de données complets et de haute qualité sur les opérations robotiques réelles bénéficieraient d'un avantage concurrentiel significatif pour le développement de systèmes entièrement autonomes. Ces données seraient non seulement précieuses pour le développement de leurs propres produits, mais pourraient également être concédées sous licence ou vendues. Le marché mondial des données d'entraînement de l'IA connaît une croissance exponentielle, et les données robotiques issues d'environnements réels sont particulièrement précieuses et rares.
Pour les entreprises de robotique, cela se traduirait par une triple monétisation : premièrement, par la vente ou la location de matériel ; deuxièmement, par des commissions sur les services fournis, à l’instar du modèle de plateforme d’Uber ou d’Airbnb ; troisièmement, par la collecte et l’exploitation des données d’entraînement, ce qui conduirait à terme au développement de systèmes entièrement autonomes éliminant le recours à des opérateurs humains. Cette phase de transition pourrait s’avérer extrêmement rentable, tout en jetant les bases technologiques de la phase suivante.
Le paradigme de l'arbitrage salarial mondial
Pour bien saisir les implications économiques de ce modèle, il est essentiel de comprendre les mécanismes de l'arbitrage salarial mondial. Ce phénomène économique se produit lorsque les barrières au commerce international sont réduites ou supprimées, et que les emplois migrent vers des pays où le travail et les coûts d'exploitation sont nettement plus faibles. La mondialisation des dernières décennies a déjà considérablement accéléré ce processus, notamment dans les secteurs manufacturier et des services numérisables.
L'essor du télétravail a ouvert une nouvelle dimension à l'arbitrage salarial. Si la pandémie de COVID-19 a accéléré cette tendance, tout indique que le télétravail restera une caractéristique permanente des marchés du travail mondiaux. Une étude réalisée en 2021 par Owl Labs a révélé que 92 % des entreprises européennes explorent des politiques progressistes en milieu de travail, telles que la semaine de quatre jours et des modalités de travail alternatives. Onze pour cent des entreprises interrogées envisagent même de supprimer complètement leurs bureaux.
Cette évolution a des conséquences tant pour les employeurs que pour les employés. Les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies en recrutant des travailleurs à distance originaires de régions où le coût de la vie est plus faible. Parallèlement, les travailleurs de ces régions accèdent à des opportunités d'emploi auparavant inaccessibles géographiquement et offrent des salaires supérieurs aux normes locales. Cependant, des études montrent également que les salaires des travailleurs à distance, bien que plus égaux d'un pays à l'autre que les salaires locaux, présentent encore d'importantes variations géographiques. Le taux de répercussion du taux de change sur les salaires en monnaie locale pour le travail à distance est d'environ 80 %, ce qui signifie que les salaires en monnaie locale fluctuent quasiment de pair avec le taux de change du dollar.
Appliquer ce principe au travail physique par téléopération élargirait l'arbitrage salarial, auparavant principalement limité au travail intellectuel, à un secteur beaucoup plus vaste. Les services aux ménages, les métiers spécialisés, les tâches d'entreposage et de logistique, les soins à domicile et bien d'autres domaines auparavant géographiquement limités pourraient potentiellement être mondialisés. L'impact économique serait considérable. On estime que le marché mondial des services aux ménages représente à lui seul plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Si ne serait-ce qu'une fraction de ce marché était desservie par la robotique télécommandée, une industrie valant des dizaines de milliards de dollars émergerait.
La dynamique du marché du modèle Robot-as-a-Service
Le modèle économique du « Robot-as-a-Service » a connu un essor considérable ces dernières années. Au lieu de vendre des robots directement, les entreprises les proposent par abonnement ou à l'usage, à l'instar du modèle du « Software-as-a-Service ». Le marché mondial du RaaS était évalué à 1,05 milliard de dollars en 2022 et devrait atteindre 4,12 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %. Une autre estimation évalue le marché à 1,80 milliard de dollars d'ici 2024, avec une croissance prévue à 8,72 milliards de dollars d'ici 2034.
L'attrait du modèle RaaS repose sur plusieurs facteurs. Les clients évitent l'investissement initial élevé nécessaire à l'achat de robots. Ils paient plutôt un abonnement récurrent pour une utilisation continue, ce qui leur permet d'évoluer et de bénéficier d'une flexibilité accrue. La maintenance, les mises à jour et l'intégration logicielle sont prises en charge par le fournisseur, garantissant ainsi la disponibilité opérationnelle. Pour les fournisseurs, ce modèle offre des revenus récurrents prévisibles et une meilleure compréhension des habitudes d'utilisation, permettant ainsi une prévision des revenus et une planification des approvisionnements plus précises.
Un modèle robotique télécommandé s'intégrerait parfaitement à cette approche RaaS. Les clients paieraient des frais mensuels ou à l'usage, couvrant à la fois l'utilisation du matériel et les services humains. La plateforme centraliserait la gestion des opérateurs disponibles, le suivi de la qualité, le traitement des paiements et le support technique. Cependant, contrairement aux systèmes purement autonomes, un tel modèle hybride pourrait atteindre une viabilité commerciale beaucoup plus rapide, car il ne reposerait pas sur la résolution complète des problèmes d'autonomie.
Différents modèles de tarification sont envisageables. Les modèles basés sur le temps d'utilisation factureraient les clients en fonction de la durée d'utilisation, soit environ 15 à 25 dollars de l'heure. Les modèles basés sur les tâches factureraient en fonction des tâches effectuées, par exemple 50 dollars pour un ménage complet d'appartement, quel que soit le temps nécessaire. Les modèles par abonnement pourraient proposer un nombre d'heures précis par mois à un prix fixe, par exemple 500 dollars pour 30 heures. Le coût réel pour l'opérateur représenterait une fraction de ce montant, généralement entre 5 et 10 dollars de l'heure, ce qui permettrait à la plateforme de dégager des marges substantielles.
Bénéficiez de la vaste expertise quintuple de Xpert.Digital dans un package de services complet | BD, R&D, XR, PR & Optimisation de la visibilité numérique
Bénéficiez de la vaste expertise de Xpert.Digital, quintuple, dans une offre de services complète | R&D, XR, RP et optimisation de la visibilité numérique - Image : Xpert.Digital
Xpert.Digital possède une connaissance approfondie de diverses industries. Cela nous permet de développer des stratégies sur mesure, adaptées précisément aux exigences et aux défis de votre segment de marché spécifique. En analysant continuellement les tendances du marché et en suivant les évolutions du secteur, nous pouvons agir avec clairvoyance et proposer des solutions innovantes. En combinant expérience et connaissances, nous générons de la valeur ajoutée et donnons à nos clients un avantage concurrentiel décisif.
En savoir plus ici :
Comment les robots humanoïdes télécommandés pourraient révolutionner les marchés du travail mondiaux
La vision d'un billion de dollars et la réalité
L'idée d'une industrie des robots humanoïdes pesant plusieurs milliards de dollars n'est pas une illusion. Morgan Stanley a récemment prédit que le marché des robots humanoïdes pourrait atteindre cinq mille milliards de dollars d'ici 2050, avec plus d'un milliard d'unités en service dans le monde. Cette projection inclut des ventes de matériel d'environ quatre mille milliards de dollars, auxquelles s'ajoutent les logiciels, les données et les services. Goldman Sachs estime que le marché mondial des robots humanoïdes pourrait atteindre trois cent huit milliards de dollars d'ici 2035, avec environ 250 000 unités destinées aux applications industrielles et jusqu'à un million d'unités par an destinées au grand public d'ici une décennie.
Le marché mondial des robots humanoïdes est estimé entre 1,55 et 2,02 milliards de dollars d'ici 2024, selon les sources, avec des projections allant de 4,04 à 15,26 milliards de dollars d'ici 2030. Ces divergences d'estimations reflètent l'incertitude liée à un marché aussi jeune et en pleine évolution. Cependant, le consensus est que les taux de croissance seront exceptionnellement élevés, avec des taux annuels compris entre 17,5 et 52,8 %, selon les sources et les hypothèses sous-jacentes.
Le déploiement sera progressif, sans explosion. Morgan Stanley prévoit environ 13 millions d'unités en service d'ici 2035, principalement dans les usines et les entrepôts. La baisse des prix stimulera l'adoption. Les prix de vente pourraient passer de 200 000 dollars actuels à 50 000 dollars dans les pays riches d'ici le milieu du siècle, et à 15 000 dollars sur les marchés où la chaîne d'approvisionnement est dominée par la Chine. Avec le vieillissement de la main-d'œuvre des pays du G7 et de la Chine, les humanoïdes passent du statut de prototypes futuristes à celui de produits de première nécessité.
Mais ces projections supposent généralement une autonomie croissante. Un modèle de transition télécommandé pourrait considérablement accélérer ce calendrier. Au lieu d'attendre la pleine maturité technologique, des millions de robots pourraient être opérationnels d'ici cinq à dix ans. Les entreprises de plateformes gagneraient des parts de marché significatives et fidéliseraient leurs clients durant cette phase, ce qui leur donnerait un avantage décisif lorsque la technologie permettra enfin des opérations entièrement autonomes.
Convient à:
- Actuellement la plus grande étude de robotique humanoïde de Xpert.Digital-Marktboom à venir: des prototypes de robot à la pratique
La main-d'œuvre derrière les machines
La dimension humaine de ce modèle soulève des questions complexes. Qui seraient ces opérateurs et dans quelles conditions travailleraient-ils ? Les candidats les plus probables sont les travailleurs des pays en développement, où les disparités salariales sont les plus marquées. Des pays comme l'Inde, les Philippines, le Vietnam, le Bangladesh et plusieurs États africains comptent une population nombreuse et suffisamment instruite numériquement, mais des opportunités d'emploi locales limitées.
Pour de nombreuses personnes dans ces régions, la commande à distance de robots représenterait une opportunité d'emploi attrayante. Ce travail serait moins exigeant physiquement que de nombreuses alternatives locales, offrirait des environnements de travail climatisés et permettrait des horaires flexibles. Les salaires, bien que faibles par rapport aux pays industrialisés, seraient supérieurs à la moyenne locale. Un opérateur gagnant huit à dix dollars de l'heure gagnerait un revenu moyen à élevé dans de nombreux pays en développement.
Parallèlement, ce modèle présente des risques importants d'exploitation. Les relations de pouvoir entre les plateformes mondiales et les travailleurs individuels des pays en développement sont fondamentalement asymétriques. Sans réglementation et normes de protection du travail appropriées, les conditions de travail pourraient devenir précaires. Des études sur l'économie des petits boulots et les plateformes de travail par clic montrent que les travailleurs reçoivent souvent des instructions peu claires, perçoivent de faibles salaires et sont privés de protection sociale. Le travail est souvent externalisé auprès d'entreprises tierces, ce qui obscurcit encore davantage la responsabilité.
Les recherches sur l'arbitrage salarial mondial dans le secteur des services informatiques montrent que cette pratique a des conséquences importantes sur la dynamique de la main-d'œuvre mondiale. Dans les pays à salaires élevés, elle entraîne des pertes d'emplois, notamment dans les secteurs où les tâches sont standardisées. Dans les pays à bas salaires, elle crée des opportunités d'emploi, mais peut également engendrer une pression salariale et de mauvaises conditions de travail en l'absence de réglementation adéquate. La même dynamique se reproduirait avec la robotique télécommandée, mais avec une portée potentiellement encore plus grande, car elle ne se limiterait pas aux services numériques.
La dimension dystopique
La possibilité de recourir au travail pénitentiaire, évoquée dans le scénario initial, est particulièrement inquiétante. En effet, il existe déjà des précédents en matière d'emploi de détenus dans l'économie numérique. En Finlande, l'entreprise Metroc emploie des détenus dans quatre prisons depuis 2022 pour effectuer des tâches d'annotation de données destinées aux systèmes d'entraînement à l'IA. Les détenus bénéficient d'ordinateurs et d'une formation, et sont rémunérés 1,54 € de l'heure, soit le même tarif que pour le travail physique en prison.
Les préoccupations éthiques entourant ces programmes sont importantes. La directive européenne sur le travail de plateforme, adoptée en 2024, vise à protéger les travailleurs de l'économie à la demande et à garantir des salaires équitables, des droits du travail et un pouvoir de négociation collective aux travailleurs du numérique exerçant des activités à la tâche. Cependant, la directive ne mentionne pas explicitement les conditions spécifiques des travailleurs du numérique emprisonnés. La Convention européenne des droits de l'homme interdit le travail forcé, mais autorise le travail nécessaire au déroulement normal de l'incarcération, à condition qu'il soit légal et équitable.
Le recours à la main-d'œuvre carcérale pour la fabrication de robots télécommandés aggraverait encore ces dilemmes éthiques. Les déséquilibres de pouvoir en milieu carcéral compliquent considérablement la question du travail bénévole. Si ce travail est mal rémunéré, manque de formation pertinente et sert principalement à fournir une main-d'œuvre bon marché à des entreprises privées, il peut enfreindre les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la réforme pénitentiaire.
Même sans travail pénitentiaire, le modèle robotique télécommandé soulève de profondes questions d'exploitation et de justice sociale. Les opérateurs travailleraient-ils dans des ateliers clandestins virtuels, avec de longues journées de travail, des pauses minimales et une supervision constante ? Seraient-ils correctement formés et soutenus, ou simplement affectés à des tâches en espérant apprendre par tâtonnements ? Auraient-ils accès à la sécurité sociale ou seraient-ils traités comme des travailleurs indépendants sans assurance maladie, sans congés payés ni retraite ?
L'histoire de l'industrialisation montre que le progrès technologique, sans cadre social et juridique approprié, peut conduire à une exploitation massive. Les premières usines textiles en Angleterre, les ateliers clandestins de l'industrie du vêtement, les conditions précaires dans les centres d'appels : autant d'exemples qui incitent à la prudence. La mondialisation du travail physique par la téléopération pourrait engendrer des conditions similaires, voire pires, sans réglementation proactive, car la distance géographique entre employeurs et employés complique considérablement l'application des normes.
Impact sur les marchés du travail locaux dans les pays industrialisés
Si les opérateurs des pays en développement peuvent être confrontés à une forme d'exploitation, les travailleurs des pays développés seraient confrontés à une menace différente : la perte d'emploi. Le secteur des services, notamment dans des domaines comme le nettoyage, la restauration, le commerce de détail, les soins et les métiers spécialisés, emploie des millions de personnes en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions développées. Ces emplois sont souvent mal rémunérés et offrent des perspectives d'évolution limitées, mais ils représentent d'importantes sources de revenus pour de nombreuses personnes peu instruites ou pour les immigrants.
L'introduction de robots télécommandés concurrencerait directement ces travailleurs. Un robot contrôlé par un opérateur en Inde, rémunéré 15 dollars de l'heure, serait plus attractif pour la plupart des ménages qu'un service de nettoyage local à 40 dollars de l'heure. Les économies d'échelle et la baisse des coûts de main-d'œuvre forceraient de nombreux prestataires de services traditionnels à quitter le marché.
Les recherches sur l'impact de l'automatisation sur l'emploi présentent des résultats mitigés, selon la technologie, le secteur d'activité et le contexte réglementaire. Des études sur les robots industriels ont montré qu'un robot supplémentaire pour 1 000 travailleurs réduit le taux d'emploi de 0,16 à 0,20 point de pourcentage, avec un effet de déplacement significatif dominant. Cet effet est particulièrement prononcé pour les travailleurs ayant un niveau d'éducation moyen et les cohortes plus jeunes, les hommes étant plus touchés que les femmes. Cependant, d'autres études ont montré que l'emploi global ne diminue pas au niveau local, la croissance de l'emploi dans le secteur des services compensant l'effet de déplacement dans le secteur manufacturier.
L'application de ces résultats à la robotique télécommandée est complexe. D'un côté, on pourrait affirmer que la création de nouveaux emplois pour les opérateurs dans les pays en développement compense en partie les pertes d'emplois dans les pays développés. De l'autre, cela exacerberait les inégalités économiques entre les régions et accroîtrait les tensions sociales au sein des communautés touchées dans les pays développés. Goldman Sachs Research estime que l'adoption généralisée de l'IA pourrait déplacer environ 6 à 7 % de la main-d'œuvre américaine, le taux de chômage augmentant temporairement d'un demi-point de pourcentage pendant la période de transition. Ces effets sont généralement temporaires et se dissipent au bout d'environ deux ans, avec l'apparition de nouvelles opportunités d'emploi.
Cependant, cette vision optimiste repose sur l'hypothèse que de nouveaux emplois seront créés à un rythme suffisant et de manière appropriée. L'expérience historique montre que si le changement technologique crée in fine davantage d'emplois, la période de transition peut être douloureuse pour de nombreux travailleurs. Environ 60 % des travailleurs américains occupent aujourd'hui des professions qui n'existaient pas en 1940, ce qui signifie que plus de 85 % de la croissance de l'emploi depuis lors résulte de la création d'emplois liés à la technologie. La question de savoir si cette dynamique historique se maintiendra au cours des prochaines décennies est toutefois discutable, car la rapidité et l'ampleur du changement technologique actuel pourraient être sans précédent.
Les données de formation comme cheval de Troie
L'un des aspects les plus fascinants, et pourtant les plus dérangeants, du modèle robotique télécommandé réside dans son rôle de technologie de transition. Pour les travailleurs, ce serait une opportunité d'emploi, mais pour les entreprises de plateformes, ce serait un mécanisme de collecte de données qui, à terme, rendrait leurs effectifs obsolètes. Chaque action, chaque décision, chaque ajustement effectué par un opérateur humain serait enregistré, analysé et utilisé pour entraîner les systèmes autonomes.
Ce processus serait largement invisible pour les travailleurs eux-mêmes. Ils effectueraient leurs tâches quotidiennes, contrôlant des robots pour nettoyer les maisons, préparer les repas ou effectuer de simples réparations. Parallèlement, leurs actions seraient stockées dans de vastes bases de données analysées par des algorithmes d'apprentissage automatique. Au fil du temps, ces systèmes apprendraient à reproduire les décisions humaines, d'abord pour des tâches simples et répétitives, puis pour des activités de plus en plus complexes.
Les implications éthiques de cette pratique sont importantes. Les travailleurs travailleraient ainsi à leur propre remplacement, souvent sans en avoir pleinement conscience. Si certains pourraient arguer qu'il s'agit d'une forme naturelle et efficace de progrès technologique, elle soulève des questions de transparence, de consentement éclairé et de rémunération équitable. Les opérateurs devraient-ils être rémunérés davantage pour la valeur de leur formation ? Devraient-ils être informés que leur travail servira à les remplacer ? Devraient-ils avoir leur mot à dire sur l'utilisation de leurs données ?
Ces questions ne sont pas purement hypothétiques. Le secteur de l'IA est déjà confronté à d'importants problèmes liés à l'exploitation des travailleurs des données. Les entreprises recrutent fréquemment des personnes issues de communautés pauvres et défavorisées, notamment des réfugiés, des personnes incarcérées et d'autres personnes ayant peu d'opportunités d'emploi, souvent par l'intermédiaire d'entreprises tierces, en tant que prestataires plutôt qu'employés à temps plein. Ces travailleurs sont souvent payés à peine 1,46 $ de l'heure après impôts pour l'annotation de données, essentielle à l'entraînement des systèmes d'IA. Ils travaillent dans des conditions précaires, avec peu de protection du travail et aucune possibilité de contester les pratiques contraires à l'éthique.
Le travail d'étiquetage des données est souvent effectué loin des sièges sociaux de la Silicon Valley des multinationales qui privilégient l'IA, du Venezuela, où les travailleurs étiquettent les données destinées aux systèmes de reconnaissance d'images des véhicules autonomes, à la Bulgarie, où les réfugiés syriens alimentent les systèmes de reconnaissance faciale avec des selfies classés par origine, sexe et âge. Ces tâches sont souvent confiées à des travailleurs précaires dans des pays comme l'Inde, le Kenya, les Philippines ou le Mexique. Souvent, les travailleurs ne parlent pas anglais, mais reçoivent des instructions en anglais et s'exposent à un licenciement ou une suspension des plateformes de travail collaboratif s'ils ne comprennent pas parfaitement les règles.
Les défis réglementaires
Réglementer une plateforme robotique mondiale télécommandée serait exceptionnellement complexe. Les travailleurs seraient situés dans un pays, la plateforme dans un autre, les clients dans un autre encore, et les robots fonctionneraient dans un quatrième. Quel droit du travail s'appliquerait ? Qui serait responsable des accidents ou des dommages ? Comment les impôts seraient-ils collectés et distribués ?
Le cadre juridique existant est inadapté à cette nouvelle forme de travail mondial. La plupart des lois sur la protection du travail sont définies au niveau national ou régional et supposent la présence physique des travailleurs sur le territoire concerné. La directive européenne sur le travail de plateforme tente de combler certaines de ces lacunes, mais elle ne prend pas pleinement en compte la complexité du travail physique à distance. Des défis similaires se posent en matière de fiscalité, de cotisations sociales et de responsabilité.
Un autre enjeu réglementaire concerne la protection des données. Les robots opérant à domicile auraient nécessairement accès à des détails intimes de la vie de leurs propriétaires. Caméras et capteurs collecteraient des données en continu, et les opérateurs situés dans des pays lointains les consulteraient en temps réel. Comment ces données seraient-elles protégées ? Qui y aurait accès ? Combien de temps seraient-elles conservées ? Les lois existantes sur la protection des données, comme le RGPD dans l'UE, offrent certaines garanties, mais leur application à la robotique télécommandée n'a pas encore été testée et est potentiellement inadéquate.
Des questions de sécurité nationale et de souveraineté économique se posent également. Lorsque de larges pans des infrastructures de services de base d'un pays dépendent de plateformes basées dans d'autres juridictions et employant des travailleurs de pays tiers, de nouvelles vulnérabilités apparaissent. Que se passerait-il en cas de conflits internationaux, de cyberattaques ou simplement de perturbations des activités ? Les pays perdraient-ils subitement des services essentiels ?
Notre expertise industrielle et économique mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing
Notre expertise mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing - Image : Xpert.Digital
Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie
En savoir plus ici :
Un pôle thématique avec des informations et une expertise :
- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles
- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention
- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie
- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur
Autonomie vs. Téléopération : qui gagnera l’avenir du travail ?
Les dimensions socio-psychologiques
Au-delà des enjeux économiques et juridiques immédiats, cette évolution revêt des aspects socio-psychologiques plus profonds. Quel effet cela ferait-il d'être servi chez soi par un robot contrôlé par une personne invisible, à l'autre bout du monde ? Quel type de relation se développerait entre les clients et les opérateurs à distance ?
Les recherches sur les systèmes de téléprésence suggèrent que les humains sont tout à fait capables d'interagir avec des chirurgiens à distance grâce à des avatars robotiques tout en maintenant un certain lien social. L'exemple de l'Avatar Robot Cafe DAWN à Tokyo est instructif. Les clients du café sont servis par des robots humanoïdes appelés OriHime, contrôlés à distance par des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces robots deviennent l'avatar du chirurgien, qui peut communiquer, prendre des commandes et servir des repas, le tout depuis le confort de son domicile ou de l'hôpital. Le café a démontré que cette forme de téléprésence peut fonctionner aussi bien pour les chirurgiens que pour les clients, créant des opportunités d'emploi et favorisant les liens sociaux pour des personnes qui, autrement, seraient isolées.
Cependant, ce modèle diffère sur des points importants de la robotique commerciale télécommandée. Au Café DAWN, la dimension sociale et de réadaptation est au cœur du concept. Les clients savent qu'ils aident des personnes qui, autrement, n'auraient aucune chance d'emploi. À l'inverse, la robotique commerciale télécommandée serait principalement axée sur l'efficacité et la minimisation des coûts. Les opérateurs humains seraient interchangeables et largement invisibles. Les clients privilégieraient le service et le prix, et non le contact humain.
Cela pourrait accentuer l'aliénation et l'atomisation des relations sociales. Les relations de service traditionnelles, aussi asymétriques soient-elles, impliquent au moins une certaine interaction et reconnaissance humaines. Un agent d'entretien, un serveur, un homme à tout faire : tous ces individus sont physiquement présents et perçus comme humains. Un robot télécommandé supprimerait cette dimension humaine et la remplacerait par un service abstrait. Pour les opérateurs, cela pourrait signifier une forme d'invisibilité : leur travail est valorisé, mais eux-mêmes ne sont ni vus ni reconnus.
Convient à:
- Des visions ridiculisées à la réalité : pourquoi l'intelligence artificielle et les robots de service ont dépassé leurs détracteurs
Scénarios alternatifs et évolutions possibles
Il est important de souligner que le scénario décrit ici, impliquant le déploiement massif de robots humanoïdes télécommandés, n'est en aucun cas inévitable. Plusieurs facteurs pourraient entraver, ralentir ou freiner ce développement. Les défis techniques liés à la production en série de robots humanoïdes fiables à des prix abordables sont considérables. Malgré des démonstrations remarquées et des progrès impressionnants réalisés avec les prototypes, des problèmes fondamentaux subsistent. L'autonomie de la batterie de la plupart des robots humanoïdes n'est actuellement que d'environ deux heures. Assurer une journée de travail complète de huit heures sans recharge pourrait prendre dix ans, voire plus. La dextérité et la motricité fine restent bien inférieures aux capacités humaines, avec des écarts importants en termes de sensibilité tactile et de précision.
Bain & Company a analysé dans son rapport technologique 2025 que les robots humanoïdes ne sont pas encore prêts à être déployés à grande échelle. La plupart d'entre eux sont actuellement en phase pilote et dépendent fortement de l'intervention humaine pour la navigation, la dextérité ou le changement de tâche. Ce déficit d'autonomie est réel. Les démonstrations actuelles masquent souvent les limites techniques par des environnements mis en scène ou une surveillance à distance. Les environnements contrôlés tels que les environnements industriels, les commerces de détail et certains services seront probablement les premiers à voir des robots humanoïdes déployés – des lieux où l'agencement et l'environnement sont bien connus et étroitement contrôlés.
Il est également possible que le développement de l'IA entièrement autonome progresse plus rapidement que prévu, sautant ou raccourcissant considérablement la phase de transition vers la télégestion. Les avancées en matière d'IA générative et de modèles linguistiques à grande échelle sont remarquables, et leur intégration aux systèmes robotiques pourrait conduire à des avancées technologiques éliminant le recours à des opérateurs humains plus tôt que prévu. Dans ce scénario, les entreprises pourraient migrer directement vers des systèmes entièrement autonomes sans investir dans une infrastructure de téléopération mondiale.
Un autre facteur est la résistance sociale et politique potentielle. Si l'impact sur les marchés du travail locaux des pays développés devient trop important, les gouvernements pourraient prendre des mesures réglementaires pour protéger les emplois nationaux. Ces mesures pourraient aller de l'imposition de droits de douane sur les services à distance à l'exigence d'un salaire minimum pour les opérateurs à distance, jusqu'à une interdiction pure et simple. Les syndicats et les organisations de salariés exerceraient probablement une pression considérable pour protéger leurs membres.
D'autre part, les considérations éthiques et la responsabilité sociale pourraient améliorer les conditions de travail des opérateurs. Les entreprises engagées dans des pratiques équitables pourraient se différencier par des certifications et la transparence. Les consommateurs pourraient être prêts à payer davantage pour des services fournis dans des conditions éthiquement acceptables, à l'instar du modèle du commerce équitable dans d'autres secteurs. Cela n'éliminerait pas les asymétries de pouvoir fondamentales, mais permettrait au moins d'éviter certains des pires excès d'exploitation.
La perspective à long terme
Avec du recul et une perspective à long terme, la robotique télécommandée apparaît comme une phase de transition potentielle dans une transformation technologique et économique plus vaste. Cette transformation mènera à terme à un monde doté d'un degré d'automatisation bien plus élevé, mais le chemin pour y parvenir reste incertain et sera déterminé par de nombreux facteurs.
Dans un scénario optimiste, l'automatisation entraînerait des gains de productivité massifs, bénéfiques pour tous. La main-d'œuvre déplacée serait réaffectée à de nouveaux emplois plus épanouissants et mieux rémunérés, inaccessibles aux machines. Les heures de travail seraient réduites, et chacun aurait plus de temps pour se former, créer et s'épanouir. La richesse créée par l'automatisation serait redistribuée grâce à une fiscalité progressive et à des programmes sociaux, incluant éventuellement un revenu de base universel. Les travailleurs des pays en développement acquerraient des compétences et du capital grâce à des emplois temporaires d'opérateurs de robots, leur permettant ainsi de s'intégrer à une économie diversifiée et modernisée.
Dans un scénario pessimiste, l'automatisation entraînerait des pertes d'emplois massives sans créer suffisamment de nouvelles opportunités d'emploi. Les gains de l'automatisation seraient concentrés sur une petite élite, tandis que la majorité de la population serait confrontée à des emplois précaires, à des salaires en baisse et à une mobilité sociale réduite. Les travailleurs des pays en développement seraient exploités puis abandonnés une fois leurs services devenus inutiles. Troubles sociaux, instabilité politique et inégalités croissantes caractériseraient les sociétés du monde entier. Les capacités de surveillance et de contrôle créées par la robotique omniprésente seraient exploitées par des régimes autoritaires ou des entreprises.
La réalité se situera probablement entre ces extrêmes, variant selon les pays et les régions en fonction de leurs décisions politiques, de leurs structures économiques et de leurs institutions sociales. Certaines sociétés réussiront leur transition grâce à des filets de sécurité, des programmes de reconversion et des mécanismes de redistribution adaptés. D'autres pourraient sombrer dans des crises, avec des inégalités et des tensions sociales croissantes.
La nécessité d'une conception proactive
Le modèle de robotique télécommandée, s'il était effectivement mis en œuvre à grande échelle, incarnerait cette dynamique sous une forme condensée. Il propulserait la mondialisation à un niveau supérieur en permettant le travail physique sur plusieurs continents. Il créerait de nouvelles formes de travail et d'exploitation. Il permettrait la collecte de données à une échelle sans précédent, ouvrant ainsi la voie à une automatisation encore plus poussée.
Dans ce contexte, une conception proactive plutôt qu'une adaptation réactive s'impose. Les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et les entreprises doivent collaborer pour créer des cadres qui optimisent les avantages de cette technologie tout en minimisant ses risques. Cela requiert une intervention à plusieurs niveaux. Au niveau international, des traités et des accords sont nécessaires pour établir des normes minimales pour l'emploi des téléopérateurs. Ces normes devraient inclure des salaires équitables, des horaires de travail raisonnables, des protections en matière de santé et de sécurité, et le droit syndical. L'Organisation internationale du Travail pourrait jouer un rôle de premier plan à cet égard, à l'instar de ses efforts pour réglementer d'autres formes de travail transfrontalier.
Au niveau national, des lois sont nécessaires pour protéger les droits des travailleurs locaux et des opérateurs à distance. Cela pourrait inclure l'imposition de taxes ou de prélèvements sur les services à distance, dont les recettes serviraient à financer des programmes de reconversion et la sécurité sociale des travailleurs licenciés. Des exigences de transparence et de responsabilité pourraient également être imposées aux entreprises de plateformes, notamment la divulgation des conditions de travail, des pratiques d'utilisation des données et des mesures de sécurité.
La réglementation sur la protection des données doit être adaptée aux défis spécifiques de la robotique télécommandée. Des règles claires sont nécessaires concernant les données pouvant être collectées, leur stockage et leur utilisation, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles elles le sont. Les utilisateurs devraient avoir le droit de savoir lorsqu'ils sont manœuvrés par un système télécommandé et la possibilité de refuser. Les opérateurs devraient avoir le droit d'être informés de l'utilisation de leurs données professionnelles et, le cas échéant, de participer à la création de valeur par leurs contributions à la formation.
La dimension éthique de l'innovation
En fin de compte, ce débat ne porte pas uniquement sur la technologie ou l'économie, mais sur des questions fondamentales d'éthique et sur le type de société que nous souhaitons bâtir. L'innovation technologique n'est pas neutre en termes de valeurs. Les décisions prises aujourd'hui par les ingénieurs, les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs politiques façonneront les structures sociales de demain.
Le modèle de robotique humanoïde télécommandée incarne à la fois les promesses et les dangers du progrès technologique. D'un côté, il offre le potentiel de rendre les services plus abordables et accessibles, de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans les pays en développement et d'ouvrir la voie à une automatisation encore plus poussée. De l'autre, il menace de créer de nouvelles formes d'exploitation, de déstabiliser les marchés du travail locaux et d'accroître la concentration du pouvoir et des richesses entre les mains d'un petit nombre de plateformes mondiales.
La question n'est pas de savoir si cette technologie sera développée, mais comment. Sera-t-elle développée et déployée dans le respect de la dignité et du bien-être de toutes les personnes concernées ? Ou servira-t-elle principalement des intérêts de profit à court terme au détriment de la justice sociale et de la durabilité ? L'histoire du développement technologique montre que la réponse à cette question n'est pas prédéterminée. Elle dépend de décisions conscientes, de débats politiques, de mouvements sociaux et d'interventions réglementaires.
En ce sens, le débat sur la robotique télécommandée porte également sur l'avenir du travail, la nature des relations économiques mondiales et la répartition des bénéfices du progrès technologique. Ce débat ne doit pas être laissé aux seuls technologues et chefs d'entreprise, mais doit impliquer tous les segments de la société. Seul un dialogue large, éclairé et démocratique permettra de garantir que la révolution robotique soit non seulement impressionnante sur le plan technologique, mais aussi socialement juste et humainement bénéfique.
Les années à venir montreront si la commande massive de composants de Tesla est bel et bien le prélude à un nouveau modèle économique mondial ou si des voies de développement alternatives prévaudront. Il est toutefois déjà clair que la convergence de la robotique humanoïde, de la téléopération et de l'arbitrage salarial mondial a le potentiel de transformer les marchés du travail de manière à la fois révolutionnaire et profondément perturbatrice. L'enjeu est de façonner cette transformation de manière à servir le bien commun, et non les seuls intérêts de quelques-uns.
Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial
☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand
☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !
Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital
J'attends avec impatience notre projet commun.

