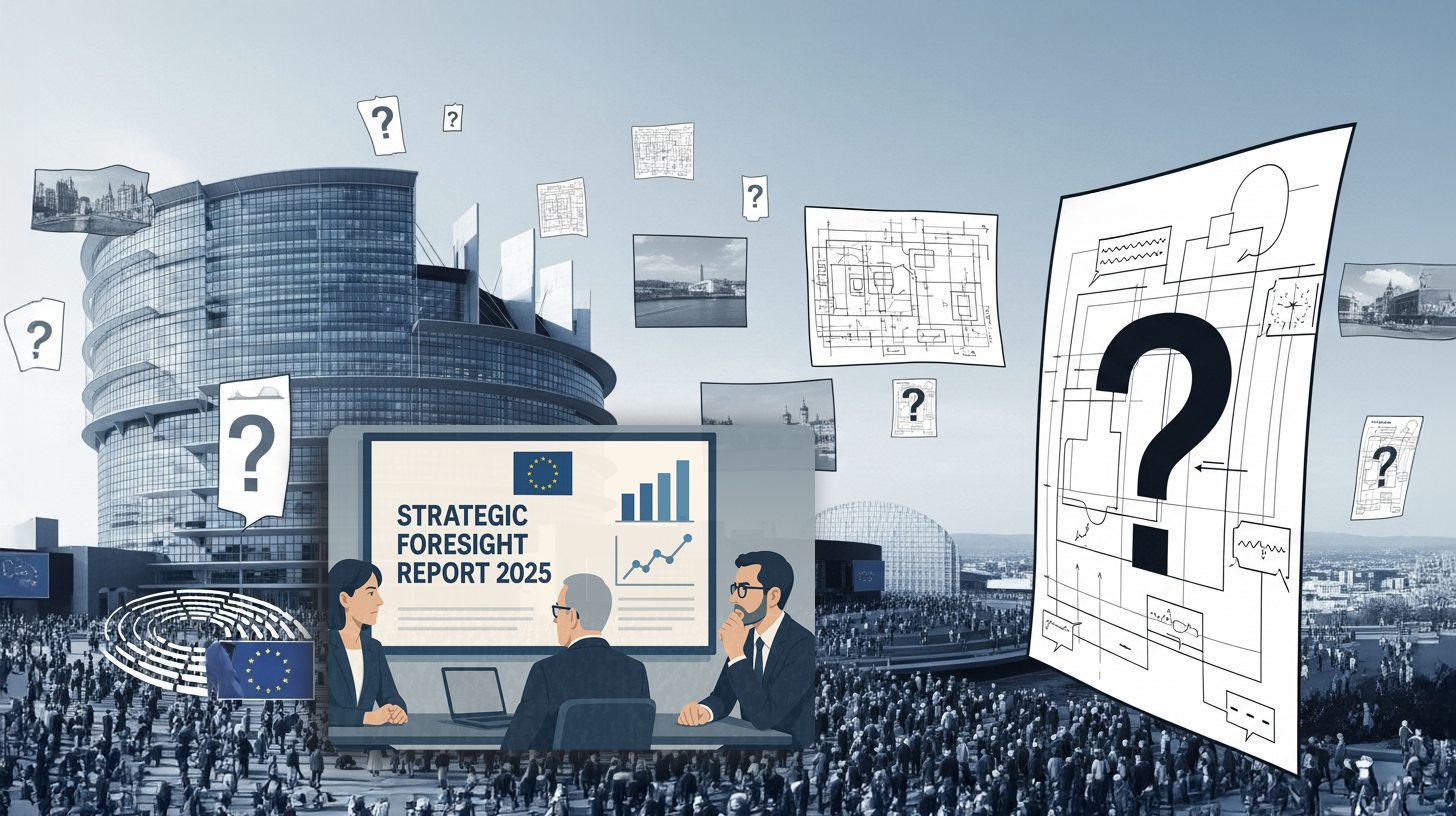
Stratégie future majeure de l'UE : « Rapport de prospective stratégique 2025 » – Les experts critiquent le manque d'idées nouvelles – Image : Xpert.Digital
Nouveau plan de l’UE présenté : une idée brillante ou juste du vieux vin dans de nouvelles bouteilles ?
Plus un spectacle politique qu’une véritable stratégie ?
Avec son « Rapport de prospective stratégique 2025 », la Commission européenne a présenté une feuille de route ambitieuse pour l'avenir de l'UE. Sous le slogan « Résilience 2.0 », l'Union vise à devenir plus proactive et résiliente face aux crises telles que le changement climatique, les bouleversements technologiques et les tensions géopolitiques. Le rapport présente une vision de la manière dont l'UE peut non seulement survivre dans un monde en proie à des bouleversements, mais aussi en sortir renforcée.
À peine publié, le rapport a suscité de vives critiques de la part du Service de recherche du Parlement européen (EPRS). Après une analyse détaillée, les experts sont parvenus à une conclusion qui donne à réfléchir : le rapport constitue moins une analyse fondée de l’avenir qu’un programme politique pour la nouvelle législature. La principale critique porte sur le fait que les mesures proposées ne sont guère nouvelles et reprennent des objectifs politiques familiers sans offrir de solutions concrètes.
Fondamentalement, le rapport de la Commission identifie quatre domaines de tension clés que l'UE doit gérer : le conflit entre compétitivité et autonomie stratégique, l'équilibre entre innovation et garanties en matière d'IA, l'équilibre entre prospérité et évolution démographique, et la défense de la démocratie contre l'influence des algorithmes. Cependant, l'analyse du Service parlementaire suggère que les domaines d'action proposés sont très proches de la ligne politique de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le document constitue donc un contexte important pour les députés : l'initiative de la Commission constitue moins une évaluation neutre de la situation qu'un prélude stratégique à la mise en œuvre de ses objectifs politiques pour les années à venir.
Convient à:
- Parlement européen – Direction générale des services de recherche parlementaire | Rapport de prospective stratégique 2025 : Résilience 2.0
- Groupe de réflexion – Parlement européen | Rapport de prospective stratégique 2025 : Résilience 2.0
Rapport de prospective stratégique 2025 : une analyse complète
Fondement et contexte du rapport
Qu’est-ce que le rapport de prospective stratégique 2025 ?
Le rapport de prospective stratégique 2025, officiellement intitulé « Résilience 2.0 : Donner à l'UE les moyens de prospérer en période de turbulences et d'incertitude », est un document clé présenté par la Commission européenne le 9 septembre 2025. Il s'agit du premier rapport de prospective de la deuxième Commission von der Leyen. Il s'appuie sur les tendances établies et propose une analyse actualisée des défis mondiaux et européens. Son objectif principal est de renforcer la résilience de l'Union européenne afin de mieux la préparer pour l'avenir. Ce rapport sert de base à un nouveau cycle de prospective et vise à étayer l'agenda politique des années à venir dans une perspective à long terme.
Quel est l’objectif général de ces types de rapports prospectifs ?
Depuis 2020, la Commission européenne publie chaque année un tel rapport de prospective stratégique, à l'exception de l'année électorale 2024. Ces rapports ont un double objectif : d'une part, ils examinent les évolutions et tendances futures susceptibles d'affecter l'UE ; d'autre part, ils éclairent les priorités actuelles de l'Union. Selon la Commission, ces rapports visent à étayer les priorités politiques et à promouvoir une réflexion politique à long terme sur des questions transversales. Cette pratique s'inscrit dans un effort plus large des institutions européennes visant à renforcer la prospective politique. La conviction fondamentale qui sous-tend cette démarche est que les processus traditionnels de planification et d'élaboration des politiques ne suffisent plus à relever efficacement les défis complexes et interdépendants des « polycrises » auxquelles l'UE est confrontée. Il s'agit donc d'agir de manière proactive plutôt que réactive.
Dans quel contexte le rapport 2025 a-t-il été présenté ?
Le commissaire Micallef a décrit le rapport comme une « passerelle entre le travail de prospective de la précédente Commission et le nouveau mandat », soulignant son caractère transitoire. Il s'appuie sur plusieurs documents stratégiques importants publiés peu de temps auparavant. Parmi ceux-ci figurent les rapports d'Enrico Letta et de Mario Draghi, qui traitent en profondeur du marché unique et de la compétitivité européenne, ainsi que le rapport Niinistö. Il est également étroitement lié à l'agenda stratégique 2024-2029 du Conseil et à la stratégie de l'UE pour une Union de la préparation de mai 2025. Le rapport vise ainsi à consolider les conclusions et les orientations de ces différentes initiatives dans un cadre cohérent pour l'avenir.
Le concept de base : Résilience 2.0
Quel est le thème central du rapport et que signifie exactement « Résilience 2.0 » ?
Le thème central et directeur du rapport est la résilience. C'était déjà le sujet principal du tout premier rapport de prospective en 2020. Cependant, la Commission affirme que la situation mondiale a tellement changé depuis lors qu'une nouvelle approche, plus avancée, de la résilience est nécessaire. Elle appelle cette nouvelle approche « Résilience 2.0 ». Cette nouvelle forme de résilience se veut plus transformatrice, proactive et prospective que la précédente. Si l'idée initiale de résilience incluait déjà le concept de transformation de l'UE et son « rebondissement » pour devenir plus durable, plus juste et plus démocratique, « Résilience 2.0 » semble mettre davantage l'accent sur la construction active de l'avenir et l'adaptation profonde à un monde plus incertain. Cependant, le texte souligne avec critique que la différence exacte avec la version précédente n'est pas clairement définie, cette dernière étant déjà très ambitieuse. Le changement de nom en « 2.0 » sert également à transmettre un sentiment d'urgence et la nécessité d'un changement de paradigme.
Quels objectifs fondamentaux une UE résiliente devrait-elle atteindre d’ici 2040, selon le rapport ?
Le rapport définit trois piliers fondamentaux qui devraient caractériser une Union européenne résiliente en 2040. Premièrement, assurer la paix grâce à la sécurité européenne. Cela reflète l'évolution de la situation géopolitique dans laquelle les questions de sécurité jouent un rôle central dans tous les domaines d'action. Deuxièmement, défendre les valeurs de démocratie, d'État de droit et de droits de l'homme. Il s'agit d'une réponse aux menaces internes et externes qui pèsent sur ces valeurs fondamentales. Troisièmement, assurer le bien-être des citoyens. Cet objectif est défini au sens large et englobe les aspects sociaux, économiques et environnementaux de la vie dans l'UE. Ces trois fondamentaux constituent le cadre général dans lequel les défis et les champs d'action spécifiques du rapport doivent être appréhendés.
Évolution mondiale et défis spécifiques à l'UE
Quels développements mondiaux le rapport identifie-t-il comme particulièrement influents pour l’UE ?
Le rapport identifie trois évolutions mondiales qui ont un impact significatif sur l'avenir de l'UE. La première est la centralité croissante des questions de sécurité dans tous les domaines politiques. La sécurité n'est plus considérée comme une question isolée de défense ou de politique étrangère, mais comme une question transversale qui imprègne les politiques économiques, énergétiques, de santé et même éducatives. La deuxième évolution est l'érosion de l'ordre international fondé sur des règles. Les institutions et les accords qui ont assuré la stabilité pendant des décennies perdent de leur influence, conduisant à un monde plus imprévisible et conflictuel. La troisième évolution mondiale est l'impact continu du changement climatique et la détérioration progressive de l'état de la nature et des ressources en eau. Ces crises écologiques ont des conséquences directes sur la sécurité, l'économie et le bien-être dans l'UE.
Le rapport qualifie quatre défis spécifiques à l'UE de « questions d'équilibre ». Qu'est-ce que cela signifie et quel est le premier ?
Les quatre défis spécifiques à l'UE sont présentés comme des « exercices d'équilibre ». Cette formulation souligne les objectifs contradictoires inhérents et les difficultés auxquelles sont confrontés les décideurs politiques. Il ne s'agit pas de solutions simples, mais de concilier des priorités concurrentes.
Le premier exercice d'équilibre consiste à accroître la compétitivité de l'UE tout en préservant son autonomie stratégique ouverte. D'une part, l'UE doit rester ouverte au commerce mondial et attractive pour les investissements afin de préserver l'innovation et la puissance économique. D'autre part, elle doit réduire sa dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs et sa vulnérabilité aux chocs. Le rapport suggère que les intérêts nationaux devraient parfois être relégués au second plan par rapport à des mesures conjointes telles que les achats conjoints d'énergie ou les achats préférentiels de biens et services européens. Le secteur numérique illustre concrètement cette dépendance : 70 % de l'infrastructure cloud de l'UE est contrôlée par seulement trois entreprises américaines. Une plus grande indépendance sera également obtenue grâce au développement des énergies propres, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la promotion de l'économie circulaire afin de réduire la dépendance aux importations d'énergie.
Quel est le deuxième exercice d’équilibre décrit ?
Le deuxième exercice d'équilibre aborde la tension entre la promotion de l'innovation technologique et la création et le maintien de garanties. D'une part, il est nécessaire de créer un environnement concurrentiel qui libère tout le potentiel des nouvelles technologies, renforçant ainsi la résilience économique de l'UE. D'autre part, des garanties appropriées doivent être mises en place pour parer aux risques pesant sur la sécurité, les droits des citoyens et des travailleurs, la vie privée, l'environnement et la démocratie. Le rapport mentionne explicitement les nouvelles technologies telles que l'informatique quantique, la biotechnologie, la neurotechnologie, les matériaux avancés, la robotique et, en particulier, l'intelligence artificielle (IA). Concernant l'IA, la Commission constate que, malgré sa diffusion rapide, la domination du marché par quelques acteurs mondiaux brouille les frontières entre acteurs et espaces commerciaux et publics.
Quel est le troisième acte d’équilibriste ?
Le troisième exercice d'équilibre vise à relever le défi du maintien d'un niveau de bien-être élevé au sein de l'UE tout en répondant aux changements démographiques et climatiques. L'UE est réputée pour son niveau de vie élevé, ses économies fortes, ses normes environnementales et son système de santé. Cependant, ce modèle est mis à rude épreuve. L'évolution démographique, et notamment le vieillissement de la population, se traduit par une diminution de la contribution de la population à l'économie, tandis que la demande de soins et de services de santé augmente. Le rapport évite d'aborder en détail la question des migrations, mais suggère que la migration régulière est un moyen possible de répondre à la demande de talents étrangers sur les marchés du travail de l'UE. De plus, le rapport établit un lien direct entre le bien-être humain et la santé de la planète. Il soutient qu'agir en harmonie avec la nature contribue à la sécurité et à la prospérité économique, par exemple en contribuant à contenir les pandémies et en garantissant la sécurité alimentaire grâce à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique.
Et quel est le quatrième et dernier exercice d’équilibriste ?
Le quatrième exercice d'équilibre met l'accent sur la tension entre la nécessité de préserver la démocratie et les valeurs fondamentales, d'une part, et l'adaptation à l'utilisation des médias (sociaux) par les algorithmes, d'autre part. Le rapport appelle à renforcer la prise de décision démocratique, tout en reconnaissant que les opinions des citoyens sont de plus en plus façonnées par des sources personnalisées et basées sur des algorithmes. Cela limite considérablement l'espace commun de débat démocratique fondé sur des faits et des preuves partagés. De plus, le rapport met en garde contre une « nouvelle oligarchie mondiale » au sein de laquelle quelques milliardaires du numérique influencent de plus en plus les processus démocratiques. Cela peut affaiblir davantage la démocratie et miner la confiance des citoyens. En réponse, le rapport appelle à renforcer la résilience démocratique par la cohésion sociale, l'équilibre des pouvoirs institutionnels et des améliorations innovantes de la démocratie elle-même.
Hub pour la sécurité et la défense - conseils et informations
Le hub pour la sécurité et la défense offre des conseils bien fondés et des informations actuelles afin de soutenir efficacement les entreprises et les organisations dans le renforcement de leur rôle dans la politique européenne de sécurité et de défense. De près avec le groupe de travail PME Connect, il promeut en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) qui souhaitent étendre davantage leur force et leur compétitivité innovantes dans le domaine de la défense. En tant que point de contact central, le Hub crée un pont décisif entre la PME et la stratégie de défense européenne.
Convient à:
La résilience de l'UE à l'étude : opportunités, lacunes et critiques concrètes
Critique du rapport de l'UE : pourquoi les pistes de mise en œuvre concrètes font défaut
Le rapport de prospective stratégique 2025 définit huit axes d'action pour renforcer la résilience de l'UE face aux risques géopolitiques, économiques et sociétaux. Il couvre des domaines clés – de la vision globale à la sécurité, en passant par la technologie et la résilience économique, sans oublier l'éducation, la démocratie et l'équité intergénérationnelle – et reflète ainsi les orientations de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le programme stratégique du Conseil. Il est toutefois crucial de souligner que le rapport s'apparente souvent à un programme politique : les liens concrets entre les défis identifiés et les mesures proposées font défaut, les pistes de mise en œuvre restent floues et les véritables innovations sont rares. L'écart entre des objectifs ambitieux (par exemple, les normes mondiales en matière d'IA ou la réforme de l'OMC) et la capacité d'action concrète de l'UE reste frappant. Le rapport pose un défi aux parlements : les questions intersectorielles sont difficiles à traiter au sein des structures traditionnelles des commissions, ce qui explique l'examen de différents modèles de prospective parlementaire – des commissions spécialisées aux médiateurs individuels, en passant par l'intégration de la prospective dans les processus législatifs.
Les huit domaines d'action et l'évaluation critique
Quels sont les huit domaines d’action proposés par le rapport pour renforcer la résilience de l’UE ?
La dernière partie du rapport identifie huit axes d'action clés pour renforcer la résilience de l'UE. Ces axes visent à répondre à la fois aux défis spécifiques à l'UE et aux évolutions mondiales. Ces huit axes sont les suivants :
- Développer une vision globale.
- Renforcer la sécurité intérieure et extérieure.
- Rendre la technologie et la recherche utilisables.
- Renforcer la résilience économique.
- Promouvoir un bien-être durable et inclusif.
- Repenser l'éducation.
- Renforcer les fondements de la démocratie.
- Renforcer l’équité intergénérationnelle.
Ces domaines reflètent les orientations politiques de la deuxième Commission von der Leyen et l’agenda stratégique du Conseil européen.
Quelles critiques sont formulées à l’égard de la présentation de ces domaines d’action ?
La note d'information critique clairement cette section du rapport. L'une des principales critiques porte sur l'absence de liens explicites entre les huit domaines d'action proposés et les défis ou évolutions mondiales précédemment identifiés. Cela affaiblit la portée et l'impact des propositions. Le rapport aurait été plus convaincant si les actions avaient été plus clairement liées aux problèmes spécifiques.
Une autre critique majeure est que cette section se lit moins comme une analyse prospective que comme un programme politique ou un recueil de déclarations d'intention. Le ton est décrit comme plutôt directif, avec des expressions fréquentes comme « l'UE doit » ou « l'UE devrait ».
En outre, on critique le fait que les actions proposées contiennent peu de surprises et s'appuient largement sur les politiques et objectifs existants de la Commission. Elles n'identifient guère de voies ou d'instruments véritablement nouveaux pour atteindre ces objectifs ambitieux.
Exemples concrets de critiques, notamment en matière de faisabilité
Le rapport cite des exemples concrets pour étayer ses critiques. Concernant la « vision globale », par exemple, le rapport appelle l'UE à orienter le débat sur la réforme multilatérale, notamment celle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le point critique est que le rapport n'explique pas comment y parvenir, surtout à un moment où la capacité de l'UE à utiliser pleinement ses instruments de politique commerciale est mise à rude épreuve, principalement par les États-Unis.
Un autre exemple concerne l'intelligence artificielle. Le rapport appelle à l'établissement de normes mondiales et au développement d'une autonomie stratégique dans la recherche en IA. Là encore, la question se pose de savoir comment y parvenir, alors que le rapport lui-même affirmait précédemment que le secteur de l'IA était dominé par « quelques milliardaires de la technologie » appartenant à une « nouvelle oligarchie mondiale ». Le décalage entre cette exigence ambitieuse et une répartition réaliste du pouvoir reste entier.
En matière de résilience économique, de nombreux objectifs sont évoqués, tels que la transformation industrielle ou la résilience des chaînes d'approvisionnement, mais aucune nouvelle voie n'est tracée pour les atteindre. Les appels à une économie circulaire ou à une véritable union de l'épargne et de l'investissement ne font que répéter les objectifs politiques existants.
Y a-t-il de nouvelles idées ou approches dans les domaines d’action ?
Le texte suggère que la plupart des propositions ne font que répéter des revendications politiques familières. Par exemple, l'appel à une réorientation de la fiscalité du travail vers une taxation des externalités négatives (comme la pollution environnementale) est une revendication de longue date de la politique européenne. De même, l'objectif de préparer les citoyens non seulement à des professions spécifiques, mais aussi à de multiples transitions tout au long de leur vie, est depuis longtemps au cœur du débat sur la politique éducative. La seule revendication présentée comme véritablement nouvelle et relevant d'une gouvernance anticipative est l'appel à « promouvoir la maîtrise de l'IA » au sein de la population.
Placement du rapport dans le contexte stratégique de l'UE
Quel est le lien entre le rapport de prospective stratégique 2025 et l’agenda stratégique 2024-2029 du Conseil ?
La comparaison des deux documents révèle à la fois des similitudes et des différences notables. Deux des trois objectifs fondamentaux du rapport de prospective, à savoir instaurer la paix grâce à la sécurité européenne et défendre la démocratie et les droits de l'homme, reflètent directement deux des thèmes principaux du programme stratégique du Conseil : « une Europe forte et sûre » et « une Europe libre et démocratique ».
La différence fondamentale réside toutefois dans le traitement du troisième thème de l'Agenda stratégique : « une Europe prospère et compétitive ». Cet objectif n'apparaît pas dans le Rapport de prospective comme un objectif fondamental et autonome. Au contraire, les questions économiques telles que la compétitivité et la résilience économique sont intégrées aux objectifs primordiaux de sécurité européenne et de bien-être humain. Il semble que la Commission ait délibérément choisi de ne pas présenter la prospérité économique comme une fin en soi, mais avant tout comme un outil permettant d'atteindre les objectifs primordiaux de résilience, de sécurité et de bien-être. Cette impression est renforcée par le fait que la sécurité est présentée comme un leitmotiv qui imprègne tous les domaines d'action de l'UE.
Quel est le lien entre ce rapport et les orientations politiques de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen ?
Il existe un lien très étroit. Les orientations politiques présentées par le Président en juillet 2024 sont divisées en sept chapitres. Ces chapitres abordent globalement les mêmes sujets que les huit domaines d'action du Rapport de prospective, quoique dans un ordre et un regroupement différents. Il existe un large chevauchement thématique avec les trois principaux thèmes du programme stratégique du Conseil. Le seul domaine des orientations politiques qui n'a pas de parallèle clair dans le Rapport de prospective ou le programme stratégique est le dernier chapitre, intitulé « Agir ensemble et préparer notre Union pour l'avenir ». Ce chapitre traite de l'ambition budgétaire, des réformes institutionnelles et de la coopération avec le Parlement ; autrement dit, davantage du fonctionnement interne de l'UE.
Existe-t-il un lien entre le rapport et le discours sur l’état de l’Union de 2025 (SOTEU) ?
Oui, le lien est très fort et conforte l'idée que le Rapport de prospective relève davantage d'un programme politique que d'une analyse pure et simple. Le discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen a été prononcé le lendemain de la présentation du Rapport de prospective. Son contenu s'est largement inspiré des huit domaines d'action décrits dans le rapport. Il a été un peu plus précis dans certains domaines politiques, comme la migration, mais a omis la question de l'équité intergénérationnelle mentionnée dans le rapport. La proximité temporelle et le contenu suggèrent que le Rapport de prospective a servi de base stratégique et de document de communication préparatoire au discours d'ouverture de la présidente de la Commission.
Comment le rapport se compare-t-il aux précédents rapports de prospective stratégique depuis 2020 ?
On observe une remarquable continuité des thèmes abordés au fil des ans. Alors que le premier rapport de 2020 n'identifiait que quatre dimensions de résilience (sociale et économique, géopolitique, verte et numérique), les rapports de 2021 et 2022 ont chacun répertorié dix thèmes ou domaines d'action majeurs. Les thèmes centraux récurrents incluent le renforcement de l'autonomie stratégique ouverte de l'UE (notamment dans les domaines de la technologie, des matières premières et de l'énergie), la réponse aux défis sanitaires et environnementaux, la défense des valeurs démocratiques de l'UE et le renforcement des capacités de défense et du réseau mondial de partenaires. Bien que le langage et les termes à la mode aient changé – par exemple, la « transition double, verte et numérique » des rapports précédents est rarement évoquée –, les problèmes et défis sous-jacents demeurent les mêmes. Le rapport de 2025 évite de dresser un tableau trop sombre d'une guerre imminente ou d'une société dominée par la sécurité. Il maintient l'accent sur les objectifs positifs liés aux valeurs démocratiques et au bien-être des citoyens, même si la gravité des défis combinés est qualifiée d'inquiétante.
Mesures de suivi institutionnelles possibles
Comment les institutions européennes réagissent-elles généralement à de tels rapports ?
Les réactions des différentes institutions de l'UE ont traditionnellement varié. Le Comité économique et social européen (CESE) a émis des avis sur tous les rapports de prospective précédents depuis 2020 et le fera à nouveau pour le rapport 2025. En revanche, le Conseil européen et le Parlement européen n'ont pas publié de réponses ni de positions officielles sur les rapports précédents. Compte tenu de la nature horizontale et globale du rapport, le Conseil européen constituerait une instance appropriée pour adopter les conclusions du Conseil. De même, le Parlement européen pourrait réagir par un échange de vues et une résolution.
À quels problèmes le Parlement européen est-il confronté dans le traitement de tels rapports interministériels ?
Le principal problème du Parlement européen réside dans sa structure interne. Le système parlementaire de renvoi des documents à une ou plusieurs commissions spécialisées est inadapté au traitement de documents d'une telle portée et d'une telle transversalité. Un rapport de prospective couvrant des sujets aussi variés que la sécurité, l'économie, l'éducation et la démocratie ne relève pas de la compétence d'une seule commission. Son attribution à plusieurs commissions peut engendrer des problèmes de coordination et une fragmentation des résultats.
Le texte propose de prendre modèle sur les parlements nationaux. Quel est le premier modèle décrit pour la prospective parlementaire ?
La première option, et la plus importante, est la création d'un organe dédié composé de parlementaires, tel qu'une « Commission de prospective » ou une « Commission de l'avenir ». La première de ces instances a été créée en Finlande en 1993, et sept autres parlements nationaux ont depuis suivi. Le succès de ce modèle repose sur plusieurs conditions cruciales. Il exige un soutien actif et transpartisan pour éviter de devenir le jouet d'intérêts partisans. Des liens étroits avec les travaux de prospective de l'exécutif et avec les groupes de réflexion sont essentiels pour conserver sa pertinence et accéder à des analyses solides. De plus, une culture de débat non polarisante, axée sur les enjeux transsectoriels à long terme, est importante. Cela permet également d'éviter les conflits avec les commissions spécialisées permanentes existantes et le processus législatif en cours.
Quelle est la deuxième option pour ancrer la prospective dans les parlements ?
La deuxième option consiste à confier la mission de prospective à une seule personne ou à une petite unité, comme un médiateur ou un commissaire à la prospective ou aux générations futures. Cependant, cette approche comporte des risques importants, comme l'ont montré les expériences hongroise et israélienne. Il existe un risque que des débats sur l'impartialité du titulaire surgissent, ce qui pourrait compromettre la légitimité du travail. Un autre risque majeur réside dans le manque de continuité. Les activités peuvent être brutalement interrompues après des élections ou des changements politiques si la volonté politique de soutenir ce poste disparaît. L'institutionnalisation est donc nettement plus faible dans ce modèle.
Et quelle est la troisième option ?
La troisième option consiste à intégrer des éléments de prospective au processus législatif régulier, au cas par cas. Cela signifierait que les aspects à long terme et les scénarios futurs seraient également pris en compte lors de l'élaboration de lois spécifiques au sein des commissions spécialisées. Cependant, cette approche sectorielle présente un inconvénient majeur : elle ne permet pas de répondre adéquatement aux défis complexes et transversaux qui sont au cœur de la prospective et des rapports de prospective de la Commission. La force de la prospective réside précisément dans le dépassement de la pensée cloisonnée et dans l'analyse des interactions entre les différents domaines politiques. Une approche purement sectorielle ne répondrait pas à cette préoccupation fondamentale.
Conseil - Planification - mise en œuvre
Je serais heureux de vous servir de conseiller personnel.
Chef du développement des affaires
Président PME Connectez le groupe de travail de défense
Conseil - Planification - mise en œuvre
Je serais heureux de vous servir de conseiller personnel.
contacter sous Wolfenstein ∂ xpert.digital
Appelez- moi simplement sous +49 89 674 804 (Munich)
Notre expertise européenne et allemande en matière de développement commercial, de ventes et de marketing
Notre expertise européenne et allemande en matière de développement commercial, de ventes et de marketing - Image : Xpert.Digital
Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie
En savoir plus ici :
Un pôle thématique avec des informations et une expertise :
- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles
- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention
- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie
- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur

