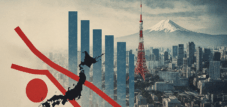Crise du logement au Canada, effondrement de l'emploi et droits de douane américains : les cinq plus gros problèmes du Canada et son plan de sauvetage audacieux. Image : Xpert.Digital
Alerte rouge pour le Canada : un conflit commercial et une crise interne menacent l'avenir
Loyers inabordables, prospérité en déclin : l’économie canadienne est dans une situation difficile – voici les raisons
Le Canada, symbole de stabilité, de prospérité et de qualité de vie élevée depuis longtemps, est confronté à une série de défis majeurs qui ébranlent les fondements de son économie. Un ensemble complexe de problèmes structurels et conjoncturels a plongé le pays dans une situation difficile : au cœur de cette crise persistante de productivité, qui a entraîné une stagnation, voire une baisse, de la richesse par habitant pendant des années, et un creusement de l’écart avec son puissant voisin économique, les États-Unis.
Cette faiblesse économique abstraite se manifeste par des crises très concrètes qui façonnent le quotidien des citoyens. En premier lieu, l'aggravation de la crise du logement et des loyers brise le rêve d'accession à la propriété pour beaucoup et fait grimper le coût de la vie. À cela s'ajoutent la hausse du chômage, alimentée par la faiblesse des investissements, et l'aggravation du conflit commercial avec les États-Unis, qui frappe durement une économie dépendante des exportations. Le tableau est complété par des finances publiques tendues, un système de santé aux limites de ses possibilités et les conséquences économiques de plus en plus perceptibles du changement climatique.
Mais le gouvernement d'Ottawa ne reste pas les bras croisés. Le pays tente de renverser la situation grâce à une stratégie multidimensionnelle. Les baisses de taux d'intérêt de la banque centrale visent à soutenir l'économie, tandis qu'un programme de construction de logements sans précédent, doté de milliards de dollars d'investissements et de nouvelles technologies comme la construction modulaire, vise à combler le déficit d'offre. Parallèlement, de nouveaux ajustements aux politiques industrielles et migratoires, ainsi qu'aux plans climatiques nationaux, sont mis en place pour ouvrir la voie à un avenir plus durable.
Cependant, la sortie de crise est semée d'embûches et son issue est incertaine. Sans une véritable relance de la productivité, une expansion massive et rapide de la construction résidentielle et une stabilisation de relations commerciales vitales, le Canada risque de perdre encore davantage sa vigueur économique et sa prospérité par habitant. Le dossier suivant examine en détail les principaux problèmes du Canada et analyse les possibilités et les risques des mesures prises pour y remédier.
Convient à:
Les plus grands problèmes actuels du Canada – et comment le pays tente de les maîtriser : un dossier de questions et réponses
Les principaux problèmes auxquels l'économie canadienne est confrontée sont la faible croissance de la productivité et la baisse du revenu par habitant, une crise persistante de l'accessibilité au logement et aux loyers, un chômage élevé et une activité d'investissement faible, les tensions liées au conflit commercial avec les États-Unis qui s'est intensifié en 2025, les finances publiques tendues, les goulots d'étranglement structurels du système de santé et les risques climatiques croissants. Ottawa réagit par des baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, un programme global de construction et de modernisation de logements, des incitatifs à l'industrie et à l'innovation, des contre-mesures budgétaires incluant une redéfinition des priorités, des ajustements de cap en matière de marché du travail et de politique migratoire, et des plans nationaux d'adaptation et de lutte contre les changements climatiques. Cependant, le chemin reste semé d'embûches : sans une augmentation crédible de la productivité, un développement durable du logement et des relations commerciales fiables, le Canada risque de continuer à croître en deçà de sa tendance et de prendre du retard en termes de croissance par habitant.
Quel est le principal problème économique du Canada?
Le problème fondamental réside dans la faiblesse persistante de la croissance par habitant, étroitement liée à une crise de productivité prononcée et à la faiblesse des investissements privés. Pendant des années, la production par habitant du Canada a été inférieure à celle des autres pays industrialisés ; l’écart de productivité avec les États-Unis est important et s’est même creusé depuis la pandémie. Les analyses de la RBC, de l’OCDE et d’autres sources décrivent une baisse du PIB réel par habitant par rapport à 2019, une stagnation des investissements des entreprises et des obstacles structurels à la concurrence, à l’adoption des technologies et aux barrières commerciales intérieures.
RBC souligne que l'économie est plus petite par habitant aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2019 (en tenant compte de l'inflation et de l'immigration), tandis que l'écart de productivité avec les États-Unis est d'environ 30 % ; cela correspond à environ 20 000 $ CA de production par personne et fait baisser les salaires d'environ 8 % par rapport aux niveaux américains. L'OCDE prévoit une faible croissance (de 1,0 à 1,1 %) pour 2025, alourdie par les tensions commerciales aux États-Unis, la baisse des exportations et des investissements, avec une productivité déjà faible, un endettement élevé des ménages et un marché immobilier tendu. TD et d'autres montrent que les baisses de productivité se sont propagées dans de nombreux secteurs depuis 2019 ; la construction est particulièrement faible et, en tant que part croissante de l'économie, elle pèse davantage sur les agrégats.
En bref, « l’écart de croissance » du Canada n’est pas seulement cyclique, mais structurel : une combinaison de faible productivité, de faible appétit pour l’investissement et d’obstacles structurels limite la croissance par habitant.
Comment le conflit commercial et les tarifs douaniers américains de 2025 affecteront-ils l’économie canadienne ?
L'escalade des tarifs douaniers américains début 2025, suivie de contre-mesures canadiennes et d'exemptions partielles ultérieures à l'AEUMC, a eu un impact significatif sur l'économie canadienne, axée sur les exportations. Les estimations de l'OCDE, de la TD et de la Banque du Canada font état d'une baisse significative des exportations, d'une réticence à investir, de pertes d'emplois dans les secteurs tributaires des exportations et d'une incertitude accrue, qui influencent les prévisions pour 2025-2026. La TD cite des exportations « martelées », une contraction de 1,6 % au deuxième trimestre et un ralentissement de la croissance à environ 1,2 % au cours de l'année. La Banque du Canada fait état d'une forte progression des exportations avant l'imposition des tarifs, suivie d'un effondrement, d'une hausse du chômage dans les secteurs sensibles aux échanges commerciaux et d'une légère composante inflationniste via les prix à l'importation, malgré une inflation globale proche de 2 %.
Même si une grande partie du commerce bilatéral est restée protégée des droits de douane grâce à la conformité à l'AEUMC, l'acier, l'aluminium et les mesures ciblées (ainsi que la modification des exemptions) ont entraîné des frictions dans les chaînes d'approvisionnement, des coûts plus élevés et une incertitude en matière de planification. Des études de simulation montrent que le maintien des droits de douane pourrait réduire le PIB du Canada d'environ 1 à 2 % au cours des années suivantes, selon les hypothèses concernant le niveau et la durée des droits de douane et des contre-mesures canadiennes. Le gouvernement canadien lui-même souligne les fardeaux imposés aux consommateurs et aux entreprises et a partiellement ajusté ou retiré les contre-mesures afin d'atténuer la hausse des prix intérieurs.
Conclusion : Le conflit commercial exacerbe les faiblesses cycliques (exportations, investissement, emploi) et interagit défavorablement avec les problèmes structurels de productivité.
Quel est l’état du marché du travail et des prix à la consommation – et que fait la Banque du Canada ?
Le marché du travail s'est sensiblement refroidi : le taux de chômage a augmenté de plus de 7 % en 2025 pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans ; les pertes d'emplois se concentrent dans les secteurs sensibles aux échanges commerciaux et dépendants des taux d'intérêt, tandis que la participation a légèrement diminué. Le rapport de la Banque du Canada pour l'été 2025 montre qu'une hausse tirée par les exportations au premier trimestre a été suivie d'une baisse d'environ 1,5 % au deuxième trimestre ; l'inflation sous-jacente était légèrement plus élevée (autour de 2,5 %) malgré une inflation globale proche de 2 %, notamment en raison des mesures de relance tarifaire.
La banque centrale a réagi en abaissant ses taux d'intérêt (la dernière fois à 2,5 % en septembre 2025), invoquant la faiblesse de l'économie nationale, le ralentissement de l'inflation sous-jacente et le démantèlement de certains contre-tarifs canadiens. Elle a également appelé à la prudence : l'inflation des prix des tarifs et l'incertitude limitent la marge de manœuvre pour un assouplissement agressif. La fourchette cible de 1 à 3 %, autour du point médian de la fourchette de 2 %, demeure le point d'ancrage ; la Banque du Canada met l'accent sur la symétrie et la flexibilité de cette cible, ainsi que sur le suivi d'un large éventail d'indicateurs du marché du travail.
En résumé, la politique monétaire soutient l'économie par un assouplissement modéré, mais ne peut neutraliser les contraintes structurelles et les risques liés à la politique commerciale. Les baisses de taux d'intérêt allègent la charge des intérêts et la pression sur les paiements, mais ne stimulent pas automatiquement le potentiel de production ni la demande d'exportation.
Pourquoi l’accessibilité au logement et aux loyers continue-t-elle d’être une crise aiguë ?
Malgré la baisse des taux d'intérêt, l'accession à la propriété reste inaccessible pour beaucoup. Depuis 2000, les prix ont augmenté nettement plus vite que les revenus, et le ratio prix/revenus est parmi les plus élevés de l'OCDE. Les experts citent comme principaux facteurs la financiarisation croissante du logement, les goulets d'étranglement de l'offre dans les segments et les zones géographiques pertinents, la part élevée des impôts et taxes dans la construction neuve, les goulets d'étranglement des capacités dans le secteur de la construction et, plus récemment, une très forte croissance démographique. Les prévisions n'annoncent pas de retour rapide à une accessibilité financière durable, même avec une baisse des taux hypothécaires.
Selon Reuters, bien que les taux d'intérêt fixes à cinq ans aient baissé de 150 points de base, les économies réalisées ne suffisent pas à compenser le niveau des prix et la faiblesse du pouvoir d'achat ; l'immigration et la demande intérieure maintiennent la pression à un niveau élevé. Selon les estimations, il faudra une décennie, voire jamais, avant qu'une accessibilité durable ne soit atteinte sans une expansion massive de l'offre et des réductions de coûts. La SCHL et d'autres acteurs préviennent que les mises en chantier de logements pourraient diminuer entre 2025 et 2027, malgré l'attention politique. Les associations professionnelles soulignent le poids cumulé des taxes et des frais, qui dépasse parfois le tiers du coût des nouvelles constructions, ainsi que les pénuries de terrains, de main-d'œuvre qualifiée et de matériaux.
Le débat sur la question de savoir s'il s'agit uniquement d'un « problème d'offre » est nuancé : plusieurs analyses indiquent qu'à long terme, l'offre a été relativement réactive, mais que la récente escalade a été exacerbée par des vagues de demande excessive, la participation des investisseurs et la financiarisation. Néanmoins, la situation actuelle exige que, pour faire baisser les prix et alléger la pression sur les marchés locatifs, la construction de logements abordables et adaptés doit augmenter significativement, et s'accompagner de réformes juridiques, institutionnelles et fiscales.
Quelles réponses apporte la politique canadienne en matière de logement et d’infrastructures?
Ottawa a considérablement élargi son programme pour 2024-2025 : le « Plan canadien sur le logement » met l'accent sur la construction, l'accélération de l'obtention des permis, la réduction des coûts, une plus grande normalisation (catalogues de conception), le développement des méthodes de construction préfabriquées et modulaires, le renforcement des voies d'accès à la location et à la propriété, et des logements ciblés pour lutter contre l'itinérance. La Stratégie nationale sur le logement (SNL), un programme décennal (115 milliards de dollars canadiens), prévoit la construction d'environ 170 000 nouveaux logements et de centaines de milliers de logements communautaires sécurisés d'ici la mi-2025. Parallèlement, les femmes, les étudiants, les aînés et les communautés autochtones sont spécifiquement visés.
Les nouveaux instruments axés sur la technologie et l'échelle comprennent un Fonds pour la technologie et l'innovation en construction résidentielle, 500 millions de dollars canadiens pour des projets de location modulaire, un catalogue national de conception de logements et la création de « Construire des maisons au Canada » (BCH), doté de 25 milliards de dollars canadiens de prêts et d'un milliard de dollars canadiens de capitaux propres pour soutenir la production préfabriquée, regrouper les commandes en gros, promouvoir le bois massif et les matériaux domestiques, et créer des possibilités de formation. Les effets attendus : jusqu'à 50 % de réduction des délais de construction, 20 % de réduction des coûts et 22 % de réduction des émissions par rapport à la construction traditionnelle.
Dans le même temps, une approche fondée sur les droits de l’homme prend de l’ampleur : la législation du NHS exige la mise en œuvre progressive du droit à un logement adéquat ; les recommandations actuelles appellent à des définitions claires, des systèmes cibles, une échelle de logements non marchands, une lutte contre la discrimination sur le marché locatif et des mécanismes de responsabilisation plus solides d’ici la fin de la période du NHS.
La rapidité de mise en œuvre demeure un défi : même les programmes ambitieux se heurtent à des goulots d’étranglement en matière de capacité de construction, à une réglementation fragmentée du bâtiment et à des responsabilités fédérales imbriquées. Sans harmonisation accrue, réformes rapides des permis, stratégies de main-d’œuvre qualifiée et volumes de commandes fiables et à long terme, la courbe de production ne devrait progresser que lentement.
Quelle est l’ampleur exacte du problème de productivité et quels en sont les leviers ?
Cette faiblesse se traduit par une baisse de la productivité du travail dans de nombreux secteurs depuis 2019, accentuée dans la construction et certains secteurs du secteur manufacturier. Des études quantifient la baisse de la productivité des entreprises canadiennes sur cinq ans, tandis qu'elle a connu une hausse significative aux États-Unis. L'intensité capitalistique a à peine augmenté ; les investissements en machines et équipements ont accusé un retard. Les causes de cette faiblesse sont diverses : faible intensité concurrentielle, obstacles réglementaires et fiscaux à l'investissement, barrières commerciales interprovinciales, lente adoption des technologies, répartition de la main-d'œuvre et pratiques de gestion.
Les orientations politiques et économiques qui sont en cours de discussion ou qui ont déjà été abordées comprennent :
- Réformes de la concurrence et suppression des barrières au commerce intérieur et à la mobilité entre les provinces et les territoires.
- Moderniser les régimes fiscaux et d’amortissement pour favoriser les investissements ; des avertissements ont été émis, par exemple, contre la suppression progressive de l’amortissement accéléré.
- Promotion ciblée de la diffusion de l’innovation et de l’adoption des technologies, notamment dans le secteur de la construction (normalisation, préfabrication, numérisation).
- Des initiatives en matière d’immigration, d’éducation et de formation hautement qualifiées, une meilleure reconnaissance des qualifications étrangères et une plus grande attention portée à la productivité dans les incitations du marché du travail.
- Accélérer les infrastructures et les permis pour tirer parti des économies d’échelle – du logement à l’énergie et aux matières premières.
En bref, ce qu’il faut, c’est un « programme de productivité » qui lie étroitement la concurrence, la formation de capital, la technologie et les compétences – un thème récurrent dans les discours des dirigeants de la Banque du Canada et dans les enquêtes de l’OCDE.
Quels défis budgétaires émergent ?
Bien que le Canada ait souvent été considéré comme financièrement solide par rapport aux pays du G7, les avertissements concernant la croissance des déficits, l'alourdissement du service de la dette et l'absence de cibles budgétaires se multiplient en 2025. Le directeur parlementaire du budget constate des écarts importants par rapport aux trajectoires budgétaires de 2024 ; l'augmentation des dépenses de programmes, les mesures fiscales et le ralentissement de la croissance entraînent une hausse significative des projections pour les années à venir. Les estimations indiquent que les paiements d'intérêts pourraient immobiliser une part nettement plus importante des recettes jusqu'en 2030. Des observateurs externes (p. ex., Fitch) soulignent les risques liés aux engagements de dépenses supplémentaires.
La marge de manœuvre demeure, mais elle est plus restreinte : une période prolongée de faibles taux d’intérêt directeurs n’est pas garantie ; le vieillissement de la population et les dépenses de santé pèsent déjà lourdement sur les budgets provinciaux. Si les investissements dans le logement, l’adaptation et l’innovation sont simultanément nécessaires, il est crucial de prioriser et d’appliquer des directives budgétaires pour éviter une perte de confiance. Les derniers rapports budgétaires mensuels montrent que les dépenses et les charges d’intérêt augmentent, tandis que certaines recettes fiscales s’affaiblissent temporairement ; les taxes douanières et énergétiques ont récemment fourni un contre-stimulus, mais reflètent la situation exceptionnelle.
Qu’en est-il des secteurs de l’énergie et des matières premières : opportunité ou risque ?
Le Canada dispose d'importantes capacités dans les secteurs du pétrole, du gaz et des matières premières. Ces secteurs contribuent substantiellement au PIB, aux exportations, aux recettes fiscales et à l'emploi, et servent de tampon pour la balance commerciale. Une augmentation des investissements dans le secteur en amont est également prévue en 2025. Parallèlement, le débat public réoriente ces secteurs en fonction des émissions, des goulots d'étranglement des infrastructures et des chaînes de valeur, notamment en ce qui concerne le GNL, les minéraux critiques et la transformation nationale.
Pour l’économie dans son ensemble, les ressources signifient :
- Stabilisateurs du commerce extérieur et de la monnaie (corrélation des prix du pétrole).
- Sources de revenus pour les budgets des États.
- Potentiel de diversification industrielle (par exemple, minéraux critiques, création de valeur pour les batteries, CCUS, bois massif dans la construction).
- Parallèlement, des tensions politico-économiques apparaissent (responsabilités fédérales/provinciales, objectifs environnementaux et climatiques, délais d’approbation, infrastructures d’exportation).
Le message principal : les ressources font partie intégrante de la stratégie à moyen terme, à condition que les processus de planification et d’approbation soient modernisés, que les objectifs climatiques soient intégrés de manière crédible et que les chaînes de valeur soient renforcées au niveau local.
Notre expertise industrielle et économique mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing
Notre expertise mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing - Image : Xpert.Digital
Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie
En savoir plus ici :
Un pôle thématique avec des informations et une expertise :
- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles
- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention
- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie
- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur
Repenser la migration : du levier quantitatif au levier qualitatif de la croissance économique
Quel rôle joue le logement dans la productivité, les prix et la stabilité sociale ?
La construction résidentielle repose sur deux leviers : un levier cyclique à court terme (activité de construction, emploi) et un levier structurel à long terme (mobilité de la main-d’œuvre, productivité, salaires réels). Des coûts de logement excessifs réduisent la mobilité spatiale, freinent la formation de ménages et pèsent sur les salaires réels. Des études montrent que la hausse des coûts de logement peut coûter des milliards de dollars en productivité si les travailleurs ne peuvent pas vivre dans des centres plus productifs. Les goulots d’étranglement du Canada en matière de capacité, d’autorisation et de calcul des coûts bloquent précisément ce levier.
Le gouvernement s’engage à :
- Harmonisation et normalisation (catalogues de conception, dialogue sur les réglementations de construction).
- Préfabrication/modularisation pour remédier aux déficits de productivité dans la construction.
- Mise à l’échelle du logement non marchand et mesures ciblées de protection des locataires (par exemple contre la discrimination).
- Initiatives de qualification pour le secteur de la construction (apprentissages, reconversion, immigration axée sur les compétences).
Les critères de réussite seront les suivants : une demande stable via des commandes groupées (BCH), des processus d’approbation rationalisés, un partage des risques avec les acteurs privés, une large adoption de normes de planification et de fabrication numériques et des effets de pipeline durables au-delà des frontières municipales.
Que se passe-t-il avec l’immigration et quel est son impact macroéconomique ?
Des niveaux élevés d'immigration ont soutenu les indicateurs macroéconomiques jusqu'en 2024-2025, mais ont accru la pression sur le logement, les soins de santé et les infrastructures. Ottawa a récemment recalibré ses objectifs, notamment pour les catégories de résidents temporaires (étudiants, travailleurs temporaires), afin de freiner la croissance. Les analystes avertissent qu'un ralentissement trop brutal pourrait avoir des effets secondaires négatifs sur le marché du travail, le financement de l'enseignement supérieur et les secteurs fortement dépendants de la main-d'œuvre temporaire. Les décideurs politiques recherchent donc une solution qui renforce les capacités d'intégration et d'absorption sans affaiblir indûment l'offre du marché du travail.
Du côté de la productivité, il est crucial d'améliorer la qualité de l'adéquation des compétences, d'accélérer les processus de reconnaissance et de favoriser une plus grande distribution dans les secteurs où les pénuries sont les plus fortes (par exemple, la construction, les soins infirmiers, les soins médicaux, l'ingénierie). Cela peut transformer l'immigration d'un « levier quantitatif » en un « levier de qualité et de productivité ».
Convient à:
- Réalignement sur le sujet d'une pénurie de travailleurs qualifiés - Le dilemme éthique dans la pénurie de travailleurs qualifiés (fuite des cerveaux): qui paie le prix?
Quelle est l’ampleur de la pression sur le système de santé et quelles sont les contre-mesures ?
Au Canada, le nombre de médecins par habitant est inférieur à celui des pays de l'OCDE ; les soins primaires en souffrent. Les ministères de la Santé et les associations professionnelles signalent un déficit de 22 000 à 23 000 médecins de soins primaires ; les nouveaux recrutements annuels ne suffisent pas à combler la pénurie. Cette situation aggrave les goulots d'étranglement de l'offre, les temps d'attente et les disparités régionales (rurales et urbaines), d'autant plus que le vieillissement de la population accroît la demande.
Les contre-mesures comprennent :
- Élargissement des places d’études et de résidence en médecine générale.
- Réforme des structures de rémunération et de pratique et réduction de la bureaucratie pour accroître l’attractivité et la capacité.
- Reconnaissance et intégration des médecins formés à l’étranger (si les normes de qualité sont respectées), éventuellement avec des incitations au placement régional.
- Recours aux soins en équipe, à la télémédecine et à la délégation aux infirmières pour tirer parti du temps limité des médecins.
La pénurie de soins de santé n’est pas seulement socialement importante, mais aussi économiquement : le manque de soins réduit l’offre de travail (maladie, soins), freine la productivité et augmente les dépenses publiques – et a des effets à la fois cycliques et structurels.
Comment le Canada aborde-t-il les risques liés au climat et à l’adaptation sur le plan économique ?
Les risques climatiques – feux de forêt, inondations, sécheresses – affectent les infrastructures, l’assurabilité, les capacités de production (p. ex., foresterie, agriculture, énergie), les coûts de santé et le logement. Le Canada a finalisé sa première Stratégie nationale d’adaptation (SNA) en 2023, accompagnée d’un plan d’action pluriannuel du gouvernement fédéral comportant des cibles, des indicateurs et des instruments de financement (notamment le FAAC, les initiatives locales d’adaptation, des avenirs résilients aux feux de forêt, des cartes d’inondation modernes et des mesures visant à promouvoir la résilience des communautés autochtones). L’OCDE recommande des investissements accélérés, un allègement pour les municipalités et les provinces ayant de faibles exigences en matière de demande, et l’utilisation de normes (construction, aménagement du territoire) en prévision des risques climatiques futurs. Les approches PPP peuvent atténuer les risques pour les entreprises du secteur privé ; dans certains cas, la fourniture publique de biens publics est essentielle.
Parallèlement, des politiques de réduction des émissions (CDN, législation zéro émission nette, tarification du carbone et ses récents amendements) sont mises en œuvre. En 2025, la taxe sur les carburants a été ajustée ; les dispositifs sectoriels (OBPS) restent en place pour inciter à la réduction des émissions. La politique climatique et la politique d'adaptation doivent être cohérentes afin d'accroître la sécurité des investissements et de limiter les coûts de trajectoire.
Comment les grandes banques, les groupes de réflexion et les autorités statistiques évaluent-ils la situation en 2025 ?
- RBC, TD et S&P anticipent une croissance inférieure à la tendance, une hausse du chômage, des tarifs douaniers et des faiblesses structurelles de la productivité. À l'échelle provinciale, l'Ontario et le Québec sont particulièrement exposés dans les secteurs manufacturier et commercial, tandis que les provinces productrices de ressources disposent de marges budgétaires, mais demeurent volatiles sur le plan cyclique.
- L’OCDE prévoit une croissance faible en 2025-2026 et appelle à des trajectoires de productivité structurelles (investissement, innovation, barrières commerciales internes) et à des trajectoires de politique monétaire prudentes.
- Statistique Canada et les données commerciales indiquent un déclin de l'emploi et des exportations en 2025, suivi d'une période de résilience de la consommation, suivie d'un ralentissement. Le chômage se situe autour de 7 %, le taux de chômage des jeunes étant supérieur à la moyenne.
- La Banque du Canada documente le dilemme tarifaire : ralentissement de la croissance au deuxième trimestre, inflation sous-jacente temporairement plus élevée, baisses prudentes des taux d’intérêt en réponse à la faiblesse et diminution des contre-mesures.
Où sont les plus grands risques immédiats ?
- Poursuite ou renouvellement de l’escalade tarifaire, qui pèse davantage sur le climat d’exportation et d’investissement.
- Faiblesse persistante de la productivité et réticence à investir – risques à long terme pour les salaires réels et les services.
- Le secteur du logement stagne parce que le financement, la capacité, la charge fiscale et les processus d’approbation empêchent une mise à l’échelle rapide, avec des boucles de rétroaction négatives sur la mobilité, la productivité et la cohésion sociale.
- Orientation des dépenses budgétaires sans ancrages budgétaires – la hausse des dépenses d’intérêts bloque la marge de manœuvre, les provinces sont sous pression démographique et de santé.
- Les goulots d’étranglement du système de santé aggravent les pénuries de main-d’œuvre et les coûts sociaux, réduisant ainsi l’attractivité des lieux de résidence.
Et les plus grandes opportunités à moyen et long terme ?
- La construction de logements comme levier de productivité et de société : la standardisation, l’industrialisation (modulaire), l’approvisionnement de masse coordonné (BCH), les réglementations de construction harmonisées et les stratégies ciblées de main-d’œuvre qualifiée peuvent briser les courbes de coûts et de délais.
- Programme de productivité : concurrence, réforme de la fiscalité et de l’amortissement, offensives technologiques et financières, réduction des barrières commerciales internes – en particulier dans les secteurs à faible productivité comme la construction.
- Stratégie en matière de ressources : GNL, minéraux critiques, raffinage, CCUS – si la planification, les permis et les infrastructures d’exportation sont modernisés et si les objectifs climatiques sont intégrés de manière crédible.
- L’adaptation climatique comme prime d’assurance pour la croissance : les infrastructures résilientes réduisent les pertes économiques et augmentent l’attractivité du capital et du travail.
- Migration intelligente et compétences : immigration de personnes hautement qualifiées, reconnaissance accélérée, mise en relation dans les secteurs en pénurie – de l’effet volume à l’effet productivité.
Quelles mesures concrètes le Canada a-t-il prises récemment pour contrer ce phénomène ?
- Politique monétaire : baisse des taux d'intérêt à 2,5 %, perspectives prudentes ; la Banque du Canada met l'accent sur l'objectif de 2 %, la symétrie flexible et la surveillance complète du marché du travail.
- Logement : Plan canadien pour le logement, mise en œuvre du SNL, fonds technologiques, logements locatifs modulaires, catalogue de conception, Construire des maisons au Canada (25 milliards de prêts/1 milliard de capitaux propres), approche anti-discrimination et droits.
- Commerce : Calibrage et démantèlement partiel des contre-tarifs pour freiner l’inflation ; efforts diplomatiques pour désamorcer la situation ; et mesures de protection pour les secteurs et régions touchés.
- Productivité/Innovation : Crédits d’investissement pour les secteurs verts (dans le cadre de la réponse de l’IRA), appels et programmes visant à renforcer la compétitivité, l’adoption de technologies et l’intégration du marché intérieur (recommandations de l’OCDE).
- Politique budgétaire : Orientation vers le logement et les programmes sociaux, mais sous une pression croissante pour définir des ancrages budgétaires et une discipline des dépenses ; suivi via le « Moniteur budgétaire ».
- Climat/Adaptation : Stratégie nationale d’adaptation et plan d’action doté de fonds de plusieurs milliards de dollars (DMAF), initiatives locales, cartographie des inondations, programmes de lutte contre les incendies de forêt ; évaluation régulière et plans bilatéraux.
Comment les impacts régionaux diffèrent-ils ?
L'Ontario et le Québec subissent une part importante des chocs commerciaux en raison de leurs liens industriels et d'exportation avec les États-Unis ; les pressions sur le marché du travail y sont également plus marquées. RBC souligne les perturbations de la production dans l'industrie automobile, la hausse des défauts de paiement des prêts hypothécaires et des prêts en période de ralentissement du marché du travail, et la baisse des ventes immobilières malgré la baisse des taux d'intérêt. Au Manitoba, les risques climatiques (incendies, sécheresse) ont également des répercussions sur l'agriculture et les services publics. Les provinces ressources (Alberta, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador) affichent des niveaux de productivité plus élevés, mais sont exposées aux produits de base cycliques. Les régions de l'Atlantique et des territoires sont parfois plus durement touchées par les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et de soins de santé.
Y a-t-il des signes d’apaisement dans certains domaines ?
En 2025, l'inflation était proche ou inférieure à 2 % dans certaines régions, ce qui a laissé une marge de manœuvre à la politique monétaire. Certains agrégats de consommation ont enregistré des performances supérieures aux prévisions en début d'année ; ils ont ensuite ralenti. Les indicateurs individuels laissent entrevoir une marge de reprise si le conflit commercial s'apaise. Néanmoins, la croissance globale reste inférieure à la tendance et faible par habitant ; le chômage reste proche de 7 % et la productivité ne montre aucun signe d'inversion. Les coûts du logement continuent de baisser ; un retour rapide à une accessibilité financière « normale » est peu probable, sauf en cas d'augmentation spectaculaire des taux d'achèvement.
Quelles priorités sont nécessaires pour que les contre-mesures soient efficaces ?
- Des conditions-cadres fiables pour le commerce extérieur stabilisent les exportations, les investissements et l'emploi. Même une désescalade partielle réduit l'incertitude et soutient les investissements.
- Un programme cohérent de productivité – réforme de la fiscalité et des amortissements, intensification de la concurrence, suppression des barrières internes et initiatives technologiques et numériques axées sur les secteurs à faible productivité comme la construction – est nécessaire. Sans augmentation du capital par habitant, de meilleures incitations et la diffusion de nouvelles méthodes, l'écart persistera.
- Développer la construction résidentielle en tant que projet industriel – normalisation, préfabrication, commande en gros (BCH), harmonisation des codes, procédures plus rapides, croissance de la main-d’œuvre qualifiée et réformes fiscales/taxe pour atteindre les coûts cibles et utiliser les chaînes de production.
- Réorientation des priorités et ancrages budgétaires – donner la priorité à ce qui augmente la productivité et la résilience sociale (logement, adaptation, compétences) tout en maintenant les taux de croissance des dépenses de consommation sous contrôle et les charges d’intérêts soutenables.
- L’élargissement des capacités du système de santé – parcours de formation, pratiques de reconnaissance, soins en équipe et réduction des charges administratives ; les soins primaires, en particulier, sont un facteur essentiel pour l’employabilité et la cohésion sociale.
- Infrastructures résilientes au changement climatique – de la gestion des feux de forêt et de la protection contre les inondations aux normes de construction et d'aménagement du territoire. L'adaptation atténue les chocs économiques et renforce l'attractivité des territoires.
Quel rôle joue la politique industrielle, par exemple dans les secteurs verts ?
Les crédits d'impôt à l'investissement (CII) pour les technologies propres, l'hydrogène, le CCUS, les minéraux critiques et l'industrie manufacturière visent à combler le déficit d'investissement et à développer les chaînes de valeur, notamment en réponse à la loi américaine sur la réduction de l'inflation. L'OCDE y voit un potentiel, mais met en garde contre la qualité de la mise en œuvre, la précision et la viabilité budgétaire. Les facteurs clés sont l'accélération de l'approbation, l'infrastructure du réseau, la main-d'œuvre qualifiée et la demande du marché. Une politique industrielle davantage axée sur la productivité devrait également favoriser la diffusion, et pas seulement les projets phares.
Que peuvent faire les provinces et les municipalités pour renforcer les initiatives fédérales?
- Harmoniser les réglementations de construction et les règles d’urbanisme, rendre les allocations de densité, les conversions et les plans standards largement accessibles ; réduire les obstacles au marché intérieur.
- Testez les approbations numériques (guichet unique), les délais contraignants et les éléments « le silence vaut consentement ».
- Revoir les taxes sur la construction et les lier à des objectifs d’efficacité et sociaux ; rendre les structures tarifaires plus transparentes et axées sur la performance.
- Coordonner le regroupement des commandes avec BCH/CMHC pour assurer une utilisation prévisible des préfabricants.
- Développer les capacités régionales en matière de santé et d’éducation pour assurer une intégration productive des immigrants.
- Inclusion obligatoire des cartes des risques climatiques locaux dans la planification et les normes de développement urbain.
Dans quelle mesure un retournement de situation notable d’ici 2027 est-il réaliste ?
Un véritable redressement nécessite des progrès parallèles en matière de commerce et d'insécurité, de production de logements, de réformes de la productivité, de priorisation budgétaire et de capacité de soins de santé. La Banque du Canada prévoit une reprise progressive jusqu'en 2027 (croissance possible jusqu'à environ 1,8 %) dans un scénario de désescalade, tandis qu'un scénario d'escalade annonce une récession et une inflation temporairement plus élevée. Cependant, sans amélioration de la productivité, la croissance par habitant restera stagnante, même avec un assouplissement de la politique commerciale.
Le plus grand levier réside dans :
- mise à l'échelle rapide des processus de construction de logements productifs (modulaire, standardisation),
- suppression systématique des obstacles à la croissance et à l’investissement,
- un ancrage budgétaire clair qui protège les futurs domaines d’investissement,
- planification de la politique commerciale,
- et une offensive sanitaire qui retient et active la main d’œuvre.
Bref aperçu : Quels seraient les « premiers signaux » indiquant que le Canada est sur la bonne voie ?
- Forte augmentation soutenue des projets approuvés et lancés dans les catégories standardisées/modulaires, diminution des délais de construction et réductions de coûts mesurables par rapport aux méthodes traditionnelles.
- Rebond des investissements non résidentiels, notamment dans les machines/équipements et les biens matériels améliorant la productivité ; augmentation de l’intensité capitalistique par employé.
- Améliorer les indicateurs de productivité dans la construction et certains services ; combler les écarts par rapport aux références américaines.
- Tendances à la désescalade des échanges commerciaux (réduction de la dispersion tarifaire, exemptions fiables, prévisibilité de la conformité à l’AEUMC).
- Des lignes directrices budgétaires stables donnant la priorité au logement, à l’adaptation, à l’innovation et aux compétences, tout en contrôlant la charge des intérêts.
- Augmentation des flux de formation/résidences médicales, reconnaissance plus rapide des qualifications internationales, soutien des équipes en soins primaires.
Quels sont les plus grands problèmes et comment le Canada les aborde-t-il?
Les principaux défis sont une productivité structurellement faible accompagnée d'une baisse de la richesse par habitant, une crise persistante de l'accessibilité au logement, un marché du travail en difficulté et une hausse du chômage, le revers économique et de planification causé par le conflit commercial avec les États-Unis, les tensions budgétaires et les goulots d'étranglement en matière de santé et d'adaptation aux changements climatiques. Le Canada s'attaque à ces défis grâce à une stratégie à plusieurs volets : un assouplissement monétaire prudent, un vaste programme de logement axé sur la technologie et la normalisation (y compris le programme Construire des maisons au Canada), des mesures incitatives à l'investissement et à l'innovation, un perfectionnement des migrations et des compétences, une stratégie nationale d'adaptation et des efforts pour atténuer les risques liés à la politique commerciale. La réussite dépend d'une accélération significative de la productivité et de la construction de logements, ainsi que de la concentration des ressources budgétaires sur ces leviers d'avenir. Si cela réussit, le Canada pourra, malgré les vents contraires extérieurs, retrouver une croissance plus robuste et inclusive.
Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial
☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand
☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !
Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital
J'attends avec impatience notre projet commun.
☑️ Accompagnement des PME en stratégie, conseil, planification et mise en œuvre
☑️ Création ou réalignement de la stratégie digitale et digitalisation
☑️ Expansion et optimisation des processus de vente à l'international
☑️ Plateformes de trading B2B mondiales et numériques
☑️ Pionnier Développement Commercial / Marketing / RP / Salons
🔄📈 Support des plateformes de trading B2B – planification stratégique et soutien aux exportations et à l'économie mondiale avec Xpert.Digital 💡
Plateformes de trading B2B - Planification stratégique et accompagnement avec Xpert.Digital - Image : Xpert.Digital
Les plateformes commerciales interentreprises (B2B) sont devenues un élément essentiel de la dynamique commerciale mondiale et donc une force motrice pour les exportations et le développement économique mondial. Ces plateformes offrent des avantages significatifs aux entreprises de toutes tailles, en particulier aux PME – petites et moyennes entreprises – qui sont souvent considérées comme l’épine dorsale de l’économie allemande. Dans un monde où les technologies numériques prennent de plus en plus d’importance, la capacité d’adaptation et d’intégration est essentielle pour réussir dans la concurrence mondiale.
En savoir plus ici :