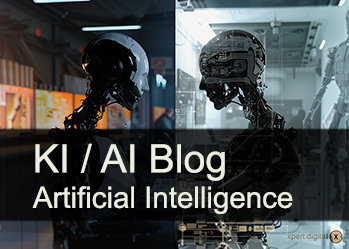La recherche Google à l'ère de l'intelligence artificielle : une réorientation économique de l'économie de l'information numérique
Version préliminaire d'Xpert
Sélection de voix 📢
Publié le : 13 novembre 2025 / Mis à jour le : 13 novembre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein

La recherche Google à l'ère de l'intelligence artificielle : une réorientation économique de l'économie de l'information numérique – Image : Xpert.Digital
La transformation structurelle d'un empire : la domination du marché sous pression ?
L’intelligence artificielle : une menace immédiate pour le modèle économique classique des moteurs de recherche ou un développement stratégique d’un marché déjà dominé ?
Au premier trimestre 2025, Google se présente toujours officiellement comme le maître incontesté du paysage mondial de la recherche. Avec une part de marché de 91,55 %, l'entreprise traite environ 8,9 milliards de requêtes par jour, soit près de 103 000 requêtes par seconde, pour un total de 2 600 milliards par an. Sur les appareils mobiles, Google conserve une position quasi hégémonique avec une part de marché de 96,3 %. Ces chiffres donnent l'image d'une domination incontestable, mais derrière cette apparente simplicité se cache une réalité bien plus complexe et instable, marquée par de profonds bouleversements économiques. La part de marché, à elle seule, masque une transformation fondamentale de la relation de valeur entre le volume de recherches, le comportement des utilisateurs et les revenus générés.
Au cours des derniers mois de 2024, un phénomène rare s'est produit : la part de marché mondiale de Google est passée sous le seuil symbolique de 90 % pour la première fois en dix ans. En octobre 2024, elle s'établissait à 89,34 %, en novembre à 89,99 % et en décembre à 89,73 %. Il s'agit du premier repli durable sous ce seuil depuis 2015. Si les analystes attribuent en partie ce déclin à des changements régionaux en Asie, cette évolution témoigne de la convergence de plusieurs forces structurelles qui commencent à déstabiliser profondément l'écosystème traditionnel des moteurs de recherche. Il s'agit moins d'un exode massif des utilisateurs actuels que d'une transformation des comportements de recherche et des facteurs économiques de réussite qui y sont associés.
Le modèle économique de Google repose sur une architecture élégante, mais de plus en plus fragile. En 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires total d'environ 307 milliards de dollars, dont près de 175 milliards provenaient de la publicité sur les moteurs de recherche. Cela représente non seulement 57 % du chiffre d'affaires total, mais constitue également le pilier financier de toute sa structure. Le fonctionnement de ce modèle est simple, mais efficace : les utilisateurs formulent des requêtes de recherche avec une intention d'achat explicite ou implicite ; Google affiche des publicités d'annonceurs qui paient au clic ; les utilisateurs cliquent sur ces publicités ou sur les résultats de recherche naturels ; et un marché à trois acteurs se crée entre les utilisateurs, les éditeurs et les annonceurs.
Cette architecture est fondamentalement remise en question par l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment à travers la technologie des « aperçus de l'IA ».
Aperçus de l'IA comme destructeur de modèles commerciaux : les indicateurs du déclin
L'introduction des aperçus IA par Google marque un tournant. Cette technologie présente aux utilisateurs des résumés d'informations synthétisés par des modèles génératifs, directement sur la page de résultats de recherche, sans qu'ils aient besoin de cliquer sur des sites externes. Son déploiement a été remarquablement rapide : en janvier 2025, les aperçus IA apparaissaient dans 6,49 % des requêtes. En mars 2025, cette part avait doublé pour atteindre environ 13,14 %. Cela signifie qu'aujourd'hui, dans plus d'une recherche Google sur sept sur le marché américain, la collecte d'informations par synthèse IA est effectuée avant même que l'utilisateur n'active un résultat de recherche organique classique ou une publicité payante.
Les conséquences économiques de cette expansion sont rapidement apparues. Les taux de clics, indicateur fondamental de tous les modèles économiques du capitalisme numérique, ont réagi de façon spectaculaire. Pour les requêtes de recherche utilisant les aperçus de l'IA, le taux de clics organiques a chuté de 1,76 % en juin 2024 à 0,61 % en septembre 2025. Cela représente une baisse d'environ 65 %, soit, en termes commerciaux, la valeur du « clic sur un résultat de recherche organique » est devenue environ deux tiers plus volatile sous l'effet de l'intelligence artificielle. Parallèlement, les publicités de recherche payantes ont connu une baisse encore plus drastique : le taux de clics s'est effondré de 19,7 % à 6,34 %, soit une réduction de 68 %.
L'interaction entre ces deux effets est particulièrement remarquable : la baisse des taux de clics due aux aperçus IA ne se limite pas aux requêtes de recherche où ces aperçus sont affichés. Les taux de clics organiques ont également chuté d'environ 41 % sur un an pour les requêtes de recherche sans aperçus IA. Cela suggère un effet comportemental plus profond : les utilisateurs modifient fondamentalement leurs habitudes d'interaction. Ils apprennent que les résultats de recherche sont de moins en moins pertinents, car les systèmes d'IA fournissent déjà les réponses sur la page de résultats. D'un point de vue théorique, cet effet d'apprentissage pourrait être interprété comme une forme d'aversion irrationnelle au risque ou de formation de routines ; en réalité, cependant, les utilisateurs réagissent rationnellement à un paysage informationnel en pleine transformation.
Les effets cumulés de cette transformation sont d'une brutalité saisissante. La proportion de « recherches sans clic » (c'est-à-dire les recherches qui n'aboutissent pas à un clic sur un résultat externe) a bondi de 56 % à 69 %. À l'inverse, seulement 31 % des requêtes de recherche mènent désormais à un clic sur une destination externe. Pour les éditeurs et les créateurs de contenu, cela représente une perte de trafic catastrophique. Une analyse de Similarweb a révélé que le trafic organique vers les sites d'actualités a chuté de plus de 2,3 milliards de visites mensuelles à moins de 1,7 milliard en un an, soit une perte d'environ 600 millions de visites par mois, ou environ 26 % du volume de trafic précédent. Certains éditeurs font état de chiffres encore plus alarmants : un grand magazine américain de style de vie a constaté une baisse de son taux de clics de 5,1 % à 0,6 %, soit une réduction d'environ 88 %.
Il ne s'agit pas d'une évolution progressive du paysage des moteurs de recherche, mais d'une véritable révolution. Pour Google, la situation est à double tranchant et paradoxale : d'une part, l'intégration de la vue d'ensemble par l'IA entraîne une baisse du nombre de clics ; d'autre part, Google résiste aux pressions pour déployer cette fonctionnalité, arguant que chaque clic non perdu au profit de ChatGPT est précieux, et que, par conséquent, même un nombre réduit de clics vaut mieux que rien. Une note interne de Google, qui a été divulguée, a résumé cette tension : Google préfère perdre des recherches en baisse au profit de Gemini (son modèle d'IA propriétaire) plutôt qu'au profit de ChatGPT, car cela lui permettrait de conserver ses utilisateurs au sein de son écosystème. Autrement dit, Google risque une diminution à moyen terme de son trafic monétisable afin de maintenir sa position dominante sur le marché face à ses concurrents basés sur l'IA décentralisée.
Cette stratégie illustre un dilemme fondamental du capitalisme de plateforme : lorsque la mesure traditionnelle de la valeur – le nombre de clics – est mise à rude épreuve, il est impératif de développer des voies alternatives de création de valeur. Google expérimente cette approche en développant AI Mode, une expérience de recherche conversationnelle plus complète, conçue pour générer un engagement utilisateur à long terme. Le modèle économique évolue des modèles transactionnels (« clics sur une publicité ») vers des modèles potentiellement plus intégrés, voire par abonnement. La projection des revenus du marketing de recherche pour 2025, à environ 190,6 milliards de dollars – soit une augmentation d’environ 7 % par rapport à 2024 – témoigne d’un optimisme modéré au regard de ces tendances. Cependant, cette croissance devrait principalement s’accompagner de hausses de prix (augmentation du coût par clic) plutôt que d’une augmentation des volumes.
La philosophie produit de Robby Stein : de Snapchat à la recherche par IA
Dans ce contexte, la biographie et la stratégie produit explicite de Robby Stein, vice-président des produits chez Google Search, prennent une importance particulière. Stein est devenu une figure clé de la tentative de Google d'orchestrer la transformation de la recherche. Son parcours professionnel est révélateur pour comprendre la logique stratégique qui sous-tend les projets d'intelligence artificielle.
Stein est connu pour avoir développé Instagram Stories. Cette décision produit offre une étude de cas instructive sur le développement de produits en contexte d'incertitude extrême et sur la manière dont les plateformes établies peuvent neutraliser leurs concurrents grâce à des copies « suffisamment bonnes ». En 2013, Snapchat a lancé les « Stories », une fonctionnalité novatrice de contenu éphémère qui disparaît automatiquement. Techniquement élégante, cette innovation a bouleversé les habitudes des utilisateurs, créant une nouvelle catégorie d'interaction sur les réseaux sociaux. Snapchat a atteint environ 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en 2016. Instagram, déjà intégré à l'écosystème Facebook et revendiquant plus de 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, a copié cette fonctionnalité le 2 août 2016.
Les conséquences furent désastreuses pour Snapchat. En six mois, Instagram Stories atteignit plus de 150 millions d'utilisateurs quotidiens. Le nombre de vues des Snapchat Stories chuta de 15 à 40 %. En moins d'un an, Snapchat était quasiment neutralisé sur ce segment. Ce qui distinguait Instagram Stories de Snapchat Stories n'était pas une supériorité technique, mais une supériorité opérationnelle : Instagram a intégré la fonctionnalité à un écosystème déjà dominant, offrait de meilleures analyses aux créateurs, permettait le marquage des marques et des utilisateurs (fonctionnalité absente chez Snapchat) et s'appuyait sur une infrastructure technique existante. C'était un exemple typique d'économie de plateforme : l'échelle, les capacités d'intégration et l'excellence opérationnelle ont primé sur l'innovation sur des marchés fragmentés.
Dans des entretiens récents, Stein décrit sa philosophie de développement produit comme étant guidée par trois éléments fondamentaux : premièrement, « l’amélioration continue », une recherche constante d’optimisation itérative ; deuxièmement, une compréhension approfondie du comportement des utilisateurs au sein de systèmes technologiques complexes ; troisièmement, la capacité à prendre des décisions contre-intuitives lorsque les données l’exigent.
Cette philosophie se manifeste dans la stratégie de Google en matière d'IA. Stein a déclaré publiquement que Google a identifié trois composantes essentielles de la « recherche de nouvelle génération » : les aperçus IA (des résumés rapides générés par l'IA), la recherche multimodale (images, vidéos, Lens) et le mode IA (une expérience de recherche conversationnelle et interactive inédite chez Google). Ces trois éléments sont destinés à converger pour créer une expérience de recherche plus fluide et plus complète.
La rapidité de mise en œuvre est remarquable. AI Mode est passé du concept au lancement en un an environ, ce qui est exceptionnellement rapide pour une entreprise de cette taille. Cela illustre comment les nouveaux responsables produits chez Google, explicitement guidés par les principes de Stein, parviennent à surmonter les lourdeurs organisationnelles traditionnelles.
La philosophie de Stein présente toutefois une faiblesse structurelle : elle conçoit l’« amélioration continue » comme un processus centré sur le produit lui-même, et non sur ses effets écosystémiques et distributifs. D’un point de vue purement utilisateur, les aperçus agressifs fournis par l’IA peuvent représenter un accès « amélioré » à l’information. Mais du point de vue des éditeurs et de l’écosystème web dans son ensemble, qui repose sur la génération de clics, ils constituent une intervention néfaste. Ceci crée un dilemme : le chef de produit, soucieux de susciter un enthousiasme maximal chez les utilisateurs, risque simultanément de compromettre le modèle économique de l’entreprise, car l’expérience utilisateur et la rentabilité ne sont pas cohérentes.
Dispersion académique : trois piliers d'une transformation fragmentée
Dans des entretiens récents, Stein a proposé un cadre conceptuel pour les transformations du paysage de la recherche : trois piliers non équivalents. Cette catégorisation est plus significative qu’il n’y paraît au premier abord, car elle révèle comment Google appréhende en interne la fragmentation de sa stratégie de recherche.
Le premier pilier est celui des aperçus IA. Il s'agit de résumés d'informations générés par l'IA et présentés sur la page de résultats de recherche. Leur fonctionnement repose sur un modèle Gemini spécialisé (le modèle de langage propriétaire de Google) qui interprète la requête, exécute une stratégie de recherche (appelée « diffusion de requêtes ») dans laquelle le modèle formule et exécute automatiquement plusieurs dizaines de requêtes auxiliaires pour recueillir du contexte, puis génère une réponse structurée. Les aperçus IA sont conçus pour les requêtes informationnelles telles que « température de l'eau bouillante », « meilleurs restaurants à Berlin » ou « comment fonctionne le Bitcoin ». Ils sont moins adaptés aux requêtes de navigation (lorsqu'un utilisateur recherche une destination précise) et moins performants pour les requêtes commerciales prioritaires (intention d'achat), car les formats publicitaires traditionnels et les listes de produits restent plus efficaces dans ces domaines.
Le deuxième pilier est la recherche multimodale, principalement assurée par Google Lens. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches visuelles : ils prennent une photo d'un objet, puis demandent à Google de quoi il s'agit, comment le réparer et où l'acheter. La croissance de Google Lens est impressionnante : 15 % par an, pour atteindre environ 20 milliards de requêtes mensuelles. Ce pilier est essentiel car il démontre que la recherche Google ne se limite pas au texte ; les modes d'interaction se diversifient.
Le troisième pilier est le Mode IA. Il s'agit de l'expérimentation la plus récente et la plus ambitieuse sur le plan conceptuel. Alors que les Aperçus IA privilégient les réponses directes (question → réponse → fin), le Mode IA fonctionne selon une interaction conversationnelle plus approfondie. Un utilisateur peut poser des questions complexes en plusieurs étapes (« Je cherche un restaurant à Berlin, mon ami est allergique aux arachides, je souhaite une terrasse, budget d'environ 60 euros par personne »), et le Mode IA fournira des recommandations étape par étape, les précisera et les affinera, et proposera des alternatives. Il s'agit moins d'un moteur de recherche que d'un agent d'information interactif.
Cette différenciation de la stratégie de recherche en trois modes non entièrement équivalents reflète une méta-stratégie axée sur la flexibilité et le choix. Google s'abstient de définir une « nouvelle recherche » monolithique et propose plutôt un ensemble de modes de recherche répondant à différents types de requêtes et aux préférences des utilisateurs. Cette approche est stratégiquement judicieuse car elle permet de miser simultanément sur plusieurs pistes sans s'engager dans une innovation unique qui pourrait ne pas rencontrer le succès escompté.
Toutefois, cette stratégie de portefeuille révèle également une profonde incertitude. Monétiser une expérience de recherche fragmentée est plus complexe que de monétiser une architecture unifiée. Lorsque les utilisateurs ont le choix entre différents modes, leurs attentes sont instables, ce qui engendre un taux de désabonnement élevé. De plus, si Google propose différents modes en interne, l'un risque de cannibaliser l'autre.
Support B2B et SaaS pour SEO et GEO (recherche IA) combinés : la solution tout-en-un pour les entreprises B2B

Support B2B et SaaS pour SEO et GEO (recherche IA) combinés : la solution tout-en-un pour les entreprises B2B - Image : Xpert.Digital
La recherche IA change tout : comment cette solution SaaS révolutionne à jamais vos classements B2B.
Le paysage numérique des entreprises B2B est en pleine mutation. Sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, les règles de la visibilité en ligne sont en pleine mutation. Être visibles dans la masse numérique, mais aussi être pertinentes auprès des décideurs pertinents, a toujours été un défi pour les entreprises. Les stratégies traditionnelles de référencement et de gestion de la présence locale (géomarketing) sont complexes, chronophages et souvent confrontées à des algorithmes en constante évolution et à une concurrence féroce.
Et s'il existait une solution qui non seulement simplifie ce processus, mais le rende aussi plus intelligent, plus prédictif et bien plus efficace ? C'est là qu'entre en jeu l'association d'un support B2B spécialisé et d'une puissante plateforme SaaS (Software as a Service), spécialement conçue pour les besoins du SEO et de l'optimisation pour les moteurs de recherche (GEO) à l'ère de l'IA.
Cette nouvelle génération d'outils ne repose plus uniquement sur l'analyse manuelle des mots clés et les stratégies de backlinks. Elle exploite désormais l'intelligence artificielle pour comprendre plus précisément l'intention de recherche, optimiser automatiquement les facteurs de classement locaux et réaliser une analyse concurrentielle en temps réel. Il en résulte une stratégie proactive, basée sur les données, qui confère aux entreprises B2B un avantage décisif : elles sont non seulement trouvées, mais aussi perçues comme faisant autorité dans leur niche et leur zone géographique.
Voici la symbiose entre le support B2B et la technologie SaaS basée sur l'IA qui transforme le marketing SEO et GEO et comment votre entreprise peut en bénéficier pour croître durablement dans l'espace numérique.
En savoir plus ici :
Comment l'architecture de Gemini redéfinit la recherche : gagnants, perdants et modèles économiques
La chambre d'écho du modèle Gemini : architecture technique et ses implications commerciales
L'architecture technique sous-jacente de Gemini, le modèle d'IA qui alimente le mode IA, les aperçus IA et la recherche multimodale, est essentielle pour comprendre pourquoi Google impulse cette transformation. Contrairement à de nombreux modèles de langage, Gemini est conçu dès le départ pour être multimodal. Cela signifie que le modèle intègre le texte, les images, l'audio et la vidéo dans un seul réseau neuronal, au lieu d'ajouter ces modalités ultérieurement. D'un point de vue théorique, cela confère à Gemini une élégance structurelle indéniable.
Techniquement, Gemini utilise une architecture de type transformateur-décodeur, optimisée pour l'efficacité. Le modèle s'exécute sur les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google Cloud, ce qui confère à Google un avantage concurrentiel en matière de vitesse d'inférence : Google peut exécuter des modèles d'IA plus rapidement et à moindre coût que ses concurrents utilisant des infrastructures cloud classiques. Gemini est capable d'effectuer un raisonnement en chaîne : il peut décomposer des problèmes complexes en plusieurs étapes conceptuelles avant de formuler une réponse. Ceci permet des structures logiques plus profondes que la génération superficielle de jetons des modèles de langage (LLM) précédents.
Surtout, Gemini est intégré aux bases de données propriétaires de Google. Le Shopping Graph de Google contient environ 50 milliards de produits, mis à jour 2 milliards de fois par heure grâce aux flux des marchands. Google a accès à 250 millions de points de vente et à des informations cartographiques. Google a également accès à des données financières, aux informations boursières en temps réel et à l'ensemble du Web comme source de contexte. Ces bases de données ne sont pas publiques ; ce sont des ressources propriétaires accessibles uniquement à Google. Cela confère à Gemini (et donc au mode IA, aux aperçus IA, etc.) un avantage fondamental dont ne disposent pas ses concurrents comme ChatGPT ou Perplexity. OpenAI doit s'appuyer sur des données publiques et des données récupérées via des API. Perplexity doit recourir au web scraping. Google, quant à lui, possède déjà ces données en interne.
Cette architecture illustre pourquoi l'intégration de l'IA chez Google doit être considérée comme stratégiquement nécessaire, et non comme une simple option. L'infrastructure est déjà en place. Les données sont déjà disponibles. La capacité de calcul est déjà disponible. La décision économiquement rationnelle consiste à exploiter ces ressources. La seule question est de savoir dans quelle mesure la monétisation doit être menée, compte tenu des répercussions sur le modèle économique traditionnel.
Le problème de la perplexité : la concurrence dans le bruit
Un aspect souvent négligé du débat sur la recherche par IA est le rôle de Perplexity AI. Fondée en 2022 par Aravind Srinivas, un ancien stagiaire de Google, Perplexity se positionne explicitement comme une interface de recherche nativement basée sur l'IA. En août 2024, Perplexity comptait environ 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L'entreprise prévoyait un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars pour 2024. OpenAI, quant à elle, anticipait un chiffre d'affaires d'environ 11,6 milliards de dollars pour 2025 grâce à ses API et à l'exploitation commerciale de ChatGPT Search.
Cependant, les chiffres agrégés des utilisateurs révèlent une situation surprenante : Perplexity et ChatGPT Search traitent actuellement environ 37,5 millions de requêtes par jour pour ChatGPT, auxquelles s’ajoute un nombre bien plus important pour Perplexity (estimé de façon prudente entre 10 et 20 millions), ce qui représente un total d’environ 47,5 à 57,5 millions de requêtes de recherche IA par jour. Parallèlement, Google traite environ 14 milliards de requêtes par jour. Cela signifie que Google traite environ 250 à 370 fois plus de requêtes que Perplexity et ChatGPT réunis. Le trafic de recherche IA agrégé représente environ 0,1 à 0,25 % du trafic web mondial total. Il s’agit d’un bruit de fond, et non du signe d’un changement de paradigme.
C'est significatif car cela montre que, malgré les investissements massifs en capital-risque dans les startups de recherche par IA, malgré le battage médiatique autour de la « révolution de la recherche » et malgré les réelles améliorations techniques apportées par Perplexity et ChatGPT Search, la recherche Google classique demeure la principale source d'information. Cela ne signifie pas que Perplexity et ChatGPT Search soient sans importance ; ils témoignent d'une évolution des attentes des utilisateurs. Mais cela ne signifie pas pour autant que la position de Google sur le marché est menacée.
Cependant, ces chiffres peuvent être trompeurs. Si Perplexity ne représente que 0,01 % du volume de recherches quotidien de Google à l'échelle mondiale, sa pénétration auprès de certains groupes d'utilisateurs (jeunes, férus de technologie et travailleurs avides d'informations) est nettement plus élevée. Un analyste financier pourrait avancer que Perplexity ne concurrence pas Google, mais crée plutôt le type d'utilisateur qui constituera le groupe d'utilisateurs dominant d'ici dix ans. Il s'agit là d'un argument classique de rupture. Toutefois, cela reste de la spéculation ; les données actuelles suggèrent une coexistence des modèles de recherche plutôt qu'un processus de substitution.
L’effondrement du secteur de l’édition : destruction économique ou restructuration du modèle économique ?
Pour une analyse économique complète, il est indispensable d'examiner l'impact destructeur de l'intégration de l'IA de Google sur les éditeurs. Il s'agit d'un phénomène réel et immédiat, et non d'une simple projection. Les éditeurs font état de pertes de trafic de 70 à 80 %. Un grand magazine d'actualités américain a perdu entre 27 et 38 % de son trafic entre 2024 et 2025. Un blog spécialisé dans la rénovation domiciliaire a perdu environ 86 % de ses revenus, passant de 7 000 à 10 000 dollars par mois à environ 1 500 dollars par mois.
Les conséquences économiques sont dramatiques. Aux États-Unis, le secteur de l'information a perdu environ 600 millions de visites mensuelles en moins d'un an, soit une baisse d'environ 26 %. Pour un secteur dont les revenus dépendent des recettes publicitaires, cela se traduit directement par une diminution du nombre d'impressions, de clics sur les publicités, une baisse des CPM (en raison de la concurrence accrue pour un inventaire publicitaire plus rare) et une diminution du chiffre d'affaires global.
Il s'agit d'un cas classique d'externalisation économique des effets négatifs. Google internalise les profits liés à l'amélioration de l'expérience utilisateur (les utilisateurs n'ont plus besoin de cliquer, ils obtiennent des réponses instantanées), mais externalise les coûts sur les éditeurs qui ne génèrent plus de trafic. Cette répartition asymétrique des coûts est une caractéristique structurelle des économies de plateforme, où les opérateurs disposent d'un pouvoir de négociation leur permettant de déplacer les centres de coûts.
Certains éditeurs commencent à expérimenter des modèles qui tiennent compte de cette nouvelle réalité : au lieu d’optimiser le volume de trafic, ils optimisent la visibilité et la mention de la marque dans les résultats de l’IA. Si Google propose une réponse pour « meilleurs restaurants de Berlin », la mention d’un restaurant spécifique peut s’avérer plus précieuse pour celui-ci qu’un simple clic, car elle renforce la notoriété de la marque et la rend immédiatement identifiable. Les utilisateurs qui consultent les réponses de l’IA mentionnant un restaurant précis seront peut-être plus enclins à s’y rendre ultérieurement, même sans cliquer immédiatement.
Cela ne console guère les éditeurs qui misent sur la monétisation immédiate du trafic. Mais cela laisse entrevoir une possible restructuration de leurs modèles économiques : passer d’une logique de « volume de trafic × CPM publicitaire » à une logique de « notoriété de la marque × abonnement à du contenu premium » ou encore de « notoriété de la marque × partenariats stratégiques à forte valeur ajoutée ».
La question de facturation non résolue : qui paie pour les données d'entraînement ?
Un problème subtilement important, mais systématiquement négligé, concerne l'attribution des données d'entraînement. Les modèles d'IA qui alimentent AI Overviews, AI Mode et ChatGPT Search ont été entraînés sur des données web créées à 99 % par des entités non spécialisées en IA. Les éditeurs rémunèrent les journalistes pour rédiger des articles. Les agences de presse paient les correspondants pour recueillir des informations. Les scientifiques consacrent du temps à la recherche afin de publier leurs résultats. Toutes ces entités financent leurs activités grâce à des modèles économiques généralement basés sur la génération de trafic ou les abonnements directs. Or, la création de contenu web est considérée comme un « bien public » si elle n'est pas rémunérée par une monétisation directe.
Le processus d'entraînement des IA n'a jamais rémunéré les créateurs de contenu. OpenAI a entraîné GPT-4 avec des milliards d'articles sans verser de compensation aux éditeurs. Google a entraîné Gemini avec du contenu web sans compensation. Perplexity entraîne ses modèles de la même manière. Ceci est techniquement et légalement possible car cela relève du « fair use » (en vertu du droit d'auteur américain), mais c'est éthiquement et économiquement asymétrique : les créateurs de contenu financent l'entraînement des IA mais ne reçoivent aucune compensation directe. Au contraire, ils subissent un préjudice du fait de la baisse de leur trafic.
Cela pourrait représenter un risque à long terme pour l'industrie de l'IA. Si les éditeurs ne sont pas rémunérés pour leurs données d'entraînement, ils seront moins incités à créer du contenu de haute qualité. La qualité du web se dégradera. À terme, cela posera problème aux modèles d'IA entraînés sur des données web, car ils seront entraînés sur du contenu de moindre qualité. Il s'agit d'un problème classique de « tragédie des biens communs ». Certains acteurs (notamment OpenAI avec ses ressources commerciales et Google avec son intégration native au web) ont déjà commencé à expérimenter avec des sources de données sous licence (par exemple, OpenAI s'associe à des éditeurs de presse pour des flux de contenu). Cela pourrait mener à l'émergence d'une norme où l'entraînement des IA serait partiellement soumis à licence. Mais pour l'instant, cela reste l'exception, et non la règle.
Déstabilisation de la chaîne de valeur : de la publicité à… quoi ?
L'intégration de l'IA par Google soulève un problème économique fondamental : celui des modèles de monétisation alternatifs lorsque la publicité traditionnelle perd en efficacité. La chaîne de valeur classique de Google était la suivante : l'utilisateur effectue une recherche → Google présente des résultats organiques et des publicités → l'utilisateur clique → l'éditeur ou l'annonceur bénéficie d'un trafic généré ou d'une conversion. Cette chaîne de valeur a constitué le socle de l'économie numérique pendant 25 ans.
Les aperçus de l'IA déstabilisent cette chaîne de valeur en supprimant l'étape du « clic ». Google doit établir de nouvelles chaînes de valeur. Plusieurs approches sont actuellement testées :
Premièrement : l’intégration directe de publicités dans les aperçus et le mode IA. Cette opération est complexe car les utilisateurs perçoivent explicitement ces réponses générées par l’IA comme des réponses « non publicitaires ». Intégrer des publicités dans ces réponses risque d’éroder la confiance des utilisateurs. Google se montre donc prudent sur ce point.
Deuxièmement : la monétisation par abonnement. Google teste des versions premium de son mode IA, qui pourraient devenir payantes. Dans ce cas, la recherche conversationnelle par IA serait une fonctionnalité premium, tandis que la recherche standard resterait gratuite. Il s’agit d’un modèle freemium, similaire à celui de Spotify ou d’Adobe. Le défi consiste à maintenir un taux de pénétration suffisamment élevé pour que les versions payantes compensent la perte de revenus publicitaires.
Troisièmement : la monétisation via des modèles économiques qui ne reposent pas sur la monétisation individuelle des utilisateurs. Par exemple, Google pourrait proposer une « API pour la recherche IA d’entreprise » permettant aux entreprises clientes de louer des modèles Gemini spécifiques pour leurs besoins de recherche internes. Cela transformerait le modèle économique en un modèle B2B, similaire à celui de Google Cloud.
Quatrièmement : la monétisation par l’exploitation des données. Lorsque Google effectue des millions d’interactions conversationnelles avec les utilisateurs via son IA, il génère d’énormes quantités de données sur leurs intentions. Ces données sont extrêmement précieuses pour le ciblage publicitaire. Google pourrait les utiliser pour améliorer le ciblage des annonceurs, même si les taux de clics diminuent. Il s’agit d’une forme de monétisation indirecte.
Aucune de ces alternatives n'est évidemment aussi rentable que la formule classique « clic × CPM ». Mais, combinées, elles pourraient potentiellement créer un nouvel écosystème de création de valeur.
Le dilemme stratégique de l'amélioration continue
La philosophie de Stein, fondée sur « l'amélioration continue », se heurte à un conflit structurel fondamental : l'amélioration du produit du point de vue de l'utilisateur entre directement en conflit avec la stabilité du modèle économique. Un meilleur produit (des aperçus basés sur l'IA fournissant des réponses instantanées) fragilise le modèle économique (baisse des clics publicitaires). Il ne s'agit pas d'un dilemme progressif et modéré, mais d'un problème structurel radical.
Le problème est d'autant plus complexe qu'il s'agit d'une question de calendrier. Google pourrait théoriquement ralentir, voire stopper, le déploiement des aperçus IA. Cela préserverait les revenus publicitaires à court terme. Mais cela signifierait aussi que Perplexity et ChatGPT Search deviendraient techniquement supérieurs, et que les utilisateurs migreraient vers ces plateformes. Autrement dit, en restant inactif, Google risque de perdre des parts de marché au profit de concurrents qui privilégient l'expérience utilisateur. On se retrouve alors face à un dilemme du prisonnier : tous les acteurs sont contraints d'optimiser l'expérience utilisateur, même si cela conduit collectivement à une crise de monétisation.
Autrement dit, l'intégration de l'IA n'est pas un simple choix de fonctionnalité ; c'est une stratégie existentielle face à la concurrence décentralisée. Google doit intégrer des capacités d'IA, sous peine de voir son moteur de recherche migrer vers ChatGPT. Or, cette intégration engendre des problèmes immédiats de modèle économique. Google accepte ce sacrifice à court terme, le jugeant nécessaire pour préserver sa position sur le marché à long terme.
Le paradoxe de la croissance avec des multiples de revenus en baisse
Un dernier point important : le volume de recherches Google continue de croître. Le taux de croissance annuel des requêtes était d'environ 4,7 % en 2025, contre 4,1 % en 2024. Cela signifie que le volume absolu de recherches est en augmentation. Cependant, cette augmentation s'accompagne d'une baisse des coefficients de monétisation. Une requête Google vaut moins qu'il y a un an, car la probabilité de clic est plus faible.
Si cette tendance se poursuit (croissance du volume × baisse du taux de monétisation), elle aboutira à une économie du « profit des ruines », où Google générera plus de trafic mais en tirera moins de revenus. Si cela est avantageux pour l'utilisateur (plus de recherches, meilleure qualité), c'est désavantageux pour Google (revenus par recherche inférieurs, voire baisse du chiffre d'affaires global).
Les prévisions de revenus du marketing de recherche, qui s'élèvent à 190,6 milliards de dollars pour 2025 (contre 178,2 milliards en 2024), suggèrent que Google compense les pertes de volume par des hausses agressives du CPM (obligeant ainsi les annonceurs à payer plus cher). Il s'agit d'une stratégie à court terme : si l'efficacité de Google continue de décliner, les annonceurs finiront par se tourner vers d'autres canaux (par exemple, directement auprès des détaillants, via Amazon Ads ou TikTok Ads). Ces prévisions sont donc loin d'être fiables.
L'innovation sous pression et le scénario des circonstances
La transformation de Google, d'un moteur de recherche classique à une interface de recherche native de l'IA, n'est pas un changement de stratégie volontaire ; il s'agit d'une adaptation forcée face à de multiples perturbations simultanées : ChatGPT/OpenAI comme nouvelle concurrence, Perplexity AI comme nouveau canal de recherche, pression technologique interne (Gemini et d'autres modèles d'IA sont déjà construits ; il est irrationnel de ne pas les utiliser) et une évolution des attentes des utilisateurs (les utilisateurs attendent des capacités d'IA dans tous les produits numériques).
La philosophie de développement produit de Robby Stein – amélioration continue, optimisation obsessionnelle de l'expérience utilisateur et préparation à la conversion – fonctionne lorsque l'amélioration de l'expérience utilisateur et la stabilité du modèle économique sont alignées. Cependant, face à la disruption engendrée par l'IA, ces objectifs entrent en conflit. L'approche de Stein permet à Google de poursuivre activement l'innovation en IA, mais ne fournit pas de solutions immédiates aux problèmes de modèle économique que cette innovation engendre.
Le scénario à long terme reste incertain. Plusieurs possibilités existent : (1) Google se stabilise sur un nouveau modèle économique où la recherche par IA, les abonnements premium, les services B2B et un ciblage publicitaire amélioré se combinent pour créer un nouveau portefeuille de revenus. (2) Google perd progressivement des parts de marché au profit de Perplexity, ChatGPT Search et d’autres modèles décentralisés, car ces concurrents offrent une meilleure expérience utilisateur et ne sont pas contraints par des modèles économiques privilégiant la monétisation. (3) Une crise réglementaire empêche Google d’exploiter son avantage en matière de données, et le paysage concurrentiel demeure fragmenté.
Actuellement, le scénario 1 est le plus probable car les avantages structurels de Google (base de données, base d'utilisateurs, infrastructure) restent considérables. Mais l'incertitude est bien réelle, et la transformation est permanente et structurelle, et non pas seulement progressive. Quoi qu'il en soit, une chose est claire : l'ère de la monétisation de la recherche basée uniquement sur les clics touche à sa fin. Un nouveau modèle se dessine, mais sa forme n'est pas encore stabilisée.
Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial
☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand
☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !
Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital
J'attends avec impatience notre projet commun.
☑️ Accompagnement des PME en stratégie, conseil, planification et mise en œuvre
☑️ Création ou réalignement de la stratégie digitale et digitalisation
☑️ Expansion et optimisation des processus de vente à l'international
☑️ Plateformes de trading B2B mondiales et numériques
☑️ Pionnier Développement Commercial / Marketing / RP / Salons
Notre expertise industrielle et économique mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing

Notre expertise mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing - Image : Xpert.Digital
Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie
En savoir plus ici :
Un pôle thématique avec des informations et une expertise :
- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles
- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention
- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie
- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur
Bénéficiez de la vaste expertise quintuple de Xpert.Digital dans un package de services complet | BD, R&D, XR, PR & Optimisation de la visibilité numérique

Bénéficiez de la vaste expertise de Xpert.Digital, quintuple, dans une offre de services complète | R&D, XR, RP et optimisation de la visibilité numérique - Image : Xpert.Digital
Xpert.Digital possède une connaissance approfondie de diverses industries. Cela nous permet de développer des stratégies sur mesure, adaptées précisément aux exigences et aux défis de votre segment de marché spécifique. En analysant continuellement les tendances du marché et en suivant les évolutions du secteur, nous pouvons agir avec clairvoyance et proposer des solutions innovantes. En combinant expérience et connaissances, nous générons de la valeur ajoutée et donnons à nos clients un avantage concurrentiel décisif.
En savoir plus ici :