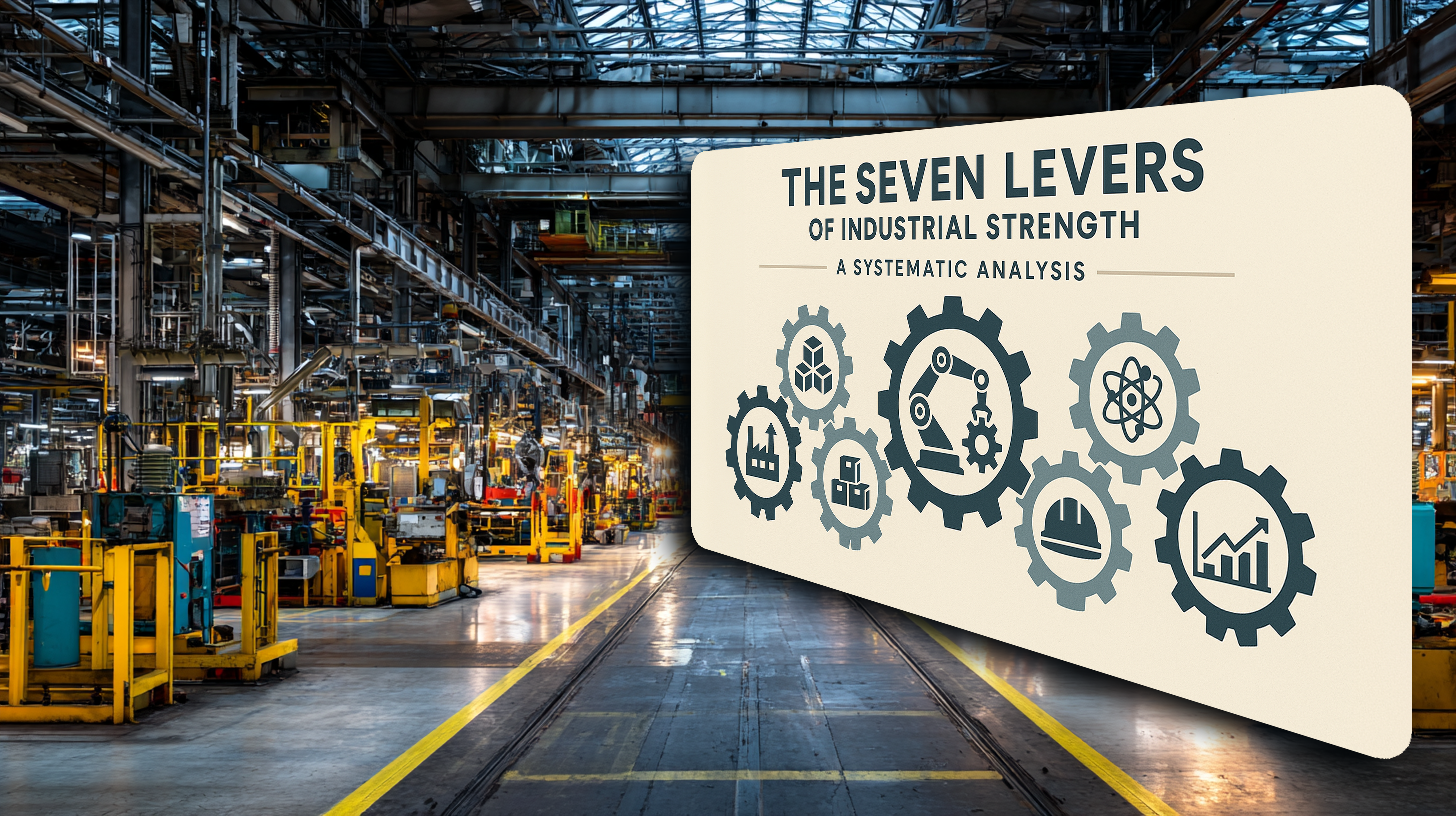
L'industrie automobile en panique : la révolution industrielle européenne – Quand les dépendances deviennent une menace existentielle – Image : Xpert.Digital
Du rêve du juste-à-temps au cauchemar : le talon d'Achille de l'industrie européenne
Autonomie stratégique plutôt que guerre des prix : l’opportunité pour l’Europe face à la crise
Le 8 octobre 2025, l'illusion de la puissance industrielle européenne s'effondre. L'arrêt brutal des livraisons du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, provoqué par une escalade géopolitique entre les États-Unis et la Chine, paralyse l'industrie automobile européenne en quelques jours. Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz annoncent des fermetures d'usines imminentes, les chaînes d'approvisionnement se rompent et des produits simples et bon marché se vendent à des prix exorbitants. La crise met impitoyablement en lumière le talon d'Achille du continent : une dépendance existentielle, ancrée depuis des décennies, aux chaînes d'approvisionnement mondiales et à la production en Extrême-Orient. Le mantra de l'efficacité « juste-à-temps » se révèle du jour au lendemain une catastrophe stratégique.
Au milieu de cette panique, une voix s'élève, formulant une critique fondamentale qui met le doigt sur le problème. Jana Tischler, de Baier & Michels, fournisseur du groupe Würth, résume la situation : l'Europe s'est affaiblie dans une guerre des prix ruineuse. « On marchande souvent jusqu'au dernier centime, on tire les prix vers le bas jusqu'à l'extrême limite, pour ensuite s'étonner de constater qu'au final, la valeur ajoutée, le savoir-faire et l'indépendance ont disparu », analyse-t-elle. C'est le constat acerbe d'une politique d'achats à courte vue, qui a sacrifié la résilience à long terme au profit d'économies immédiates.
En savoir plus ici :
Mais Tischler ne s'arrête pas au diagnostic. Son entreprise défie le discours dominant sur la désindustrialisation et la délocalisation par un geste fort : un investissement de 20 millions d'euros dans une nouvelle unité de production ultra-novatrice sur son site allemand d'Ober-Ramstadt. Au lieu de délocaliser sa production, Baier & Michels mise sur le leadership technologique, des prix justes et des partenariats collaboratifs.
Cette décision dépasse la simple construction d'une nouvelle usine. C'est une contre-proposition qui soulève la question cruciale de notre époque : comment l'Europe peut-elle recouvrer sa puissance industrielle ? L'exemple de Jana Tischler sert de point de départ à une analyse approfondie des sept leviers décisifs – de l'autonomie stratégique dans les technologies clés et d'une rupture avec une logique de pure efficacité à une réduction radicale de la bureaucratie. Il s'agit de trouver un nouvel équilibre entre interdépendance mondiale et souveraineté indispensable, avant que d'autres ne décident du destin économique de l'Europe.
Le moment de vérité : quand un contrôle des exportations paralyse la production
Le 8 octobre 2025 restera gravé dans les annales de l'histoire industrielle européenne comme le jour où l'illusion s'est brisée. Ce mercredi-là, les livraisons de Nexperia, un fabricant néerlandais de semi-conducteurs alors largement inconnu, ont été brutalement interrompues. Ce qui a suivi n'a pas été un déclin progressif, mais un choc économique comparable aux conséquences de la catastrophe de Fukushima en 2011. En quelques jours, les entrepôts des grossistes étaient vides et les courtiers en semi-conducteurs vendaient de minuscules composants, coûtant normalement moins de dix centimes, à un prix cent fois supérieur. Bosch, le plus grand équipementier automobile allemand, a réduit sa production et les heures de travail de son usine de Braga, au Portugal. Le chômage partiel menaçait son site de Salzgitter. Honda a réduit de moitié ses volumes de production dans ses usines canadiennes et a fermé des lignes de production au Mexique. Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont annoncé des fermetures d'usines imminentes.
Convient à:
- Le choc des puces : quand un composant paralyse l'industrie européenne – L'industrie européenne des semi-conducteurs à la croisée des chemins
La crise a révélé une vulnérabilité fondamentale du modèle économique européen. Nexperia contrôle environ quarante pour cent du marché mondial des semi-conducteurs discrets : ces diodes, transistors et composants de protection, en apparence anodins, qui traitent les signaux, régulent les tensions et réagissent aux capteurs des unités de commande électroniques. Ces composants ne relèvent ni de la technologie de pointe, ni de la fabrication à l’échelle nanométrique des processeurs les plus sophistiqués. Ils sont l’équivalent industriel des vis et des écrous : techniquement simples, mais absolument indispensables. Une voiture moyenne nécessite des centaines de ces composants. Sans eux, même la chaîne de production la plus sophistiquée s’arrête.
La crise d'approvisionnement trouve son origine dans une spirale géopolitique d'escalade. En septembre 2025, le département du Commerce américain a élargi le champ d'application de sa liste d'entités par le biais d'une nouvelle règle relative aux filiales. Ce règlement stipule que les entreprises contrôlées par au moins 50 % des entités listées sont automatiquement soumises aux mêmes contrôles à l'exportation. Nexperia avait été rachetée en 2019 par l'entreprise technologique chinoise Wingtech. Wingtech, quant à elle, avait été inscrite sur la liste d'entités en décembre 2024 en raison de risques présumés pour la sécurité nationale américaine. Le lendemain de l'entrée en vigueur de cette règle plus stricte, le 29 septembre, le gouvernement néerlandais a invoqué une loi sur les marchés publics datant de la guerre froide, rarement utilisée, et a pris le contrôle de Nexperia. Il a justifié cette décision par la nécessité d'assurer la continuité et la sauvegarde d'un savoir-faire technologique essentiel sur le territoire néerlandais et européen.
La réaction de Pékin fut immédiate : moins de vingt-quatre heures plus tard, le ministère chinois du Commerce imposa des restrictions drastiques à l’exportation des produits Nexperia provenant de ses sites de production chinois. La grande majorité des semi-conducteurs Nexperia étant fabriqués en Chine, cette mesure porta un coup dur à l’industrie automobile mondiale. Selon des sources industrielles, les stocks des constructeurs européens et nord-américains ne suffisaient que pour quelques semaines supplémentaires. Trouver des fournisseurs alternatifs s’avéra difficile. Bien que d’autres fabricants de semi-conducteurs discrets existent, leurs capacités ne peuvent compenser la perte à court terme d’une entreprise détenant quarante pour cent de parts de marché. Développer des capacités de production supplémentaires prendrait des mois, un délai incompatible avec la production à grande vitesse et en flux tendu des usines automobiles modernes.
Fin octobre, la situation s'est aggravée. Nexperia a interrompu les livraisons de plaquettes, ces fines plaques de silicium utilisées comme matière première pour les semi-conducteurs, à son usine d'assemblage et de test de Dongguan, en Chine. Le PDG par intérim, Stefan Tilger, a déclaré dans un courrier aux clients que la direction locale n'avait pas respecté ses obligations de paiement. Reste à savoir si cette explication reflète pleinement les véritables motivations, ou si des luttes de pouvoir plus complexes entre la direction européenne et le propriétaire chinois sont en jeu. La conséquence immédiate, en revanche, est claire : toute la chaîne d'approvisionnement est menacée d'effondrement.
Les associations professionnelles européennes ont tiré la sonnette d'alarme. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a souligné que, sans ces puces, les fournisseurs européens étaient incapables de produire les pièces et composants nécessaires aux constructeurs automobiles. Ils se trouvaient soudainement confrontés à une situation alarmante et exigeaient des solutions rapides et pragmatiques de la part de tous les pays concernés. Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA, a averti qu'il faudrait peut-être des mois pour trouver des fournisseurs alternatifs, tandis que les stocks actuels ne dureraient que quelques semaines. John Bozzella, directeur de l'Alliance américaine pour l'innovation automobile (AAAI), a été encore plus catégorique : si l'approvisionnement en puces automobiles n'était pas rétabli rapidement, cela perturberait la production automobile aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, et aurait des répercussions sur d'autres secteurs. La situation était critique.
Convient à:
- La compétitivité de l'Europe face à la crise : l'ambidextrie organisationnelle comme solution stratégique
L'architecture de la dépendance : comment l'Europe a perdu son autonomie industrielle
La crise de Nexperia n'est pas un événement isolé, mais plutôt symptomatique de problèmes structurels qui se sont développés au fil des décennies. L'Europe ne produit plus que huit à neuf pour cent des microprocesseurs mondiaux. Cette concentration extrême de la production de semi-conducteurs en Asie et en Amérique du Nord résulte de décisions politiques et économiques délibérées prises au cours des trente dernières années. Tandis que l'Europe investissait dans la recherche et le développement, elle a systématiquement externalisé la production. Cette stratégie paraissait rationnelle dans un contexte géopolitique stable et de chaînes d'approvisionnement mondiales parfaitement fonctionnelles. Les coûts de production en Asie étaient plus faibles, les économies d'échelle plus importantes et la spécialisation plus efficace.
Mais ce calcul reposait sur des prémisses qui se sont révélées trompeuses. Il supposait que la stabilité géopolitique était une constante. Il supposait que les relations commerciales étaient principalement déterminées par des critères économiques. Il présupposait que les interdépendances critiques ne constituaient pas un levier politique. Ces trois hypothèses ont été fondamentalement démenties au cours des cinq dernières années.
La pandémie de COVID-19, entre 2019 et 2023, a mis en évidence pour la première fois la fragilité des chaînes de valeur mondiales. Lorsque la Chine a fermé ses usines au printemps 2019, des chaînes d'approvisionnement développées sur plusieurs décennies se sont effondrées. Le blocage du canal de Suez par le porte-conteneurs Ever Given en mars 2021 a révélé en quelques jours l'ampleur de la vulnérabilité des routes commerciales maritimes. Près de 90 % des marchandises sont transportées par voie maritime, principalement dans des conteneurs. En 2024, le volume mondial de conteneurs a atteint 183,2 millions d'EVP (équivalent vingt pieds), soit une croissance de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Trois mois ont même dépassé les 16 millions d'EVP, un record historique. La crise de la mer Rouge a entraîné des déviations du trafic maritime vers l'Afrique et une augmentation de la demande mondiale de conteneurs de 21 %.
La dépendance de la Chine à l'égard de l'économie mondiale dépasse largement le secteur des semi-conducteurs. La Chine domine la production et la transformation mondiales de matières premières essentielles. Pour les terres rares, utilisées dans des technologies clés telles que les smartphones, les moteurs électriques, les semi-conducteurs et les turbines, elle contrôle plus de 60 % de la production mondiale. La situation est encore plus frappante dans le domaine de la transformation : sa part de marché y dépasse 90 %. Bien que les terres rares soient également présentes à l'état naturel au Brésil, en Inde et en Australie, la Chine a établi un quasi-monopole grâce à des décennies d'investissements systématiques dans les capacités de raffinage. L'extraction est coûteuse, polluante et exige d'importantes quantités d'eau et d'énergie. La Chine a accepté ces coûts, se forgeant ainsi une position stratégique de premier plan.
Le même schéma se répète pour le lithium utilisé dans les batteries, ainsi que pour le cobalt, le nickel et les cellules solaires. Cette dépendance s'applique également aux semi-conducteurs et aux batteries elles-mêmes. Si l'Europe possède des gisements pour bon nombre de ces matières premières, elle manque de capacités de raffinage. La transformation des matières premières en produits industriels utilisables a été systématiquement externalisée vers l'Asie. Le principal risque réside dans la phase de transformation ou de raffinage, et non dans l'extraction des matières premières elles-mêmes.
Cette situation confère à la Chine un levier géopolitique considérable. Lorsque le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de Nexperia en septembre 2025, Pékin a réagi en quelques heures. Le message était sans équivoque : quiconque privilégie les intérêts européens au détriment des entreprises chinoises en subira les conséquences. Le ministère chinois du Commerce l’a affirmé explicitement : l’ingérence indue du gouvernement néerlandais dans les affaires internes de l’entreprise a engendré le chaos actuel dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales.
L'Europe a réagi avec inquiétude, mais surtout avec un sentiment d'impuissance. La vice-présidente de la Commission européenne, Henna Virkkunen, a déclaré après une réunion avec Nexperia qu'il était évident que la chaîne d'approvisionnement européenne manquait de la résilience nécessaire. Il fallait en tirer des leçons. Concrètement, cela signifiait que la constitution de stocks et la diversification des approvisionnements étaient cruciales pour la résilience. Investir dans la sécurité d'approvisionnement avait un coût, mais le prix payé pour un manque de résilience était encore plus élevé.
Cette observation est juste, mais elle arrive tard. Pendant des décennies, la philosophie du juste-à-temps a été considérée comme la référence en matière de production efficace en Europe. Toyota a introduit ce concept dans les années 1970 dans le but de réduire les coûts de stockage en minimisant les stocks et en ne recevant les marchandises qu'au moment opportun pour la production. Dans un environnement stable, le juste-à-temps réduit effectivement le gaspillage et accroît l'agilité opérationnelle. Cependant, il exige une coordination précise entre les fournisseurs, les fabricants et les transporteurs. Toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement entraîne directement des retards de production.
Dans un ordre mondial fragile, cette obsession de l'efficacité se révèle être un talon d'Achille. Un responsable des achats chez un équipementier automobile allemand illustre de façon frappante la vulnérabilité des systèmes de production à flux tendu : les livraisons de Nexperia ont été brutalement interrompues, comme à Fukushima. En quelques jours, les stocks de puces des grossistes étaient épuisés. Les courtiers en semi-conducteurs vendent désormais ces composants à des prix exorbitants, parfois cent fois supérieurs au prix initial. La situation est très grave. Sans solution politique, la chaîne d'approvisionnement s'effondrera complètement en novembre.
Notre expertise européenne et allemande en matière de développement commercial, de ventes et de marketing
Notre expertise européenne et allemande en matière de développement commercial, de ventes et de marketing - Image : Xpert.Digital
Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie
En savoir plus ici :
Un pôle thématique avec des informations et une expertise :
- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles
- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention
- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie
- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur
Relocalisation de proximité, relocalisation amicale, relocalisation : stratégies d’achat pour réduire la dépendance à l’égard de la Chine
Le prix de l'efficacité : pourquoi la production allemande souffre de désavantages structurels
Dans sa publication LinkedIn, Jana Tischler, de Baier & Michels, formule une critique fondamentale de la politique industrielle européenne actuelle : l’Europe est économiquement incapable de rivaliser avec l’Extrême-Orient. On assiste souvent à des marchandages interminables et les prix sont tirés vers le haut, pour ensuite s’étonner de constater qu’au final, la valeur ajoutée, le savoir-faire et l’indépendance disparaissent.
Cette observation est révélatrice. L'industrie allemande souffre d'un désavantage concurrentiel fondamental, qui se manifeste par ses coûts unitaires de main-d'œuvre. En 2024, ces coûts étaient supérieurs de 22 % à la moyenne des 27 pays industrialisés. Concrètement, cela signifie que pour produire une unité de production, les entreprises allemandes devaient dépenser environ un cinquième de plus en salaires que la moyenne internationale. Seuls la Lettonie, l'Estonie et la Croatie affichaient des coûts plus élevés.
L'industrie allemande demeure parmi les plus productives au monde. Sur les vingt-sept pays étudiés, l'Allemagne se classe septième. Seuls les États-Unis affichent une productivité supérieure parmi les grandes nations industrialisées. Cependant, l'Allemagne présente également le troisième coût du travail le plus élevé. Aux États-Unis, les coûts du travail sont inférieurs de 2 %, tandis que la productivité est supérieure de 44 % à celle de l'Allemagne.
Depuis 2018, les coûts unitaires de main-d'œuvre en Allemagne ont progressé moins fortement (18 %) qu'à l'étranger (20 %). Cependant, alors que la valeur ajoutée brute a augmenté en moyenne de 6 % à l'étranger, elle a reculé de 3 % en Allemagne. Malgré une croissance des prix inférieure à la moyenne, les entreprises industrielles allemandes ont vendu moins de produits. Cela s'explique notamment par le fait que nombre d'entre elles ont perdu leur avance technologique, en particulier face à leurs concurrents chinois, et sont donc moins à même d'imposer leurs prix. Les coûts d'implantation élevés constituent ainsi un désavantage.
Christoph Schröder, de l'Institut économique allemand (IW), tire la sonnette d'alarme : la pénurie de main-d'œuvre qualifiée fait grimper les salaires et les coûts en Allemagne devraient continuer d'augmenter dans les années à venir. Le gouvernement fédéral est appelé à freiner la hausse des coûts non salariaux du travail tout en relevant les défis démographiques. Sans réforme du système de sécurité sociale, l'Allemagne s'enfoncera progressivement dans la désindustrialisation.
Outre le coût élevé du travail, l'Allemagne est confrontée à un second handicap concurrentiel majeur : une bureaucratie excessive. Le poids des formalités administratives a coûté à l'économie allemande environ 67,5 milliards d'euros en 2024, soit près de 1,5 % de son PIB. Conjugué à des prix de l'énergie élevés et à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, ce facteur nuit considérablement à l'attractivité de l'Allemagne pour les entreprises.
Les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles souffrent particulièrement de la multitude de réglementations gouvernementales, car elles manquent souvent de ressources pour se conformer à des exigences complexes. Une bureaucratie inutile engendre des pertes de temps et d'argent, freine l'innovation et accentue leur désavantage concurrentiel. Une enquête menée auprès de dirigeants d'entreprises en Europe et aux États-Unis a révélé que 31 % des représentants responsables de l'Allemagne ont déclaré délocaliser ou développer activement leur production vers d'autres continents. Par ailleurs, 42 % investissent dans d'autres pays européens plutôt qu'en Allemagne ou reportent leurs investissements en Allemagne.
Les industries énergivores de la chimie de base, de l'acier, du verre et du ciment sont particulièrement touchées. Christof Günther, directeur général d'Infraleuna, exploitant de sites chimiques, constate : « Nombre d'entreprises n'ont pas pu exploiter pleinement leurs installations depuis des années et ne voient désormais aucun avenir. Actuellement, l'Allemagne perd chaque semaine une part considérable et irrécupérable de sa valeur industrielle. »
Dans ce contexte, la référence de Tischler à Baier & Michels prend une importance particulière. Cette entreprise, filiale du groupe Würth, produit des systèmes de fixation ainsi que des systèmes de fermeture et d'étanchéité pour les secteurs automobile, électrique et médical. Malgré un contexte économique difficile, Baier & Michels investit vingt millions d'euros dans une nouvelle unité de production sur son site allemand d'Ober-Ramstadt, près de Darmstadt. Le procédé de fabrication innovant b&m-ECCO TEC devrait y être mis en œuvre dès cet automne.
Ce procédé allie la précision de l'usinage aux avantages du formage à froid. Une machine de 125 tonnes, de la taille d'un appartement de trois pièces, produit de petits composants fonctionnels tels que des rotules, des arbres de transmission ou des broches de réglage, sans outils de coupe. Ses atouts résident dans sa cadence de production élevée, l'utilisation optimale de la matière première, la liberté de contour absolue et l'excellente qualité de surface. Les pièces longues classiques, auparavant fabriquées exclusivement par usinage, peuvent désormais être produites par formage à froid avec une grande précision, des temps de cycle extrêmement courts et une utilisation efficace des ressources, sans générer le moindre déchet.
La stratégie de Baier & Michels est convaincante : bien que l’entreprise possède huit sites dans le monde, son développement le plus innovant se concentre actuellement en Allemagne. Elle investit près de vingt millions d’euros sur son site d’Ober-Ramstadt, près de Darmstadt, allant ainsi à contre-courant de la tendance à délocaliser la production. Elle est persuadée d’avoir fait le bon choix.
Cette position s'oppose au discours dominant sur le désavantage concurrentiel de l'Allemagne. Elle repose sur la conviction qu'une production performante est possible en Allemagne si l'on adopte une approche différente, des calculs équitables et si l'on privilégie la qualité et le partenariat plutôt que la pression sur les prix.
Convient à:
- Stratégies américaines pour réduire la dépendance à la Chine : Friendshoring – Reshoring – Nearshoring
Les sept leviers pour reconquérir la puissance industrielle : une analyse systématique
Les sept leviers pour reconquérir la puissance industrielle : une analyse systématique – Image : Xpert.Digital
La question de savoir où se situent les principaux leviers pour restaurer la puissance industrielle de l'Europe ne peut être résolue par une seule cause. Il est nécessaire de mettre en œuvre un ensemble de mesures coordonnées qui s'attaquent aux faiblesses structurelles tout en capitalisant sur les atouts existants. L'analyse de la crise de Nexperia, les conclusions relatives aux stocks de précaution et les recherches actuelles sur la résilience des chaînes d'approvisionnement ont permis d'identifier sept leviers clés.
Premier levier : Autonomie stratégique dans les technologies critiques grâce à une politique industrielle ciblée
La leçon fondamentale de la crise de Nexperia est la suivante : les dépendances dans les secteurs technologiques critiques constituent des vulnérabilités stratégiques inacceptables. L’Europe doit recouvrer sa capacité d’autosuffisance dans des domaines clés définis. Il ne s’agit pas d’une autarcie totale, mais plutôt d’atteindre des seuils critiques au-delà desquels toute tentative de chantage devient vaine.
La loi européenne sur les semi-conducteurs, adoptée en 2023, constitue une première étape dans cette direction. Elle mobilise 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés afin de porter la part de l'Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs de 9 % actuellement à 20 % d'ici 2030. L'initiative « Des puces pour l'Europe » vise à soutenir le développement à grande échelle des capacités technologiques et des innovations. Un cadre de promotion des investissements publics et privés dans les sites de production est mis en place pour garantir la sécurité d'approvisionnement.
Les premiers succès se font sentir. Le leader mondial taïwanais TSMC, en partenariat avec Bosch, Infineon et NXP, construit sa première usine européenne à Dresde. STMicroelectronics et GlobalFoundries prévoient quant à eux d'implanter une nouvelle usine en France. Selon les estimations des analystes et des organisations professionnelles, ces investissements de plusieurs milliards d'euros permettront de maintenir la part de marché actuelle, légèrement inférieure à 10 %, en bonne voie de se stabiliser.
Cependant, contrairement aux espoirs de l'Union européenne, il est peu probable que cette croissance se produise avant la fin de la décennie. La concurrence internationale démontre clairement que l'Europe dispose d'une influence financière moindre que les États-Unis et l'Asie. Le CHIPS Act américain prévoit 53 milliards de dollars de subventions directes, 75 milliards de dollars de prêts et d'autres avantages fiscaux. Les États-Unis sont également à la pointe dans des domaines clés tels que la conception de puces et la recherche en intelligence artificielle. Depuis 2014, la Chine soutient son industrie des semi-conducteurs grâce à un fonds d'investissement public de 70 milliards d'euros afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Taïwan, la Corée du Sud et le Japon subventionnent leurs industries locales par des programmes similaires, dotés de plusieurs milliards de dollars.
Les États membres de l'UE réclament déjà une révision de la loi sur les puces. La coalition Semicon exige une loi européenne sur les puces 2.0, qui soutiendrait plus fermement la conception des puces, les capacités de production et les investissements en recherche et développement. Ces demandes témoignent d'un changement de mentalité fondamental : l'industrie ne considère plus la résilience uniquement comme une question de logistique de la chaîne d'approvisionnement ou de parts de marché, mais comme un domaine nécessitant des investissements publics, une politique industrielle et une orientation stratégique à long terme.
L'ensemble de la chaîne de valeur doit être analysé de manière critique. L'Europe possède des atouts dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs, notamment dans les semi-conducteurs de puissance, les microcontrôleurs et les capteurs. Cependant, des faiblesses existent au niveau des puces logiques hautement intégrées, de la mémoire et surtout en amont de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les matières premières, les équipements de production et les outils de conception. Une stratégie globale doit donc prendre en compte l'ensemble de cette chaîne.
Outre les semi-conducteurs, d'autres secteurs critiques doivent être identifiés. Il s'agit notamment des aimants permanents et de leurs précurseurs, en particulier pour les éoliennes et l'électromobilité ; des batteries lithium-ion pour l'électromobilité et de leur chaîne d'approvisionnement complète ; de l'industrie photovoltaïque, notamment des lingots, des plaquettes, du verre solaire, des cellules et des modules ; et du développement d'un marché de premier plan pour l'acier vert. À court terme, la résilience doit être renforcée par des investissements ciblés dans les industries de transformation nationales et par l'attraction en Allemagne et en Europe des segments les plus critiques des chaînes d'approvisionnement.
Deuxième levier : Transformation des modèles de résilience juste-à-temps vers des modèles hybrides avec systèmes tampons intelligents
Le concept d'entrepôt tampon de pré-approvisionnement, tel que décrit dans les recherches sur les entrepôts à conteneurs de grande hauteur, représente une réponse novatrice au dilemme entre efficacité et résilience. Pendant des décennies, cette dichotomie entre deux objectifs a été considérée comme insurmontable. Soit on optimise les coûts en minimisant les stocks, soit on renforce la sécurité d'approvisionnement par un stockage massif. Les entrepôts tampons de pré-approvisionnement pour conteneurs résolvent cette apparente contradiction grâce à l'innovation technologique.
L'idée repose sur le transfert d'une technologie éprouvée de rayonnages grande hauteur, issue de la sidérurgie, à la logistique portuaire. Un fabricant allemand de machines et d'installations, fort de 150 ans d'expérience dans la métallurgie, avait initialement développé des systèmes pour la manutention automatisée de bobines d'acier pesant jusqu'à 40 tonnes, dans des rayonnages atteignant 50 mètres de hauteur. Cette technologie a ensuite été adaptée à la manutention de conteneurs. Après des essais concluants portant sur plus de 63 000 mouvements de conteneurs dans un terminal du port de Jebel Ali à Dubaï, le système était prêt à être commercialisé.
Alors que les parcs à conteneurs classiques empilent les conteneurs directement les uns sur les autres sur six niveaux maximum, nécessitant un réempilage pour 30 à 60 % des mouvements, la technologie des rayonnages grande hauteur permet un empilage vertical jusqu'à 11, voire 18 niveaux, avec un accès direct à chaque conteneur. Chaque conteneur dispose de son propre emplacement dans une structure métallique, desservie par des machines de stockage et de récupération électriques entièrement automatisées. Ce système triple la capacité de manutention tout en réduisant la surface au sol requise de 70 %.
Les implications économiques sont considérables. Dans les zones portuaires, où le prix du terrain constructible oscille entre deux et trois mille euros le mètre carré, économiser trois hectares de terrain pour une capacité de stockage de seulement trois mille EVP représente un gain de coût de soixante à quatre-vingt-dix millions d'euros. Cette optimisation du capital permet aux entreprises d'accroître leur sécurité d'approvisionnement sans alourdir disproportionnellement leurs charges financières.
L'entrepôt de pré-stockage de conteneurs constitue la première station de stockage avant l'entrepôt de production proprement dit. Les pièces de production en provenance de l'étranger sont transportées par conteneur, non ouvertes, jusqu'aux locaux de l'entreprise par la route et entreposées dans la zone de pré-stockage. Elles ne sont transférées du conteneur vers la zone de préparation qu'en cas de besoin. Ce pré-stockage offre une sécurité supplémentaire, en stockant des matériaux dans des conteneurs à court terme afin de garantir un approvisionnement continu pour la production. Les fluctuations d'approvisionnement en matériaux ou les ralentissements des étapes de production en amont peuvent ainsi compenser les retards du processus global.
Un entrepôt tampon de conteneurs bien conçu améliore considérablement les quatre indicateurs clés de la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Le délai de détection, c'est-à-dire le temps nécessaire pour identifier une perturbation, est réduit grâce à une gestion automatisée des stocks et à des rapports en temps réel. Le délai de réaction, c'est-à-dire le temps nécessaire pour mettre en œuvre des contre-mesures, est réduit grâce à la disponibilité immédiate des matériaux. Le délai de rétablissement, c'est-à-dire le temps nécessaire pour retrouver une pleine capacité opérationnelle, est accéléré par l'indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales. La durée de survie, c'est-à-dire la période maximale pendant laquelle une entreprise peut fonctionner sans approvisionnement, est considérablement prolongée par l'augmentation du stock de sécurité.
Les entreprises modernes ont souvent recours à une approche hybride, combinant le juste-à-temps pour les composants standard et le juste-à-cas pour les matériaux sensibles ou critiques. Cette stratégie allie efficacité et sécurité d'approvisionnement. Les composants ou matériaux critiques, difficiles à anticiper, sont stockés selon le principe du juste-à-cas, tandis que le juste-à-temps est appliqué aux produits standardisés et facilement disponibles. Cette approche permet de minimiser les risques tout en maîtrisant les coûts.
D'après une étude de l'ifo, environ 23 % des entreprises augmentent leurs niveaux de stocks. Les petites et moyennes entreprises (PME) privilégient particulièrement l'accroissement de leurs réserves, la diversification de leurs fournisseurs s'avérant souvent difficile pour elles. Une grande partie des produits intermédiaires critiques proviennent de Chine. Leur indisponibilité ou leurs retards de livraison peuvent entraîner l'effondrement de la production, et par conséquent de toute la chaîne d'approvisionnement. L'augmentation des stocks de ces produits vise à garantir une meilleure sécurité à l'avenir, illustrant une nette évolution de la production, passant du flux tendu à la production de précaution.
Convient à:
- Nearshoring : lorsque les crises mondiales rencontrent des chaînes d'approvisionnement fragiles, la nécessité se transforme en innovation
Troisième levier : diversification et régionalisation des chaînes d'approvisionnement par le biais de la relocalisation de proximité et des partenariats stratégiques
L'extrême concentration des chaînes de valeur dans certaines régions, notamment en Chine, s'est révélée être une vulnérabilité stratégique. La diversification n'est donc plus une option de gestion des risques, mais une question de survie pour l'industrie européenne.
La relocalisation de la production vers les pays voisins prend une importance considérable. Les investissements dans ce domaine ont augmenté de 62 % en 2022 et 2023 par rapport à la période 2018-2019. Les dépenses d'investissement moyennes par projet ont triplé par rapport à 2019, atteignant 131 millions de dollars.
La relocalisation de proximité réduit les délais, améliore la réactivité et favorise souvent une meilleure compatibilité culturelle et temporelle. Par exemple, une entreprise allemande pourrait opter pour une filiale en Pologne plutôt que de relocaliser sa production en Allemagne afin de concilier coûts de main-d'œuvre plus bas et proximité géographique.
Des exemples marquants illustrent cette dynamique. Le constructeur automobile allemand BMW a délocalisé sa production vers des pays comme la Hongrie et la République tchèque. BMW bénéficie ainsi de coûts de main-d'œuvre plus bas tout en restant proche de ses principaux marchés. L'entreprise a investi plus de deux milliards d'euros dans son usine de Debrecen, en Hongrie. Bosch, un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de services, a également transféré une partie de sa production en Hongrie et en Slovaquie.
D'après une étude ABB de 2022, 86 % des entreprises allemandes et 74 % des entreprises européennes envisagent de relocaliser ou de rapprocher leurs activités. L'industrie automobile est particulièrement concernée. Une étude de Porsche Consulting révèle des tendances sectorielles spécifiques en matière de relocalisation. Les équipementiers automobiles manifestent une forte propension à se rapprocher des constructeurs automobiles pour des raisons d'efficacité ou de durabilité.
Outre la diversification géographique, la diversification des fournisseurs est également essentielle. Les entreprises doivent veiller à diversifier leurs fournisseurs. Compte tenu du risque d'imprévus liés à la situation politique ou aux conditions météorologiques, ces fournisseurs doivent être répartis géographiquement autant que possible. Cela permet de réduire les dépendances et de compenser les effets des fluctuations et perturbations externes.
Le « friendshoring », qui consiste à limiter les échanges internationaux aux pays avec lesquels on partage des valeurs politiques communes, prend également de l'importance. Lors du Dialogue mondial de Berlin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un plan ambitieux visant à réduire significativement la dépendance à l'égard de la Chine, inspiré de la politique énergétique mise en œuvre après l'arrêt des exportations de gaz russe. L'objectif est de garantir un accès à court, moyen et long terme à des sources alternatives de matières premières essentielles pour les industries européennes.
Parallèlement, l'UE entend nouer des partenariats ciblés avec des pays comme l'Ukraine, l'Australie, le Canada, le Kazakhstan, le Chili et le Groenland. L'ambassadeur de facto de Taïwan en Allemagne a déclaré que la priorité accordée par Ursula von der Leyen à la réduction des risques liés à la Chine était judicieuse. De nombreuses entreprises taïwanaises investissent désormais en Asie du Sud-Est plutôt qu'en Chine.
Bénéficiez de la vaste expertise quintuple de Xpert.Digital dans un package de services complet | BD, R&D, XR, PR & Optimisation de la visibilité numérique
Bénéficiez de la vaste expertise de Xpert.Digital, quintuple, dans une offre de services complète | R&D, XR, RP et optimisation de la visibilité numérique - Image : Xpert.Digital
Xpert.Digital possède une connaissance approfondie de diverses industries. Cela nous permet de développer des stratégies sur mesure, adaptées précisément aux exigences et aux défis de votre segment de marché spécifique. En analysant continuellement les tendances du marché et en suivant les évolutions du secteur, nous pouvons agir avec clairvoyance et proposer des solutions innovantes. En combinant expérience et connaissances, nous générons de la valeur ajoutée et donnons à nos clients un avantage concurrentiel décisif.
En savoir plus ici :
Accélérer la réduction de la bureaucratie : les guichets uniques comme avantage de localisation – les stocks de sécurité rendent les chaînes d’approvisionnement plus résilientes et plus efficaces.
Quatrième levier : La numérisation et l'industrie 4.0 pour accroître la transparence et l'adaptabilité
La numérisation n'est pas une fin en soi, mais un levier fondamental pour une production résiliente et efficace. L'intégration de l'Internet des objets, de l'analyse des mégadonnées, de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques transforme les chaînes d'approvisionnement, passant de systèmes réactifs à des systèmes proactifs.
D'après une étude de PwC et Strategy&, les entreprises industrielles allemandes prévoient d'investir massivement dans les applications numériques au cours des cinq prochaines années. En moyenne, elles entendent consacrer environ 3,3 % de leur chiffre d'affaires annuel aux solutions de l'Industrie 4.0, soit un investissement annuel de plus de 40 milliards d'euros. Dès 2020, plus de 80 % des entreprises industrielles interrogées ambitionnaient de numériser leur chaîne de valeur.
Les entreprises anticipent que la numérisation de leurs chaînes de valeur permettra d'améliorer leurs processus et de réaliser d'importantes économies. En moyenne, les entreprises interrogées prévoient un gain d'efficacité de 3,3 % par an. Parallèlement, les solutions numériques devraient contribuer à réduire les coûts de 2,6 % par an.
Les entreprises ayant déjà largement numérisé leur offre de produits et de services ont connu une croissance supérieure à la moyenne ces trois dernières années. Près de 70 % des entreprises proposant des produits fortement numérisés ont enregistré une croissance comprise entre 6 et 10 % au cours de cette période. L'étude estime que l'industrie allemande pourrait générer 30 milliards d'euros supplémentaires par an grâce aux produits et services numériques.
La visibilité est essentielle à la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Garder une vue d'ensemble de tous les processus pertinents permet de réagir rapidement aux problèmes, de préserver le contrôle et de planifier de manière proactive. Les plateformes numériques permettant un suivi en temps réel offrent une transparence et une flexibilité accrues. Une communication fiable est indispensable à cet égard ; elle est rendue possible par des outils numériques tels que les logiciels spécialisés de gestion de la chaîne d'approvisionnement.
L'Internet des objets joue un rôle central dans la Logistique 4.0. Capteurs et appareils intelligents collectent en continu des données permettant d'optimiser les processus logistiques. Cela va de la surveillance des conditions d'entrepôt à l'optimisation des itinéraires de transport. Dans le contexte des entrepôts tampons de conteneurs, cela implique l'intégration de systèmes de suivi RFID pour un suivi en temps réel des stocks et de contrats intelligents via la technologie blockchain, garantissant que les fournisseurs ne livrent les matières premières que lorsque la production en a besoin.
L'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle exploitent le flux massif de données générées par les objets connectés et d'autres sources. Les algorithmes permettent d'identifier des tendances, d'optimiser les processus et de prendre des décisions éclairées en temps réel. L'analyse prédictive transformera le rôle des stocks de sécurité. Au lieu de réagir aux pénuries de matières premières, les systèmes intelligents anticiperont les fluctuations de la demande et ajusteront proactivement les niveaux de stock. Des études montrent que la prévision de la demande basée sur l'IA dans un environnement de production à flux tendu (JIT) peut réduire les coûts de stockage de 20 à 30 % tout en améliorant les taux d'exécution des commandes.
L'intégration de la technologie des jumeaux numériques permet la surveillance et la simulation en temps réel des opérations d'entrepôt avant la mise en œuvre de modifications physiques. D'ici 2035, le marché des terminaux à conteneurs automatisés devrait atteindre 20,3 milliards de dollars américains, porté par les progrès de la robotique, des véhicules autonomes et des systèmes logistiques basés sur l'intelligence artificielle.
Convient à:
Cinquième levier : Réduction radicale de la bureaucratie et accélération des processus d'approbation
La bureaucratie est l'un des facteurs négatifs les plus fréquemment cités pour l'Allemagne et l'Europe en tant qu'implantation d'entreprises. En 2024, le poids de la bureaucratie a coûté à l'économie allemande environ 67,5 milliards d'euros, soit près de 1,5 % de son PIB. Cela réduit considérablement la productivité.
Un deuxième aspect important est la rapidité. Même avec des démarches administratives minimales, un processus peut s'avérer très long, par exemple si ses différentes étapes ne sont pas mises en œuvre simultanément mais séquentiellement. De ce fait, les entreprises peuvent être contraintes de retarder la mise en service de leurs sites de production, de reporter le lancement de leurs processus de vente, voire de renoncer à certains projets d'innovation.
Troisièmement, les procédures bureaucratiques comportent généralement une part de pouvoir discrétionnaire. Les règles peuvent être interprétées de manière à éliminer tout risque potentiel par le biais de la réglementation. Inversement, l'administration peut également évaluer les risques et, en fonction de leur probabilité d'occurrence, décider des réglementations réellement nécessaires pour garantir un fonctionnement sûr. Cette dernière approche favorise généralement une plus grande activité économique.
Pour la mise en place d'unités de production, des études pratiques ont démontré que les guichets uniques centralisés pour l'ensemble des processus connexes peuvent s'avérer particulièrement efficaces. Ces études sont également parfaitement adaptées à l'harmonisation des réglementations aux niveaux fédéral, régional et européen et à l'élimination des doublons.
Il convient également de s'intéresser au coût de la mise en œuvre d'une réglementation pertinente. Les processus analogiques devraient être remplacés par des flux de travail entièrement électroniques et une plateforme nationale de notifications et d'approbations. Une qualité réglementaire comparable peut être atteinte par différentes approches. Les approches fondées sur les risques, qui reposent sur une pondération des probabilités, offrent une perspective prometteuse.
L'objectif n'est pas d'abolir la bureaucratie, mais de la moderniser, de la rendre plus rentable et d'en accélérer la mise en œuvre. Un État fonctionnel doté d'une bureaucratie rationalisée constitue alors un véritable atout concurrentiel. Les entreprises allemandes attendent du nouveau gouvernement fédéral qu'il procède à des réductions drastiques de la bureaucratie, tout en améliorant la rapidité et l'efficacité des processus.
Convient à:
- Administration et bureaucratie allemandes : 835 millions d’euros par jour – Les coûts pour les fonctionnaires allemands explosent-ils vraiment ?
Sixième levier : privilégier la qualité, l’innovation et le partenariat plutôt que la simple concurrence par les prix.
Le message clé de Jana Tischler mérite une attention particulière : Baier & Michels démontre qu’une production réussie est possible en Allemagne si l’on pense différemment, si l’on calcule équitablement et si l’on se concentre sur la qualité et le partenariat plutôt que sur la pression des prix.
Cette position contredit une pratique d'achat courante axée principalement sur la réduction des coûts. Lorsque les entreprises font du prix le plus bas le seul critère de chaque décision d'approvisionnement, elles créent des incitations qui, à long terme, entraînent une érosion de la valeur ajoutée. Les fournisseurs, constamment soumis à une pression sur les prix, n'ont aucune marge de manœuvre pour investir dans la qualité, l'innovation ou la résilience. Ils sont contraints de réduire les coûts autant que possible, quitte à délocaliser la production vers des pays à bas salaires ou à faire des compromis sur la qualité.
Le modèle alternatif repose sur des partenariats à long terme, une tarification équitable et la conviction que la qualité et la sécurité d'approvisionnement ont un coût. Une solide réputation de qualité confère à une marque un avantage concurrentiel, lui permettant de pratiquer des prix plus élevés. Les clients sont souvent disposés à payer un prix supérieur pour des produits qu'ils perçoivent comme étant de haute qualité, ce qui permet aux entreprises d'améliorer leurs marges bénéficiaires.
Une qualité de produit constante renforce la fidélité des clients, ce qui se traduit par une augmentation des ventes et des commandes répétées. Elle contribue également à améliorer la réputation de la marque, à attirer davantage de clients et à accroître la part de marché de l'entreprise. Les mesures de contrôle qualité jouent un rôle crucial dans l'amélioration des performances financières d'une entreprise.
Fabriqués en Allemagne, les produits allemands jouissaient d'une qualité et d'un savoir-faire légendaires. Cette maîtrise, fondée sur la qualité et la fiabilité des produits, a favorisé la croissance des entreprises, préservé les emplois, généré des recettes fiscales et offert à la société les bases de décennies de prospérité, de bien-être et de paix. De nombreuses entreprises allemandes, notamment celles appartenant au Mittelstand (PME), un segment exceptionnellement dynamique et innovant à l'échelle mondiale, ont continué à œuvrer pour devenir des leaders de la qualité sur leurs marchés.
Investir dans des mesures de contrôle qualité, telles que des inspections régulières et des tests rigoureux, permet de garantir que les produits répondent constamment à des normes élevées. De plus, cela permet aux entreprises d'identifier et de résoudre les problèmes rapidement, réduisant ainsi le risque de rappels de produits ou d'insatisfaction client. Le contrôle qualité favorise l'amélioration continue. Il fournit des informations précieuses sur le processus de production et permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées par les données afin d'améliorer leurs opérations et leur offre de produits.
Septième levier : Augmentation massive des investissements en recherche et développement, axée sur la création de valeur
L'Europe investit trop peu dans la recherche et le développement par rapport aux autres pays. Avec seulement 2,1 % de son produit intérieur brut en 2021, elle accuse un retard considérable par rapport aux États-Unis (3,5 %), à la Chine (2,4 %), à Israël (5,6 %), à la Corée du Sud (4,9 %) et au Japon (3,5 %).
L’UE et ses États membres doivent s’engager clairement à investir massivement dans la recherche, notamment dans les technologies d’avenir et clés, afin de bâtir un espace européen de la recherche durable, résilient et compétitif. Les prochaines années seront cruciales pour éviter de se laisser distancer par les pays qui rivalisent grâce à des milliards de subventions et des conditions d’implantation attractives.
Les entreprises représentent les deux tiers des dépenses de recherche en Europe. Le soutien financier public à la recherche et au développement s'avère un levier essentiel pour l'ensemble de l'écosystème de la recherche, encourageant les collaborations interentreprises dans un cadre précompétitif et une intégration étroite avec le monde universitaire et les PME. Les entreprises allemandes à forte intensité de recherche sont en tête des investissements parmi leurs homologues européennes. En 2022, elles représentaient 46,4 % des dépenses totales de recherche industrielle dans l'UE.
Parallèlement, l'Europe accuse un retard relatif en matière de transfert de la recherche vers la création de valeur. L'interface entre la recherche financée par des fonds publics et la production et la mise à l'échelle commercialisables – autrement dit, le processus de transfert – doit être renforcée de toute urgence en Allemagne et en Europe. L'objectif principal doit être d'intégrer les projets de recherche dans des applications industrielles plus larges.
Des mesures de politique industrielle d'accompagnement sont nécessaires pour préserver la compétitivité internationale de l'industrie, souvent confrontée à d'immenses défis lors des phases de transformation. L'objectif final est de valoriser les résultats de la recherche sur le marché. Par conséquent, l'ensemble de la chaîne de développement doit être intégré et coordonné, depuis l'idée ou la découverte initiale jusqu'à la commercialisation du produit fini et l'élaboration des normes.
Notamment dans des domaines numériques clés comme l'intelligence artificielle et l'économie des données, les États-Unis et la Chine progressent à des rythmes différents. De plus, on constate un manque d'innovations de rupture. Les entreprises allemandes excellent dans l'optimisation des processus existants. Cependant, les innovations qui révolutionnent les modèles économiques et les chaînes de valeur sont rarement d'origine allemande.
Convient à:
- La Chine et le Neijuan du surinvestissement systématique : le capitalisme d'État comme accélérateur de croissance et piège structurel
La dialectique de l'efficacité et de la résilience : pourquoi l'Europe a besoin des deux
La crise de Nexperia a brutalement révélé que le modèle économique européen se trouve à un tournant décisif. Des décennies d'optimisation unilatérale axée sur la réduction des coûts ont engendré des dépendances qui se révèlent aujourd'hui être des vulnérabilités stratégiques. La solution ne saurait toutefois consister à faire basculer le pendule dans l'autre sens et à ériger l'autarcie en objectif. Il s'agit plutôt de trouver un nouvel équilibre entre les avantages de la division internationale du travail et la nécessité d'une autonomie stratégique dans les domaines critiques.
Les sept leviers identifiés ne constituent pas un programme séquentiel, mais plutôt un ensemble systémique de mesures qui ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont considérées conjointement. L'autonomie stratégique dans les technologies critiques, sans transformation simultanée de la logique de gestion des stocks, demeure incomplète. La relocalisation de proximité sans numérisation compromet le potentiel d'efficacité. Réduire la bureaucratie sans privilégier la qualité et l'innovation conduit à une course au moins-disant. Les investissements en recherche non traduits en création de valeur sont vains.
La question posée par Jana Tischler, à savoir où se situent les principaux leviers pour restaurer la puissance industrielle de l'Europe, ne peut être résolue par une solution unique et simpliste. Ces leviers résident dans la combinaison judicieuse des sept dimensions, dans la capacité à résoudre efficacement les contradictions apparentes et dans la capacité à tirer parti de la crise pour opérer un réalignement fondamental.
L’Europe doit, comme le dit Tischler, retrouver confiance en elle et agir avant que d’autres ne décident à sa place. Cette confiance ne saurait toutefois reposer sur une glorification nostalgique de ses forces passées, mais doit s’appuyer sur une analyse lucide de ses faiblesses actuelles et une vision résolue des perspectives d’avenir. Les outils existent, les technologies sont disponibles, les connaissances sont là. Ce qui fait défaut, c’est la volonté politique de mobiliser les ressources nécessaires et de mettre en œuvre les réformes structurelles indispensables, même face aux résistances.
L'investissement de Baier & Michels dans une usine de production ultramoderne en Allemagne démontre qu'il est possible de produire avec succès et innovation, même dans le contexte difficile du marché allemand. La clé de ce succès réside dans l'audace de penser différemment, de pratiquer des prix équitables et de privilégier la qualité et le partenariat à la simple concurrence par les prix. Si de nombreuses entreprises suivent cet exemple, si les décideurs politiques créent un cadre propice et si la société soutient les transformations nécessaires, l'Europe a assurément le potentiel de retrouver sa puissance industrielle.
La crise de Nexperia ne doit pas être perçue comme un incident isolé, mais comme un signal d'alarme. Elle illustre avec une clarté alarmante les conséquences néfastes des dépendances extrêmes. Elle révèle également les leviers à actionner pour prévenir de telles crises à l'avenir, ou du moins pour mieux les gérer. Le stockage tampon en conteneurs, les stratégies d'entreposage hybrides, la relocalisation de proximité, la numérisation, la déréglementation, l'accent mis sur la qualité et les investissements en recherche ne sont pas des concepts théoriques, mais des solutions concrètes déjà mises en œuvre par des entreprises innovantes.
La question n'est pas de savoir si l'Europe peut retrouver sa puissance industrielle, mais si elle a la volonté de prendre les mesures nécessaires. La réponse à la question de Jana Tischler est donc la suivante : le principal levier réside dans la transformation globale du modèle industriel européen, passant d'une approche unilatérale axée sur l'efficacité à un système équilibré qui prenne en compte à parts égales l'efficacité et la résilience, l'intégration mondiale et l'autonomie stratégique, l'optimisation des coûts et le leadership en matière de qualité. Ce processus de transformation exige des investissements massifs, des décisions audacieuses et la volonté d'abandonner des habitudes bien ancrées. Il est cependant essentiel si l'Europe ne veut pas devenir un simple pion économique dans les jeux de pouvoir géopolitiques, mais bien façonner son propre avenir.
Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial
☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand
☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !
Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital
J'attends avec impatience notre projet commun.

