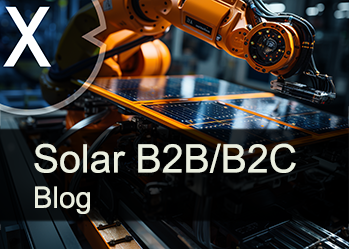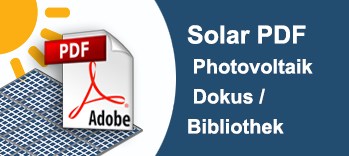L'Initiative de la ceinture solaire africaine : le jeu d'échecs géopolitique de la Chine entre domination énergétique et sécurité des matières premières
Version préliminaire d'Xpert
Sélection de voix 📢
Publié le : 20 octobre 2025 / Mis à jour le : 20 octobre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein

L'Initiative de la Ceinture solaire africaine : le jeu d'échecs géopolitique de la Chine entre domination énergétique et sécurité des matières premières – Image : Xpert.Digital
Quand l’exportation technologique devient un levier stratégique – La réorganisation des dépendances mondiales à l’ère de la transition énergétique
Ceinture solaire africaine – L'initiative chinoise de coopération Sud-Sud pour lutter contre le changement climatique
La Ceinture solaire africaine est une initiative chinoise de coopération Sud-Sud visant à lutter contre le changement climatique, officiellement lancée lors du premier Sommet africain sur le climat à Nairobi, au Kenya, en septembre 2023. Le programme vise à étendre l'approvisionnement décentralisé en énergie solaire dans les pays africains, notamment pour fournir de l'électricité aux zones rurales sans connexion au réseau.
Objectifs et portée
La Chine s'est engagée à verser 100 millions de yuans (environ 14 millions de dollars) pour équiper au moins 50 000 foyers africains de systèmes solaires domestiques entre 2024 et 2027. Ce programme représente le changement stratégique de la Chine vers des projets « petits et beaux » - des initiatives décentralisées plus petites axées sur les avantages sociaux, par opposition aux projets traditionnels à grande échelle de l'initiative Belt and Road.
L’initiative vise non seulement à alimenter les ménages en électricité, mais également à équiper les infrastructures telles que les écoles et les centres de santé en énergie solaire, améliorant ainsi les conditions de vie de la population locale.
Pays participants et progrès
Depuis son lancement, la Chine a signé des protocoles d'accord bilatéraux avec plusieurs pays africains. Parmi les pays partenaires figurent :
- Tchad : 4 300 systèmes solaires
- São Tomé et Príncipe : 3 100 installations photovoltaïques
- Aller
- Mali : Installation de 1 195 systèmes solaires domestiques hors réseau et de 200 lampadaires solaires dans le village de Koniobla
- Burundi : 4 000 systèmes solaires (accordé lors du sommet du FOCAC 2024)
La Chine a également mené des négociations avec dix pays africains, dont le Kenya, le Nigéria, le Ghana et le Burkina Faso. Les cinq pays ayant signé des accords devraient permettre à environ 20 000 foyers d'accéder à l'électricité.
Intégration dans un contexte plus large
La Ceinture solaire africaine s'inscrit dans la stratégie plus large de la Chine visant à « verdir » ses investissements étrangers dans le secteur énergétique. En 2021, la Chine, aux côtés de 53 pays africains et de l'Union africaine, s'est engagée, dans la Déclaration sur la coopération sino-africaine en matière de lutte contre le changement climatique, à cesser de financer de nouveaux projets de centrales à charbon à l'étranger et à accroître ses investissements dans les énergies propres en Afrique.
Les entreprises chinoises ont déjà installé plus de 1,5 gigawatt de centrales photovoltaïques en Afrique. Parmi leurs projets phares figurent la centrale solaire de 50 MW de Garissa, au Kenya (produisant plus de 76 millions de kWh par an) et le projet de 100 MW de Kabwe, en Zambie, le plus grand du genre dans le pays.
Ceinture solaire africaine : le turbo de la transition énergétique de l'Afrique et de la Chine
Malgré ce potentiel, la Chine et ses partenaires africains sont confrontés à d'importants défis de mise en œuvre. Les experts soulignent des difficultés telles que le manque de données fiables pour identifier la demande d'électricité, le développement de modèles économiques durables pour les projets d'énergies renouvelables décentralisés et le développement des capacités techniques locales d'exploitation et de maintenance.
Le marché solaire africain connaît néanmoins une croissance considérable : 2,4 GW de nouvelles capacités solaires ont été installées en 2024, et une augmentation de 42 % est attendue pour 2025. Le continent possède 60 % des meilleures ressources solaires du monde, mais n'utilise actuellement qu'une fraction de ce potentiel : en 2023, seulement 3 % de la production d'électricité provenait de l'énergie solaire.
La ceinture solaire africaine représente une étape importante vers l’exploitation de l’énorme potentiel solaire de l’Afrique tout en luttant contre la pauvreté énergétique – environ 600 millions de personnes sur le continent vivent actuellement sans accès à l’électricité.
L'offensive énergétique de la Chine en Afrique : le cadre stratégique d'un changement de puissance mondial
La transition énergétique mondiale a ouvert une nouvelle arène géopolitique dans laquelle la Chine joue un rôle prépondérant. La Ceinture solaire africaine, officiellement annoncée lors du premier Sommet africain sur le climat en 2023, représente bien plus qu'un projet philanthropique de protection climatique. Avec un engagement initial de 100 millions de yuans pour l'électrification de 50 000 foyers africains grâce à des systèmes solaires hors réseau entre 2024 et 2027, la Chine met en place un discours stratégique qui associe trois objectifs économiques fondamentaux : le développement de nouveaux marchés pour une industrie solaire en surcapacité, la sécurisation à long terme des matières premières essentielles à sa propre transition énergétique et la consolidation des sphères d'influence géopolitiques dans un ordre mondial multipolaire.
L'ampleur de cette stratégie ne devient compréhensible que dans le contexte de la crise de surcapacité de la Chine. Fin septembre 2025, l'industrie solaire chinoise a atteint une capacité de production installée de 1,1 térawatt, soit environ 1,5 fois la charge de pointe totale du réseau électrique américain. Cette surproduction spectaculaire, alimentée par des années de subventions gouvernementales et d'orientations de politique industrielle, a entraîné un effondrement des prix des modules solaires de plus de 30 % en 2024 et des pertes collectives des six plus grands fabricants solaires chinois s'élevant à 2,8 milliards de dollars pour le seul premier semestre 2025. Dans ce contexte, l'Afrique devient un débouché indispensable pour les excédents d'exportation chinois : entre juin 2024 et juin 2025, le continent a importé de Chine des panneaux solaires d'une capacité de 15 gigawatts, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente.
Parallèlement, la Chine contrôle déjà 15 des 17 mines de cobalt et de cuivre de la République démocratique du Congo, a investi plus de 4,5 milliards de dollars dans des projets de lithium au Zimbabwe, au Mali et en Namibie depuis 2021, et domine 72 % du marché mondial du cobalt et 60 à 70 % de la transformation du lithium et du graphite. Cette intégration verticale de l'extraction des matières premières, de leur transformation et de la fabrication des produits finis crée une chaîne de dépendance qui va bien au-delà des schémas d'extraction coloniaux traditionnels et établit une nouvelle forme d'hégémonie technico-industrielle.
Convient à:
Lignes historiques de développement : de l'initiative Belt and Road au Partenariat pour le développement vert
Les racines de la Ceinture solaire africaine se trouvent dans l'Initiative Ceinture et Route, lancée en 2013, qui a investi plus d'un trillion de dollars américains dans des projets d'infrastructures dans plus de 150 pays d'ici 2024. En Afrique, ces investissements se sont d'abord concentrés sur des projets de combustibles fossiles à grande échelle : entre 2000 et 2021, les banques politiques chinoises - la Banque d'import-export de Chine et la Banque de développement de Chine - ont accordé 182 milliards de dollars américains de prêts, dont 15 % sont allés à des projets de combustibles fossiles et 12 % à des centrales hydroélectriques, tandis que moins d'un pour cent est allé à l'énergie solaire et éolienne.
Le tournant décisif s'est produit en 2021, lorsque le président Xi Jinping a annoncé la fin du financement chinois des centrales à charbon à l'étranger. Cette annonce résultait moins d'une soudaine intuition écologique que de la conjonction de plusieurs facteurs : les critiques internationales concernant le bilan climatique de la Chine, la parité croissante des coûts des énergies renouvelables, l'endettement excessif de plusieurs pays partenaires africains et la nécessité stratégique de développer de nouveaux marchés pour les capacités excédentaires nationales. La Déclaration sur la coopération sino-africaine en matière de lutte contre le changement climatique, adoptée en 2021 par la Chine, 53 États africains et l'Union africaine, a marqué la transition formelle vers un Partenariat pour le développement vert.
Lors du Forum sur la coopération sino-africaine 2024 à Pékin, ce réalignement a été concrétisé par un engagement de financement de 50,7 milliards de dollars pour la période 2024-2027, qui s'écartait toutefois sensiblement des engagements précédents : la part des prêts purs a été réduite au profit d'une combinaison de financement du commerce, d'investissements directs des entreprises et d'aide au développement ciblée. Ce changement reflète à la fois le ralentissement économique de la Chine elle-même – la croissance du PIB est passée de taux à deux chiffres dans les années 2000 à moins de 5 % en 2024 – et les leçons tirées de l'échec de grands projets tels que le chemin de fer éthiopien Addis-Abeba-Djibouti, qui, pour un coût total de quatre milliards de dollars, n'est jamais devenu rentable et a donné lieu à de longues négociations sur la restructuration de la dette.
L’évolution historique de l’engagement de la Chine en Afrique peut ainsi être caractérisée comme une évolution d’une extraction axée sur les ressources vers des méga-infrastructures financées par la dette, puis vers une stratégie hybride combinant des projets à plus petite échelle avec une pénétration industrielle à long terme.
Mécanismes économiques : acteurs, incitations et dynamique du système
Le modèle économique de la Ceinture solaire chinoise repose sur une constellation complexe d'acteurs et de structures incitatives qui allient orientation de l'État et expansion du secteur privé. Côté chinois, on distingue trois acteurs principaux : les banques publiques, comme l'Export-Import Bank of China, financent des projets d'envergure grâce à des prêts concessionnels, tandis que les entreprises publiques comme PowerChina, China Jiangxi Corporation et CMOC gèrent la mise en œuvre technique et diversifient de plus en plus leurs activités dans l'extraction de matières premières. Des entreprises privées comme LONGi, JA Solar et Trina Solar dominent la production de modules et, confrontées à la contraction de leurs marges nationales, recherchent activement des marchés étrangers.
Du côté africain, la composition des acteurs varie considérablement : si des pays comme le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Égypte ont mis en place des ministères de l’Énergie, des autorités de régulation et des services publics partiellement privatisés, l’Afrique subsaharienne manque souvent des capacités institutionnelles nécessaires pour négocier des structures de financement complexes. Des projets solaires d’une capacité totale de neuf gigawatts sont actuellement en construction dans 45 des 54 pays africains, dont cinq pays – l’Algérie, l’Angola, l’Égypte, l’Afrique du Sud et la Zambie – représentent 70 % de cette capacité.
Les mécanismes de marché de cette expansion suivent un modèle spécifique : la Chine propose des offres intégrées combinant financement, technologie, construction et souvent exploitation – un modèle que les concurrents occidentaux parviennent rarement à reproduire. Ces offres sont généralement proposées à des conditions préférentielles – avec des taux d'intérêt compris entre 2 et 4 % et des durées de 15 à 20 ans – mais sont souvent liées à des entrepreneurs et des équipements chinois et contiennent des clauses opaques concernant la sécurité et le règlement des litiges.
Les moteurs économiques du côté chinois sont évidents : premièrement, l’exportation des capacités de production excédentaires permet de stabiliser les entreprises et les emplois nationaux. Deuxièmement, les projets d’infrastructures garantissent des droits d’accès à long terme aux matières premières, souvent grâce à des prêts garantis par des ressources, dont le remboursement s’effectue par le biais de pétrole, de cuivre ou de lithium. Troisièmement, la dépendance technologique des systèmes énergétiques africains aux normes, brevets et pièces détachées chinois crée des relations commerciales durables.
Du côté africain, trois facteurs principaux stimulent la demande : premièrement, l’énorme déficit d’électrification – 600 millions de personnes, soit 43 % de la population, vivent sans accès à l’électricité, avec des déficits particulièrement importants en Afrique subsaharienne, où vivent 85 % des personnes non électrifiées dans le monde. Deuxièmement, le sous-financement structurel du secteur énergétique, les donateurs occidentaux traditionnels et les banques multilatérales ayant réduit leurs engagements après la crise financière de 2008. Troisièmement, les engagements en matière de politique climatique pris dans le cadre de l’Accord de Paris et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui fixent des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables sans fournir d’instruments de financement adéquats.
La dynamique systémique de ce dispositif génère des boucles de rétroaction à la fois positives et négatives : les effets positifs découlent de réductions rapides des coûts – les prix des panneaux solaires ont chuté de plus de 90 % depuis 2010, rendant les projets viables même dans les régions pauvres en capitaux. Les effets négatifs découlent de l’émergence d’effets de verrouillage technologique qui compliquent la diversification ultérieure, ainsi que de l’accumulation de la dette publique, qui a déjà conduit, dans plusieurs cas, à des crises de restructuration de la dette.
Situation actuelle : données, indicateurs et défis structurels
L'évaluation quantitative de la Ceinture solaire africaine révèle à la fois une dynamique de croissance impressionnante et des problèmes structurels persistants. Entre 2020 et 2024, 84 projets énergétiques financés ou construits par la Chine ont été recensés en Afrique, pour une capacité totale de plus de 32 gigawatts et des investissements d'au moins 33 milliards de dollars. Ces projets sont répartis géographiquement dans 30 pays, avec des focus régionaux en Afrique du Sud (35 projets), en Afrique de l'Ouest (22), en Afrique de l'Est (16), en Afrique centrale (6) et en Afrique du Nord (5).
La répartition technologique montre une nette domination des énergies renouvelables : l’hydroélectricité et le solaire dominent le portefeuille, complétés par le gaz, l’éolien, le charbon, la géothermie, la biomasse et les systèmes expérimentaux d’énergie houlomotrice. La croissance rapide des projets solaires purs est remarquable : en 2024, 2,5 gigawatts de capacité solaire ont été installés sur le continent, et les prévisions tablent sur un bond à 3,4 gigawatts d’ici 2025, soit une augmentation de 42 %. D’ici 2028, la capacité solaire installée en Afrique devrait dépasser 23 gigawatts, soit plus du double.
Les balances commerciales illustrent l'asymétrie économique de la relation : les échanges bilatéraux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un volume de 222 milliards de dollars US au cours des huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 15,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, les exportations chinoises vers l'Afrique ont augmenté de 24,7 % pour atteindre 140,79 milliards de dollars US, tandis que les exportations africaines vers la Chine n'ont progressé que de 2,3 % pour atteindre 81,25 milliards de dollars US. Il en a résulté un déficit commercial de 59,55 milliards de dollars US pour l'Afrique en seulement huit mois, soit presque équivalent au déficit global de 61,93 milliards de dollars US pour 2024.
Français La dimension des matières premières illustre les priorités stratégiques de la Chine : En 2020, la Chine importait 90 % de son cobalt de la République démocratique du Congo, et en 2024, la Côte d'Ivoire était le troisième fournisseur de minerai de nickel de la Chine. Au Zimbabwe, qui possède les plus grandes réserves de lithium d'Afrique et les cinquièmes au monde, des entreprises chinoises telles que Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group et Chengxin Lithium Group ont investi plus d'un milliard de dollars américains depuis 2021. La mine de lithium de Goulamina au Mali, exploitée par Gangfeng Lithium, a démarré sa production fin 2024 avec une capacité annuelle prévue de 506 000 tonnes de concentré de lithium en phase 1, extensible à un million de tonnes.
Les défis se manifestent à plusieurs niveaux : premièrement, malgré des investissements massifs, les taux d’électrification restent faibles – 18 des 20 pays les moins électrifiés au monde se trouvent en Afrique, certains États ayant moins de 10 % de leur population ayant accès à l’électricité. Deuxièmement, en Afrique subsaharienne, la croissance démographique dépasse les progrès de l’électrification, de sorte que le nombre absolu de personnes sans accès à l’électricité a quasiment stagné, passant de 569 millions en 2010 à 571 millions en 2022. Troisièmement, de nombreux projets échouent faute de viabilité économique – le chemin de fer à écartement standard du Kenya, par exemple, ne génère pas suffisamment de revenus pour couvrir les coûts d’exploitation, sans parler du remboursement de son prêt de 3,6 milliards de dollars.
La situation de la dette s'aggrave parallèlement : la dette publique extérieure de l'Afrique est passée de 305 milliards de dollars en 2010 à 702 milliards de dollars en 2020, soit de 24 à 40 % du PIB régional. La part de la Chine est estimée à 12 %, avec des volumes de prêts absolus de 182 milliards de dollars entre 2000 et 2023. Cependant, nombre de ces prêts sont structurés de manière opaque, utilisent les exportations de matières premières comme garantie et contiennent des clauses qui compliquent la restructuration de la dette avec les institutions multilatérales.
Études de cas comparatives : des voies de développement divergentes au Kenya, au Maroc et en Éthiopie
Une analyse détaillée des différentes trajectoires de développement dans l’intégration des investissements solaires chinois révèle l’importance des cadres institutionnels, de la priorisation stratégique et du pouvoir de négociation pour l’issue de ces partenariats.
Le Kenya représente un exemple relativement réussi de politique énergétique adaptative. Le pays produit 87 % de son électricité à partir de sources renouvelables, l'éolien, le solaire et la géothermie répondant à l'intégralité de la croissance de la demande depuis 2018. Le projet phare, la centrale solaire de Garissa, d'une puissance de 55 mégawatts, a été construite en 2018 par la China Jiangxi Corporation pour un montant de 136 millions de dollars et financée par la Banque d'import-export de Chine. La centrale couvre 85 hectares, alimente 70 000 foyers et est la plus grande centrale solaire raccordée au réseau d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Entre 2010 et 2024, 44 projets énergétiques chinois ont été mis en œuvre au Kenya, principalement pour la construction de lignes de transport et de capacités de production. Le Kenya a largement évité les projets d'énergie fossile à grande échelle et s'est concentré sur des solutions renouvelables décentralisées qui permettent l'électrification rurale.
Le succès du Kenya repose sur plusieurs facteurs : une stratégie énergétique nationale ambitieuse, initiée par le programme géothermique en 2006, une autorité de régulation performante et une structure de donateurs diversifiée offrant des possibilités de négociation. Néanmoins, en 2024, le Kenya importait de Chine 96 % de ses panneaux solaires, 81 % de ses batteries lithium-ion et 21 % de ses véhicules électriques, témoignant d'une forte dépendance technologique.
Le Maroc poursuit une stratégie radicalement différente, visant la souveraineté technologique et le leadership régional. Le pays se classe au deuxième rang africain en matière de projets d'énergies renouvelables et vise à s'approvisionner à plus de 50 % en énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2025 et à 80 % d'ici 2030. Le complexe solaire Noor-Ouarzazate, l'une des plus grandes centrales solaires thermiques à concentration au monde avec 580 mégawatts, alimente 1,3 million de foyers, dessert deux millions de personnes et élimine 800 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Point crucial, le Maroc a délibérément poursuivi la diversification technologique du projet Noor en collaborant avec des consortiums espagnols, allemands et saoudiens plutôt que de s'appuyer exclusivement sur des fournisseurs chinois.
L'approche marocaine combine l'énergie solaire thermique à grande échelle avec l'énergie éolienne – le parc éolien de Jbel Lahdid a ajouté 270 mégawatts en 2024 – et d'ambitieux projets d'exportation comme le câble Xlinks vers le Royaume-Uni, qui transportera l'énergie solaire et éolienne marocaine vers l'Europe via un câble sous-marin de 3 800 kilomètres. Cette stratégie reflète l'avantage géographique du Maroc, ses liens historiques avec l'Europe et son positionnement délibéré comme pont énergétique entre l'Afrique et l'Europe.
L'Éthiopie, en revanche, illustre les risques d'une expansion précipitée financée par l'endettement. La Chine a investi plus de quatre milliards de dollars américains dans le secteur énergétique éthiopien entre 2011 et 2018, représentant plus de 50 % de la capacité de production nouvellement ajoutée. Les énergies renouvelables représentent désormais 90 % de la capacité installée de l'Éthiopie, contre 33 % en 2010. Les entreprises chinoises ont financé et construit de grands barrages hydroélectriques et parcs éoliens, dont le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne de 6 450 mégawatts, le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique.
Cependant, ce recours massif à l'emprunt a conduit à une crise de la dette : l'Éthiopie doit environ 30 milliards de dollars à divers créanciers, et le FMI juge sa viabilité insatisfaisante. Le gouvernement éthiopien a été contraint de déclarer un défaut de paiement en 2020 et est depuis engagé dans de longues négociations de restructuration de sa dette dans le cadre du Cadre commun du G20, la Chine ayant initialement résisté à un allègement généreux de sa dette. Parallèlement, la transformation économique attendue grâce à l'accès à l'énergie n'a pas atteint les niveaux projetés, faute d'industrialisation et de réformes de marché.
La comparaison de ces trois cas démontre qu'une gestion réussie des investissements énergétiques chinois exige des capacités institutionnelles, une diversification stratégique et des évaluations réalistes de la viabilité économique. Les pays qui intègrent les investissements chinois dans des stratégies nationales de développement plus larges et cultivent des partenariats alternatifs obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui acceptent de manière opportuniste des volumes de prêts maximaux sans capacité d'absorption ni stratégies de remboursement adéquates.
Notre expertise en Chine en matière de développement commercial, de ventes et de marketing
Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie
En savoir plus ici :
Un pôle thématique avec des informations et une expertise :
- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles
- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention
- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie
- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur
Ceinture solaire africaine : l’énergie verte de la Chine – opportunité ou piège ?
Risques, distorsions et asymétries structurelles de pouvoir
Les contradictions fondamentales de la ceinture solaire africaine chinoise se manifestent aux niveaux économique, social et écologique et soulèvent des questions fondamentales sur la nature de ce partenariat de développement.
Le débat sur le piège de la dette domine les débats critiques. Si les responsables chinois et certains chercheurs affirment que la Chine ne détient que 12 % de la dette extérieure africaine – contre 35 % pour les créanciers privés occidentaux – et exagèrent ainsi le récit du piège de la dette, ce point de vue néglige plusieurs dimensions problématiques. Premièrement, les prêts chinois sont souvent structurés de manière opaque, utilisent des clauses contractuelles non publiques, incluent des clauses de renonciation à la souveraineté dans les règlements des différends et utilisent des actifs stratégiques tels que des ports ou des mines comme garantie. Deuxièmement, les prêts sont souvent accordés sans analyses rigoureuses de viabilité de la dette, comme celles pratiquées par les institutions multilatérales, ce qui entraîne une accumulation de fardeaux supplémentaires pour les pays déjà lourdement endettés.
Troisièmement, les cas de restructuration de la dette relevant du Cadre commun du G20 démontrent que les créanciers chinois acceptent des conditions nettement moins généreuses que les membres traditionnels du Club de Paris, ce qui retarde le redressement des pays endettés. Les cas de la Zambie et de l'Éthiopie témoignent d'années de négociations bloquées, la Chine exigeant initialement un traitement comparable à celui des banques multilatérales de développement, une position qui ignore les différences fondamentales de mandats et de structures de risque.
Convient à:
- Deux Chine, deux vérités: pourquoi ils doivent voir les données économiques officielles de manière critique
La dimension sociale des projets énergétiques chinois soulève d'importantes questions. Les violations des droits du travail, les normes de santé et de sécurité inadéquates et le manque d'emplois locaux sont des critiques récurrentes. Les projets hydroélectriques financés par la Chine en Zambie ont donné lieu à des protestations des travailleurs zambiens concernant les mauvaises conditions de travail. Des analyses systématiques montrent que seulement 76 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables ont été créés en Afrique, soit moins de 1 % des 10,3 millions d'emplois que compte le secteur dans le monde. Cela reflète la pratique consistant à importer de la main-d'œuvre chinoise pour les postes clés et à utiliser la main-d'œuvre locale principalement pour les travaux non qualifiés.
L'Agence internationale de l'énergie prévoit que l'Afrique subsaharienne aura besoin de quatre millions de nouveaux emplois dans le secteur des énergies renouvelables d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de zéro émission nette d'ici 2050. Cependant, il existe une pénurie massive de travailleurs qualifiés, et les programmes de formation existants sont fragmentés et sous-financés. Les politiques de contenu local, telles que celles inscrites dans la loi nigériane sur l'électricité de 2023, qui impose la participation locale à la production et à l'assemblage de panneaux solaires, de batteries et de composants éoliens, constituent des exceptions. Leur mise en œuvre échoue souvent en raison d'un manque de capacités administratives et d'un manque de fournisseurs locaux capables de respecter les normes chinoises de qualité et de coûts.
L'empreinte écologique des grands projets chinois est ambivalente. Si les centrales solaires sont par définition à faibles émissions, les mégaprojets hydroélectriques causent d'importants dommages environnementaux et sociaux : déplacements forcés de populations, destruction des écosystèmes, altération des systèmes hydrologiques et conflits transfrontaliers autour des ressources en eau. Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, par exemple, a déclenché un conflit de plusieurs années avec l'Égypte, pays dépendant du Nil et craignant une menace existentielle pour son approvisionnement en eau.
L'extraction de matières premières pour la transition énergétique chinoise engendre des impacts écologiques supplémentaires en Afrique : les mines de cobalt en République démocratique du Congo fonctionnent souvent sans réglementation environnementale adéquate, contaminant l'eau et les sols avec des métaux lourds. L'extraction du lithium au Zimbabwe consomme d'importantes quantités d'eau dans des régions déjà pauvres en eau. L'ironie de la transition énergétique verte de la Chine en Afrique perpétue des pratiques d'extraction de minerais bruns, ce qui est de plus en plus dénoncé par les groupes environnementaux.
La dimension géopolitique se manifeste par une dépendance technologique et une vulnérabilité stratégique. Les systèmes énergétiques africains qui dépendent de composants, de logiciels, de maintenance et de pièces détachées chinois créent des dépendances à long terme difficiles à diversifier. Les normes et les brevets intégrés à ces systèmes peuvent rendre les futures expansions ou intégrations avec des technologies non chinoises plus coûteuses, voire impossibles. En cas de conflit – par exemple, tensions autour de Taïwan ou litiges territoriaux maritimes en mer de Chine méridionale – la Chine pourrait théoriquement perturber les chaînes d'approvisionnement ou retirer son soutien technique, compromettant ainsi la sécurité énergétique de l'Afrique.
Les déficits de transparence et de gouvernance sont structurels. Le principe de non-conditionnalité de la Chine – la promesse de ne pas exiger de réformes politiques ou économiques, comme le font les donateurs occidentaux – est souvent présenté comme un avantage par les gouvernements africains. Cependant, cette position permet également une coopération avec des régimes autoritaires sans obligation de rendre des comptes, ce qui encourage la corruption, le détournement de fonds et la perpétuation des élites extractives. Au Zimbabwe, par exemple, les revenus du lithium profitent principalement à l'élite dirigeante de la ZANU-PF, tandis que la population en bénéficie à peine.
Chemins de développement et scénarios disruptifs
Le développement futur de la ceinture solaire africaine sera déterminé par l’interaction de facteurs technologiques, économiques, géopolitiques et climatiques, qui permettent plusieurs scénarios alternatifs.
Français Le scénario de base d'expansion progressive prévoit une poursuite des tendances existantes : la Chine consolide sa position de fournisseur dominant de technologie solaire, de financement et de construction en Afrique, avec une capacité installée atteignant 50 à 70 gigawatts d'ici 2030. L'Afrique continue d'importer principalement des produits finis, tandis que la capacité de fabrication locale reste marginale et limitée aux opérations d'assemblage. Les taux d'électrification augmentent lentement mais sont inférieurs à l'Objectif de développement durable 7.1.1 d'électricité universelle d'ici 2030, avec 400 à 500 millions de personnes toujours sans accès. L'accès de la Chine aux matières premières se renforce grâce à de nouvelles acquisitions dans le lithium, le cobalt et les terres rares, et l'intégration verticale de la mine à la batterie jusqu'au véhicule électrique est presque complète.
Ce scénario impliquerait des déficits commerciaux croissants de l'Afrique avec la Chine, la perpétuation de schémas d'extraction de matières premières sans valeur ajoutée significative et une intensification des effets de verrouillage technologique. Sur le plan géopolitique, il renforcerait l'influence chinoise dans les forums multilatéraux, les États africains économiquement dépendants soutenant les positions de la Chine sur Taïwan, les droits de l'homme ou les conflits territoriaux.
Un scénario de diversification se produirait si les acteurs occidentaux investissaient massivement en Afrique et créaient de véritables alternatives aux offres chinoises. L'initiative « Global Gateway » de l'UE a promis 300 milliards d'euros pour les infrastructures dans les pays en développement, en particulier en Afrique. L'initiative américaine « Power Africa » et la Société de financement du développement pourraient être étendues sous la pression géopolitique. Si ces promesses se concrétisaient – les engagements occidentaux en matière d'infrastructures étant historiquement sous-financés et retardés par des raisons administratives – l'Afrique pourrait choisir entre des offres concurrentes, négocier de meilleures conditions et parvenir à une diversification technologique.
Cela nécessiterait toutefois que les offres occidentales soient compétitives en termes de prix, ce qui est difficile compte tenu des coûts de main-d'œuvre et d'investissement plus élevés en Europe et en Amérique du Nord, et qu'elles reproduisent les offres intégrées de financement, de construction et d'exploitation qui constituent l'avantage concurrentiel de la Chine. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et les États du Golfe pourraient également émerger comme partenaires alternatifs, notamment dans des domaines technologiques comme l'hydrogène ou les systèmes de batteries avancés.
Un scénario d'industrialisation africaine émergerait si les pays africains, collectivement et stratégiquement, insistaient sur la création de valeur locale. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), opérationnelle depuis 2021, crée théoriquement un marché unique de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de 3 400 milliards de dollars. Une véritable intégration de ce marché permettrait de réaliser des économies d'échelle qui rendraient viables la fabrication locale de panneaux solaires, de batteries et de composants.
Le Nigeria démontre déjà que la production solaire locale peut être 4 % moins chère que les importations chinoises lorsque les droits de douane et les matières premières locales sont appliqués. Les faibles coûts de l'électricité industrielle en Éthiopie (2,7 centimes de dollar par kilowattheure) offrent des avantages concurrentiels pour les étapes de production énergivores telles que la fabrication de plaquettes. La centrale sud-africaine Seraphim, d'une capacité de 300 mégawatts, démontre la faisabilité technique. Si les pays africains imposaient des restrictions à l'exportation de minéraux critiques non transformés, comme l'a fait le Zimbabwe pour le lithium brut en 2022, ils pourraient contraindre la Chine à les transformer localement.
Cependant, la réalisation de ce scénario nécessite des investissements massifs dans l'enseignement technique, les infrastructures industrielles et la recherche, ainsi que la lutte contre la fragmentation des politiques nationales au profit d'une coordination régionale. Historiquement, les initiatives d'intégration africaine ont largement déçu, les élites en place bénéficiant du statu quo des exportations de matières premières sans les risques de la transformation industrielle.
Un scénario de crise pourrait être déclenché par plusieurs perturbations : une récession mondiale ou une crise financière chinoise réduiraient drastiquement les flux de crédit vers l’Afrique. Une escalade du conflit taïwanais ou des tensions en mer de Chine méridionale pourraient entraîner des sanctions occidentales contre les exportations de technologies chinoises, ce qui déstabiliserait les systèmes énergétiques africains. Des événements extrêmes liés au changement climatique – sécheresses, inondations ou cyclones accélérés – pourraient rendre les projets de grande envergure non rentables et déclencher des crises de la dette. Une rupture technologique, telle que les avancées dans les cellules solaires à pérovskite, qui peuvent être produites de manière décentralisée et avec un faible investissement en capital, pourrait saper la domination chinoise et permettre l’autosuffisance africaine.
Un scénario de conflit de systèmes se produirait si le Sud global, mené par la Chine, établissait un modèle de développement alternatif rejetant explicitement les normes occidentales en matière de gouvernance, de transparence et de droits humains. La rhétorique chinoise d'un système multipolaire, l'Initiative mondiale pour le développement et l'Initiative Ceinture et Route, comme contre-modèle au néolibéralisme occidental, gagne du terrain en Afrique, notamment au vu de l'exploitation historique induite par le colonialisme et les programmes d'ajustement structurel du FMI. Si ce fossé se creusait, des normes technologiques, des systèmes de financement et des blocs commerciaux parallèles pourraient émerger, compliquant considérablement la coopération mondiale en matière de protection climatique et de développement.
Convient à:
- Tonsami solaire en Chine et choc énergétique de la Chine: ce que signifie la nouvelle réforme des prix pour votre industrie
Options pour un partenariat énergétique plus durable
L’analyse de la ceinture solaire africaine révèle la nécessité de corrections de cap substantielles de tous côtés afin de réaliser le potentiel positif et de minimiser les risques identifiés.
Les gouvernements africains et l'Union africaine doivent adopter une stratégie de négociation coordonnée. La création d'une plateforme de négociation commune sous l'égide de l'UA, analogue au Club de Paris des créanciers, permettrait de mutualiser les pouvoirs de négociation et d'éviter une dynamique de nivellement par le bas, où les pays acceptent des conditions moins favorables par crainte de perdre des investissements au profit des pays voisins. Des exigences minimales standardisées pour les accords de prêt – clauses de transparence, évaluations de la viabilité de la dette, quotas de contenu local, normes environnementales et sociales – devraient être appliquées collectivement.
La mise en œuvre et l'application de politiques de contenu local robustes sont cruciales. La loi nigériane de 2023 sur l'électricité offre un modèle qui mérite d'être développé : une réglementation pour la participation locale à la fabrication, à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation des systèmes solaires, combinée à des investissements dans la formation technique et la recherche. La création de centres d'excellence régionaux pour les technologies photovoltaïques, les systèmes de batteries et l'intégration au réseau pourrait accélérer le transfert de connaissances et réduire la dépendance aux experts externes.
Pour la Chine, cela crée des incitations, tant sur le plan de la réputation que sur le plan économique à long terme, à modifier ses politiques. Améliorer la transparence des accords de prêt, participer aux initiatives multilatérales d'allègement de la dette à des conditions comparables à celles des donateurs traditionnels et intégrer des normes environnementales et sociales rigoureuses à tous les projets apaiseraient les critiques et favoriseraient des partenariats plus durables. La transition, déjà annoncée, vers des projets de petite envergure devrait être intensifiée et complétée par un véritable transfert de technologie : coentreprises avec des entreprises locales qui non seulement assemblent, mais conçoivent et innovent, collaborations de recherche et localisation progressive des étapes de production.
La Chine pourrait considérablement accroître son influence en contribuant activement à combler le déficit d'électrification de l'Afrique, non pas principalement par des projets à grande échelle pour les centres urbains et les industries, mais par des solutions hors réseau évolutives pour les 450 millions d'Africains ruraux privés d'électricité. L'annonce de 100 millions de yuans pour 50 000 foyers de la Ceinture solaire africaine est symbolique, compte tenu d'un déficit de 600 millions de personnes. Une multiplication par dix de ce programme, pour atteindre 1 milliard de yuans, permettrait d'atteindre 500 000 foyers, soit seulement 0,3 % des personnes concernées, mais aurait un impact financier minimal pour la Chine et un impact maximal sur la qualité de vie locale et l'image de la Chine.
Pour les acteurs occidentaux et les institutions multilatérales, ces conclusions soulignent la nécessité de proposer des alternatives crédibles, et pas seulement rhétoriques. Le Global Gateway de l'UE et l'initiative américaine « Build Back Better World » doivent passer du stade des annonces à celui des projets concrets, avec des conditions concurrentielles et des procédures d'approbation accélérées. L'intégration du financement du développement à l'accès au commerce – par exemple, l'élargissement des préférences « tout sauf les armes » pour les produits de technologies vertes manufacturées en Afrique – favoriserait l'industrialisation du continent.
Les formats de coopération trilatéraux entre la Chine, les acteurs occidentaux et l'Afrique, comme on en parle parfois, pourraient mutualiser expertise et ressources : la Chine fournirait du matériel économique, l'Europe fournirait les normes et réglementations, et l'Afrique fournirait les marchés et les matières premières, le tout au sein de structures de gouvernance multipartites transparentes. Des projets pilotes dans ce format pourraient démontrer que la coopération est possible malgré les tensions géopolitiques et qu'elle est plus avantageuse qu'une concurrence à somme nulle.
Des opportunités stratégiques s'ouvrent aux investisseurs et aux entreprises dans des segments de niche : technologies de batteries avancées, logiciels d'intégration au réseau, hydrogène vert, solutions d'économie circulaire pour les modules solaires, produits de financement spécialisés et assurance pour les énergies renouvelables sur les marchés frontaliers. La croissance rapide des marchés solaires africains, estimée à 42 % d'ici 2025, laisse entrevoir un potentiel de rendement attractif pour les acteurs tolérants au risque.
Le défi fondamental demeure la transformation d'un modèle extractif en un modèle génératif, qui transforme les matières premières et les ressources solaires africaines en création de valeur durable, développement industriel et prospérité généralisée, plutôt que de créer de nouvelles dépendances. La Ceinture solaire africaine peut servir de catalyseur à cette transformation si toutes les parties prenantes reconnaissent la nécessité d'un véritable partenariat, au-delà des intérêts particuliers à court terme. Dans le cas contraire, elle risque de perpétuer des schémas historiques d'extraction néocoloniale déguisés en technologies vertes, avec des conséquences déstabilisatrices à long terme pour l'Afrique, la Chine et le régime climatique mondial.
Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial
☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand
☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !
Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital
J'attends avec impatience notre projet commun.