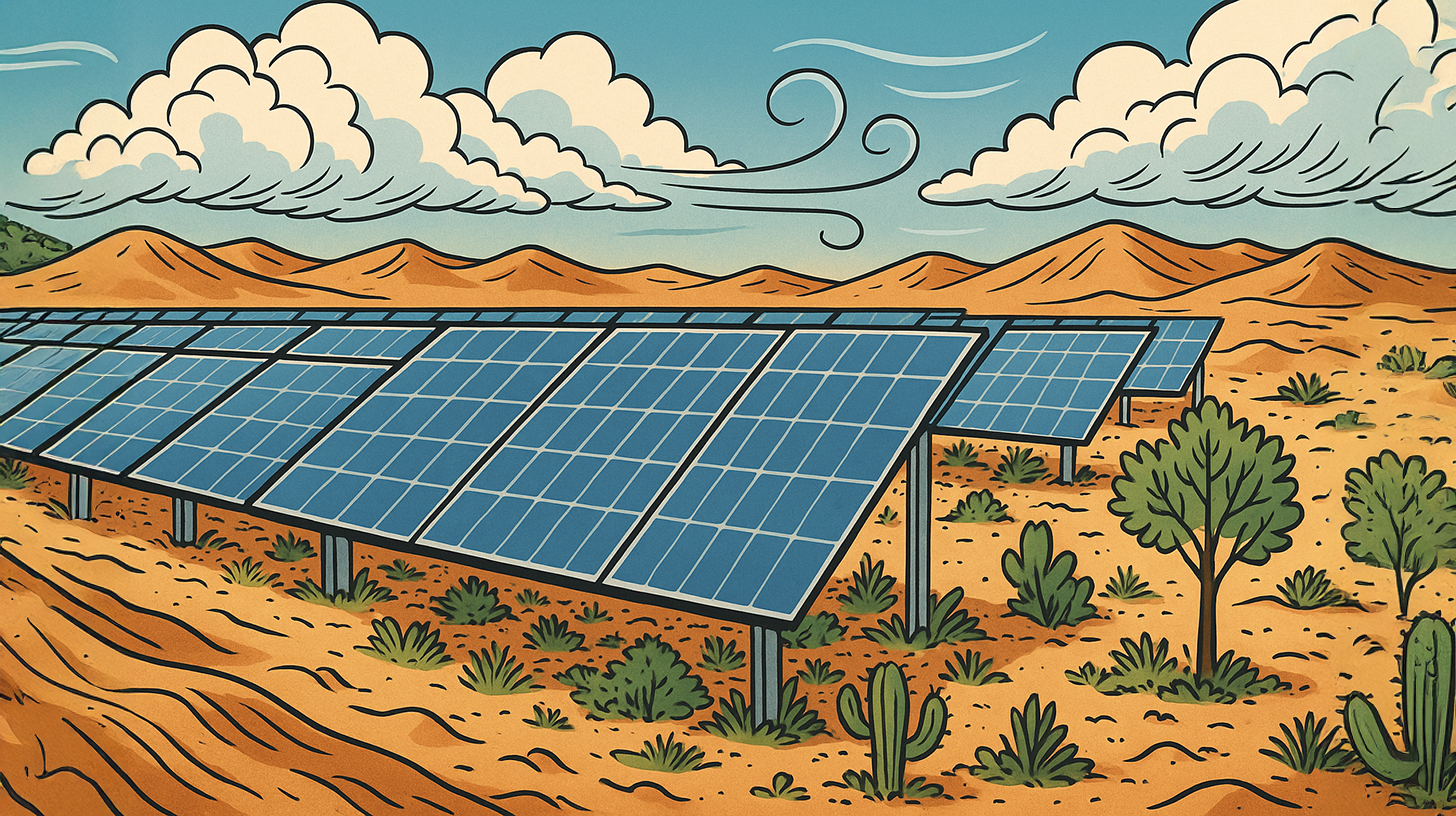
Parcs solaires dans les déserts chinois : micro-laboratoires écologiques : les deux visages des gigantesques parcs solaires du désert chinois – Image : Xpert.Digital
Des oasis de verdure dans le désert ? Que se passe-t-il réellement sous les immenses parcs solaires chinois ?
Le secret du désert de Gobi : comment les parcs solaires créent un nouvel écosystème
Cela peut paraître paradoxal, mais c'est en train de devenir une tendance observable : au cœur des déserts les plus arides de Chine, sous les rangées infinies de modules solaires étincelants, de petites oasis de verdure émergent. De nouvelles données de terrain, recueillies en 2024 et 2025, provenant d'installations gigantesques comme le mégaprojet Gonghe dans le désert de Talatan ou de parcs du désert de Gobi, confirment ce que les chercheurs soupçonnaient depuis longtemps : les parcs solaires à grande échelle modifient fondamentalement leur environnement local, créant un microclimat sensiblement plus frais, plus humide et protégé du vent.
Le mécanisme est aussi simple qu'efficace : les modules fournissent de l'ombre, réduisent les températures extrêmes du sol pendant la journée, retiennent la chaleur la nuit et limitent l'évaporation. Parallèlement, ils brisent le vent du désert, limitant ainsi l'érosion des sols. Ces niches protégées permettent aux plantes pionnières et aux microbes du sol de se réinstaller et d'établir un écosystème fragile. Mais cet effet positif ne se produit pas automatiquement. Il ne fonctionne que dans le cadre d'un concept intégré incluant une lutte ciblée contre l'érosion, une gestion réfléchie de l'eau et un choix judicieux du site.
Si ces « oasis solaires » offrent une opportunité de régénération écologique locale, elles soulèvent de nouvelles questions à l'échelle mondiale. Les modèles climatiques mettent en garde contre de potentiels effets secondaires à une échelle extrême, susceptibles de modifier les régimes météorologiques régionaux. Cet ouvrage examine les faits, les opportunités et les risques liés à ce phénomène fascinant d'un point de vue neutre : des processus biophysiques sous-jacents aux modules et des défis technologiques du désert aux enjeux systémiques de la politique énergétique et de la responsabilité des chaînes d'approvisionnement.
Plus qu'une simple électricité propre : l'effet climatique surprenant des champs solaires dans le désert
Dans plusieurs régions désertiques chinoises, les parcs solaires à grande échelle modifient le microclimat pour créer des conditions sensiblement plus fraîches, plus humides et protégées du vent sous et autour des modules, favorisant ainsi la végétation et la vie des sols. Cependant, une planification intégrée, la lutte contre l'érosion et la gestion de l'eau sont nécessaires. Les données de terrain de 2024-2025 sur les installations des déserts de Gobi et de Talatan, ainsi que sur le mégaprojet de Gonghe au Qinghai, corroborent ce constat. Des études et des modèles soulignent également les limites et les potentiels effets secondaires des installations à grande échelle sur le climat.
Les « oasis vertes » sous les modules solaires dans le désert sont-elles des cas isolés ou une tendance forte ?
Les données de terrain recueillies à plusieurs endroits dans les régions désertiques chinoises montrent systématiquement qu'un microclimat plus doux se développe sous les modules solaires : des températures du sol plus basses le jour et légèrement plus élevées la nuit, ainsi qu'une évaporation réduite et une humidité accrue du sol. Les modules agissent comme des ombrières et des pare-vent ; ces micro-interventions favorisent l'établissement des plantes et la vie microbienne et peuvent stabiliser progressivement la végétation lorsqu'elles sont complétées par des mesures de lutte contre l'érosion et une gestion appropriée de l'eau. Des résultats similaires ont été rapportés pour la région de Talatan (Gonghe), le Gansu et le Gobi et concordent avec les observations internationales concernant les effets de l'ombrage photovoltaïque sur l'humidité du sol et l'évaporation dans les zones arides.
Qu’est-ce que le projet Gonghe et pourquoi joue-t-il un rôle si important dans cette discussion ?
Le projet Gonghe, situé sur le plateau Qinghai-Tibet, est considéré comme le plus grand site photovoltaïque contigu au monde et connaît une expansion progressive depuis 2020. Des rapports font état d'une capacité photovoltaïque de 2,2 GW, plus stockage, mise en service en 2020 ; la centrale s'inscrit dans un parc d'énergies renouvelables plus vaste, servant de plaque tournante pour la stabilisation du réseau électrique depuis l'ouest de la Chine. Outre le photovoltaïque, des systèmes solaires thermiques à concentration (CSP) équipés d'héliostats y ont également été installés, certains avec stockage modulaire de sel pour une alimentation multi-heures lors des pointes du soir. L'achèvement de vastes champs d'héliostats a été annoncé pour 2025, soulignant l'hybridation PV+CSP sur le site.
Mécanisme : Pourquoi les champs photovoltaïques dans les déserts favorisent-ils la végétation ?
L'ombre se forme sous les modules solaires, réduisant le rayonnement solaire direct, abaissant la température du sol, ralentissant l'évaporation et préservant l'humidité du sol plus longtemps. Les surfaces des modules drainent l'eau de pluie le long de leurs bords ou de leurs interstices, ce qui peut entraîner des améliorations localisées des conditions d'humidité dans les zones périphériques. Parallèlement, la structure du module réduit la vitesse du vent au sol, limitant ainsi le transport de sable et les contraintes mécaniques sur les jeunes plants. Ces micro-altérations stabilisent les microhabitats dans lesquels les espèces pionnières et les micro-organismes se réinstallent. Des mesures réalisées en Chine font état d'une amélioration des conditions microclimatiques, des paramètres du sol et de la biodiversité dans la zone du module par rapport aux zones témoins.
Différenciation : les effets sont-ils aussi forts dans toutes les années et dans toutes les phases climatiques ?
Non. Lors des années très pluvieuses, les bénéfices sont nettement moins évidents, voire partiellement inversés, par exemple en raison d'une réduction excessive de la lumière directement sous le centre des modules, avec une faible pénétration de la lumière diffuse, ce qui peut entraîner une baisse locale de la biomasse. En revanche, lors des années sèches et chaudes, la protection contre l'humidité et la chaleur compense le manque de lumière, ce qui a un effet positif sur la végétation et l'humidité du sol. L'efficacité dépend donc des conditions météorologiques et de l'emplacement ; la microlocalisation et la disposition des modules (hauteur, inclinaison, espacement des rangs, est/ouest ou sud) influencent considérablement le résultat.
Transférabilité : la PV du désert est-elle à elle seule suffisante pour restaurer durablement la végétation ?
L'ombrage photovoltaïque crée des conditions de démarrage favorables, mais une végétalisation durable nécessite des mesures d'accompagnement : contrôle de l'érosion (par exemple, stabilisation de surface, brise-vent), semis et sélection de végétaux ciblés, rétention des eaux de pluie et, si nécessaire, irrigation minimale pour l'implantation, ainsi que gestion de la poussière et de l'entretien. Sans ces mesures, l'érosion éolienne et hydrique, la dérive des plantes ou les carences en nutriments risquent de ralentir le développement. Les rapports des exploitants et les équipes de recherche soulignent que la combinaison de la conception technologique et de la gestion des écosystèmes est un facteur de réussite.
Mise à l’échelle : quels effets climatiques à grande échelle les champs solaires du désert peuvent-ils avoir ?
Les modèles climatiques montrent que des installations de très grande envergure, dont l'albédo est significativement modifié, pourraient influencer les schémas de circulation régionale : réchauffement accru par rapport au sable clair, champs de pression modifiés et potentiellement augmentation de la convection, de la nébulosité et des précipitations au-dessus des installations. Dans des scénarios avec une couverture du Sahara allant jusqu'à 20 %, l'augmentation des précipitations, la rétroaction de la végétation et les pertes de rendement potentielles dues à la nébulosité, ainsi que les effets de téléconnexion sur d'autres régions, sont examinés. Ces résultats appellent à la prudence concernant les projets de grande envergure et suggèrent que les impacts sur les systèmes écologiques et climatiques doivent être intégrés à la planification et à l'autorisation.
Mix technologique : quel rôle joue le CSP aux côtés du PV en Chine occidentale ?
L'énergie solaire thermique à concentration (ESC) complète le photovoltaïque par une chaleur stockable à haute température, qui utilise des sels fondus pour permettre une production d'électricité pendant plusieurs heures après le coucher du soleil. Des parcs hybrides au Qinghai, au Tibet et dans d'autres régions associent le photovoltaïque pour une production diurne économique et l'ESC pour la flexibilité et le soutien au réseau. Les tours solaires à champs d'héliostats sont particulièrement adaptées aux climats de plateau à fort rayonnement direct ; des projets avec stockage de chaleur pendant 8 heures ont été documentés. Cette combinaison améliore l'intégration système des grandes centrales électriques en zone désertique et réduit les pics de réduction de puissance.
Problèmes de ressources et d’exploitation : comment les opérateurs gèrent-ils la poussière, la saleté et les pénuries d’eau ?
Le dépôt de poussière réduit les rendements et constitue un facteur clé des dépenses d'exploitation dans les zones arides. Les exploitants s'appuient de plus en plus sur des systèmes de nettoyage robotisés, semi-autonomes ou à faible consommation d'eau, des surfaces antiadhésives et des programmes de nettoyage pilotés par les données. Lorsque le nettoyage à l'eau reste inévitable, la consommation est optimisée. Parallèlement, les recherches montrent que l'amélioration du régime hydrique du sol apportée par les modules ne doit pas être confondue avec l'eau de procédé disponible pour le nettoyage des modules ; l'eau destinée à l'exploitation et à la maintenance reste une ressource rare et doit être gérée séparément.
Sélection du site : pourquoi Gobi, Talatan/Taklamakan et Kubuqi sont-ils mentionnés de manière si importante ?
Ces déserts allient un fort ensoleillement, une immense disponibilité foncière et une faible demande d'utilisation des terres souvent concurrentielle. Parallèlement, ils s'inscrivent dans les stratégies nationales visant à fournir une électricité propre aux centres industriels via des lignes électriques à très haute tension. Des projets emblématiques de « murs solaires » sont en cours de réalisation à Kubuqi ; les plus grands parcs photovoltaïques ont été construits au Qinghai/Talatan ; et des parcs combinés éoliens et solaires, issus de la première vague d'expansion, sont en cours de construction dans le désert de Gobi. Le Taklamakan est considéré comme le deuxième plus grand désert de sable au monde, avec des niveaux d'aridité extrêmes. Les projets de végétalisation et d'infrastructures contournent le cœur de la mer de sable et se concentrent sur les zones périphériques et les plateaux.
Preuves : Quelles données soutiennent l’affirmation selon laquelle la microécologie des modules est « plus saine » ?
Une étude sur le parc Qinghai Gonghe, publiée fin 2024, a utilisé un système d'indicateurs (DPSIR) comprenant 57 paramètres pour le microclimat, la physico-chimie du sol et la biodiversité. Elle a comparé la zone modulaire avec des zones témoins adjacentes et éloignées et a constaté des conditions nettement meilleures dans la zone modulaire qu'à l'extérieur. Des rapports et des campagnes de mesures parallèles sur d'autres sites désertiques confirment une réduction de la chaleur diurne, une augmentation de l'humidité du sol et des différences de composition microbienne favorables aux zones modulaires. Les cycles saisonniers et la conception du site sont des modérateurs clés de cet effet.
Limites : Quels risques ou effets secondaires faut-il prendre en compte ?
Plusieurs aspects nécessitent une attention particulière. Premièrement, les parcs solaires de très grande envergure peuvent modifier les bilans radiatifs et la circulation régionale ; la littérature évoque de possibles déplacements des zones de précipitations. Deuxièmement, les enjeux sociaux et environnementaux liés aux chaînes d'approvisionnement (par exemple, les droits de l'homme, les normes environnementales dans la fabrication des modules) restent d'actualité, même s'ils doivent être considérés séparément des micro-effets sur site. Troisièmement, la poussière, la dégradation des sols, la fragmentation des habitats et la perturbation potentielle des couloirs de migration présentent des risques qui doivent être pris en compte dans les études d'impact environnemental. Quatrièmement, des rangées de modules trop denses ou trop proches du sol peuvent entraver la croissance des plantes par manque de lumière si la conception n'est pas adaptée.
Nouveau : Brevet des USA – Installez des parcs solaires jusqu’à 30 % moins cher et 40 % plus rapidement et plus facilement – avec des vidéos explicatives !
Nouveau : Brevet américain – Installez des parcs solaires jusqu'à 30 % moins cher et 40 % plus rapidement et plus facilement – avec des vidéos explicatives ! - Image : Xpert.Digital
Au cœur de cette avancée technologique se trouve l'abandon délibéré de la fixation par serrage traditionnelle, standard depuis des décennies. Le nouveau système de montage, plus rapide et plus économique, répond à ce besoin grâce à un concept fondamentalement différent et plus intelligent. Au lieu de fixer les modules à des points précis, ils sont insérés dans un rail de support continu de forme spéciale et maintenus solidement. Cette conception garantit une répartition uniforme de toutes les forces, qu'il s'agisse des charges statiques dues à la neige ou des charges dynamiques dues au vent, sur toute la longueur du cadre du module.
En savoir plus ici :
Co-bénéfices écologiques : le PV dans le désert peut-il régénérer les paysages ?
Principes de planification : quelle conception maximise les co-bénéfices écologiques ?
Plusieurs principes de conception se sont avérés bénéfiques. Parmi ceux-ci, on peut citer l'augmentation de la hauteur libre des modules et un espacement suffisant des rangs pour favoriser la pénétration de l'air et de la lumière, des configurations est-ouest pour une répartition plus uniforme de la lumière et de l'humidité, des micro-noues ou des noues ciblées pour la rétention des eaux de pluie, la stabilisation de surface contre l'érosion, la plantation protectrice d'espèces indigènes résistantes à la sécheresse et une gestion spécifique des bordures inférieures des modules où les eaux de ruissellement peuvent former des poches d'humidité. La surveillance à long terme de l'humidité du sol, de la température, du vent et de la biodiversité permet une gestion adaptative.
Transferts : Le principe peut-il également être utilisé en dehors du désert ?
Oui. Dans les climats tempérés, l'effet est plus nuancé, car l'eau n'est pas toujours le facteur limitant. Néanmoins, l'ombrage peut stabiliser les rendements des systèmes agricoles et économiser l'eau pendant les étés chauds ; des études sur l'agri-PV montrent une réduction significative de l'évaporation et une atténuation du stress thermique. Sur les toits végétalisés, les modules PV influencent la végétation, les tampons d'humidité et de température interagissant en synergie avec l'efficacité des modules. Le PV flottant réduit également l'évaporation des réservoirs. Ces applications confirment que les structures PV peuvent exercer des micro-effets écologiques bien au-delà des déserts.
Perspective systémique : comment les parcs désertiques s’intègrent-ils dans la stratégie énergétique de la Chine ?
Les grandes centrales du désert de Gobi et d'autres régions arides alimentent les centres de consommation via des lignes électriques à très haute tension, parallèlement à des extensions de capacité dans les secteurs éolien, solaire, hydraulique et nucléaire. Lors de la première phase d'expansion, 100 GW ont été prioritaires dans les régions désertiques ; les objectifs nationaux visent la neutralité carbone à long terme. Les parcs hybrides, le stockage et l'énergie solaire concentrée (ESC) réduisent la volatilité. En résumé, une division spatiale du travail se dessine entre la production dans les ceintures de rayonnement et éoliennes et la demande dans les provinces industrielles de l'est.
Étude de cas Talatan/Qinghai : Qu'est-ce qui est spécial du point de vue de l'écologie paysagère ?
Talatan est située sur les hauts plateaux, où l'air est froid et raréfié, et où le rayonnement global est élevé. La combinaison d'un rayonnement direct élevé (pour l'ESC), de vastes zones planes (pour le PV) et d'une faible concurrence foncière en fait un site idéal pour une centrale hybride de grande envergure. Les effets du microclimat observés sont clairement visibles ici, car l'aridité et le vent représentent une forte contrainte de fond, sensiblement atténuée par l'ombrage et la réfraction du vent. Par ailleurs, l'altitude et le climat exigent une conception robuste de l'usine et de la logistique de construction.
Gouvernance : Quelles normes de gestion et de suivi sont recommandées ?
Des mesures de référence normalisées et de séries chronologiques sont essentielles pour les co-bénéfices écologiques : profils d’humidité du sol, enregistreurs de température à proximité du sol, mesures du vent et des particules, indices de biodiversité (végétation, invertébrés, microbiome du sol) et marqueurs d’érosion (imperméabilisation des surfaces, érosion en rigoles). Les plans de gestion adaptative doivent ajuster dynamiquement les cycles de nettoyage, la coupe ou le pâturage de la végétation, le réensemencement et les structures de rétention d’eau à petite échelle. Un suivi pluriannuel des extrêmes climatiques est nécessaire pour cartographier l’étendue des effets entre les années humides et les années de sécheresse.
Contre-arguments : les sources de relations publiques déforment-elles l’impression scientifique ?
Les articles de presse vulgarisent les résultats et peuvent être sélectifs ; il est donc important de se référer à des évaluations par les pairs et à des programmes de mesure vérifiables. Dans le cas des parcs désertiques chinois, plusieurs rapports indépendants et un article scientifique sur le parc de Gonghe, publié fin 2024, soutiennent le message fondamental des micro-effets positifs dans le secteur des modules. De plus, des études universitaires sur l'agri-PV, les toits végétalisés et le PV flottant démontrent la plausibilité biophysique. Néanmoins, les extrapolations à des échelles gigantesques doivent être faites avec prudence ; la modélisation et les études de scénarios comportant des incertitudes prédominent ici.
Directives pratiques : Quelles décisions de conception augmentent les chances de créer des « oasis vertes » ?
Maximisez la pénétration de la lumière en bordure des modules en concevant délibérément les zones basses comme zones d'humidité et de végétation. Optimisez l'espacement des rangs pour permettre un passage suffisant du vent et de la lumière diffuse. Envisagez des orientations est-ouest pour une répartition uniforme de la lumière. Prévoyez une micro-rétention des précipitations le long des bords inférieurs des modules. Augmentez la rugosité de surface pour réduire l'érosion. Choisissez des espèces tolérantes à l'ombre et à la sécheresse, avec un tapis racinaire peu profond pour stabiliser le sol. Assurez un accès pour l'entretien de la végétation afin d'éviter l'ombrage des modules.
Infrastructures et réseaux : quel rôle jouent les technologies de transmission ?
Le courant continu à ultra-haute tension (CCUHT) permet d'exporter d'importantes quantités d'électricité des régions désertiques vers les centres urbains avec des pertes minimales. Des projets dans le désert de Gobi et la région de Tengger démontrent déjà une connectivité UHT ; d'autres lignes sont prévues. Ces lignes sont essentielles pour garantir que les co-bénéfices écologiques locaux ne se fassent pas au détriment des restrictions systémiques. Seule une capacité de transport permet d'atteindre des heures de pleine charge élevées et des contributions stables au réseau.
Équilibre : les avantages écologiques l’emportent-ils sur les inconvénients locaux ?
À l'échelle du site, les avantages liés à l'amélioration du microclimat, à la rétention d'humidité du sol et à la réduction de l'érosion en zones arides l'emportent sur les bénéfices d'une planification et d'un entretien appropriés. Ces avantages sont compensés par la fragmentation potentielle de l'habitat, les exigences opérationnelles et de nettoyage, la gestion des poussières et la nécessité de maîtriser la végétation. L'essentiel est de minimiser les perturbations, d'entretenir les corridors et de réduire les émissions de poussières et de bruit pendant l'exploitation. Le résultat est une mosaïque : des zones modulaires servant de microrefuges, entourées de zones tampons écologiquement conçues.
Dimension sociale : comment sont classées les questions liées à la chaîne d’approvisionnement et aux droits de l’homme ?
Indépendamment des micro-effets locaux, la responsabilité sociale et environnementale de la chaîne de valeur photovoltaïque demeure un enjeu majeur, notamment en ce qui concerne la consommation d'énergie, les émissions et les normes de travail dans la production de modules. Les médias soulignent ces aspects négatifs et appellent à des mécanismes robustes d'audit, de certification et de diligence raisonnable. Pour une évaluation intégrée, les impacts environnementaux locaux et les impacts sur la chaîne d'approvisionnement mondiale doivent être pris en compte conjointement.
Lacunes dans les connaissances : qu’est-ce qui est encore insuffisamment étudié ?
Les séries chronologiques à long terme couvrant plusieurs décennies font défaut dans de nombreux endroits. Les questions ouvertes concernent la résilience de la végétation nouvellement établie aux événements extrêmes, la mise à l'échelle des micro-effets positifs à l'échelle du paysage, les impacts cumulatifs de nombreux parcs sur l'albédo et la convection régionaux, et la combinaison optimale entre la géométrie du PV, la composition de la végétation et la gestion des micro-eaux. Des programmes interdisciplinaires combinant ingénierie, écologie, hydrologie et sciences sociales sont nécessaires.
Parallèles internationaux : quels exemples extérieurs à la Chine sont pertinents ?
Le projet marocain NOOR Ouarzazate illustre le rôle systémique de l'ESC, notamment en ce qui concerne les problématiques de gestion environnementale locale dans les régions arides. En Europe, des projets utilisant des installations photovoltaïques à grande échelle et des toitures végétalisées étudient le bilan hydrique et la dynamique de la végétation. Des études sur les installations photovoltaïques flottantes démontrent une réduction de l'évaporation au niveau des réservoirs. Cette diversité démontre que les structures solaires modulent efficacement les microclimats ; toutefois, leurs manifestations spécifiques dépendent fortement des conditions du site.
Quelles leçons peut-on tirer pour les futurs parcs solaires dans le désert ?
- Les structures photovoltaïques peuvent créer des « oasis vertes » dans les zones arides en atténuant le stress thermique et hydrique du sol, en réduisant l’érosion et en favorisant la végétation.
- Sans contrôle de l’érosion, sans établissement ciblé de végétation et sans gestion de l’eau, les effets restent fragiles.
- Les projets à grande échelle doivent tenir compte des rétroactions climatiques potentielles ; les avantages régionaux ne doivent pas conduire à des impacts indésirables à long terme.
- L’hybridation avec CSP et stockage améliore l’intégration du système et réduit la réduction de la consommation, combinant ainsi les objectifs écologiques et énergétiques.
- La gouvernance de la chaîne d’approvisionnement reste essentielle à la durabilité holistique.
Perspectives : Quelles recherches concrètes et recommandations politiques sont disponibles ?
D'un point de vue technique, il convient de privilégier les implantations photovoltaïques adaptatives, avec des hauteurs, un espacement et des orientations optimisés, complétées par des systèmes de micro-rétention d'eau, un contrôle de l'érosion et des tapis de végétation adaptés au site. D'un point de vue opérationnel, les méthodes de nettoyage à faible consommation d'eau, la surveillance des poussières et le suivi de la biodiversité devraient devenir la norme. Au niveau systémique, les connexions ultra-haute tension (UHV), l'intégration du stockage et les hybrides CSP constituent des piliers centraux. D'un point de vue politique, les évaluations d'impact environnemental devraient être élargies pour inclure des analyses d'albédo/circulation, appuyées par des procédures de diligence raisonnable tout au long de la chaîne d'approvisionnement. D'un point de vue scientifique, les cohortes à long terme avec des données ouvertes sont importantes pour affiner des lignes directrices robustes.
Exemples de localisation supplémentaires : que montrent Kubuqi et Tengger sur la tendance ?
À Kubuqi, les médias documentent un « mur solaire » avec des extensions à l'échelle du gigawatt et des monuments symboliques qui contribuent non seulement à la production d'énergie, mais aussi à la stabilisation du désert. Dans le désert de Tengger, un parc éolien et solaire combiné de 1 GW a été raccordé au réseau via de nouvelles lignes de transport à très haute tension, constituant ainsi la première pierre de nombreux projets dans le désert. Ces projets phares montrent la voie : une infrastructure à grande échelle, intégrée au réseau, avec un potentiel de co-bénéfices pour les écosystèmes locaux, à condition que les normes environnementales et sociales soient rigoureusement respectées.
Les parcs solaires dans les déserts sont-ils un substitut à la nature ou un pont vers la régénération ?
Les parcs solaires ne remplacent pas les écosystèmes désertiques naturels ; ils modifient certaines zones pour créer un microclimat plus doux. Dans les zones dégradées et sujettes à l'érosion, ils peuvent servir de tampons techniques permettant la création d'îlots de végétation et le ralentissement de l'érosion – une technologie passerelle entre production d'énergie et stabilisation écologique. La transformation à long terme de ces noyaux en mosaïques végétales robustes dépend moins du module lui-même que de la profondeur de la planification, de la maintenance, de la logique hydrologique et de l'intégration systémique aux réseaux et à la gouvernance.
Regardez, ce petit détail permet de gagner jusqu'à 40 % de temps d'installation et jusqu'à 30 % de coût. Il est fabriqué aux États-Unis et breveté.
NOUVEAU: Systèmes solaires prêts à l'emploi! Cette innovation brevetée accélère massivement votre construction solaire
L'innovation principale de ModuRack réside dans sa rupture avec la fixation par pinces conventionnelle. Au lieu de pinces, les modules sont insérés et maintenus en place par un rail de support continu.
En savoir plus ici :
Votre partenaire pour le développement des entreprises dans le domaine du photovoltaïque et de la construction
Du toit industriel PV aux parcs solaires aux plus grands espaces de stationnement solaires
☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand
☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !
Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital
J'attends avec impatience notre projet commun.

